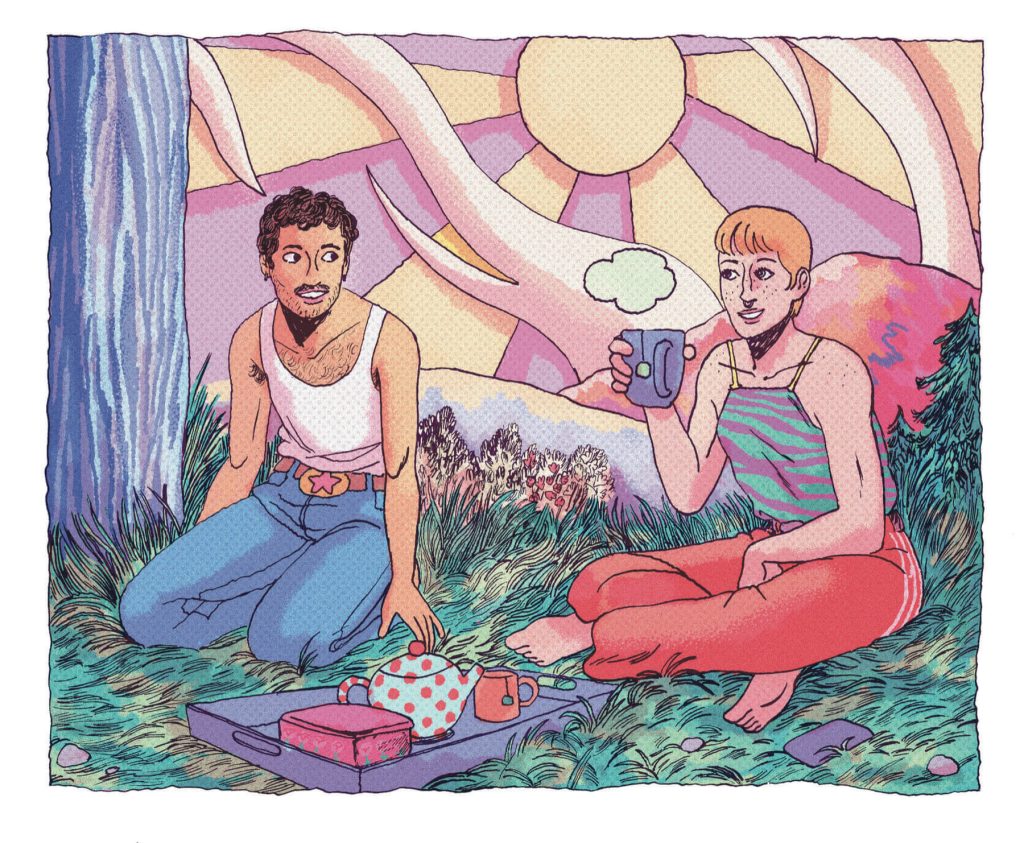Le 5 juin 1981, un article décrit pour la première fois les symptômes d'une maladie encore inconnue, provoquée par un virus nouveau : le VIH. De ces "années Sida" (1983-1995) demeure aujourd'hui un important travail d’archivage effectué par les associations LGBTQ+.
Depuis une trentaine d'années, les militants et les associations défendent le projet d’un centre d’archives LGBTQI+ autonome à Paris. Il est en discussion depuis les années 2000, mais c’est le film 120 battements par minutes qui a remis le projet sous les feux des projecteurs. Ainsi s’est créé le collectif Archives LGBTQI+, afin de préserver la mémoire des luttes qui ont marqué les années sida.
LIRE AUSSI >> VIH/sida : « On est encore loin de l’objectif zéro contamination »
Marc-Antoine Bartoli, qui vient de quitter ses fonctions à la présidence d’Act Up-Paris, association de lutte contre le VIH/sida, nous parle de la nécessité de conserver correctement ces archives et de perpétuer la mémoire de cette période importante de l'histoire gay.
En quoi le travail d’archivage sur les questions liées au VIH/sida est-il nécessaire ?
À l'époque, il y avait une démarche d’archives, mais à des fins politiques. C'était pour valoriser la perte, la mort. Elles permettaient de dénoncer l’inaction des politiques. Ainsi, si on a vu apparaître le patchwork des noms, c'était dans l’idée de garder une trace des morts du sida, d’en faire même des morts politiques.
Cette logique est-elle différente aujourd'hui ?
Aujourd’hui, on est davantage dans une logique mémorielle, de célébration et de commémoration communautaire. Le travail de mémoire qu’on essaie de faire autour de cette question-là est assez récent. Il passe notamment par la création de centres d’archives afin de valoriser la mémoire LGBT/sida.
Quels objets et documents peut-on trouver dans les archives de l'époque sur le VIH/sida ?
Les archives d’Act Up et sur le sida en général sont variées. On peut avoir des archives administratives, des rapports d’activité, des notes de réunions, des comptes rendus, ce genre de choses. Tout ce qui alimente la vie associative. Ensuite, on a tout l’attirail militant : des flyers, des affiches, des tracts, des objets en deux dimensions, en trois dimensions... On peut aussi avoir des tas de choses plus personnelles : photos, vidéos, notes, des œuvres d’art aussi ou encore, des vêtements.
Comment a-t-on récupéré les objets personnels ?
À l’époque, il n’y avait pas d’alternative quand quelqu'un mourait du sida : soit quelques amis qui avaient de l’espace pouvaient garder, soit ça partait directement à la benne. On comprend mieux la charge de ces objets, qui ont déjà échappé une fois à la disparition. Ce sont des objets très précieux, même quand il sont a priori complètement anodins.
Aujourd’hui, quels sont les enjeux autour de ces archives ?
Aujourd’hui, on veut un centre des archives pour ne pas oublier ce qu'il s’est passé il y a 40 ans. À Act Up, quand on a donné nos documents aux archives nationales et au Mucem, tout n’a pas été numérisé et parfois ça nous pose problème. On a un site internet d’archives et si on veut avoir accès à des notes internes, à des vidéos ou à des photos, c’est un gros souci.
En quoi consiste le projet du centre d'archives ?
Le projet du centre d’archives, comme je l’ai vu avec le collectif, c'est déjà d’archiver correctement un fonds, avec des règles de conservation. Quand on conserve des banderoles, par exemple, ou des supports textiles, c’est très compliqué de les garder dans le temps.
"Il ne faut pas oublier ce par quoi on est passé, ce que les gens ont traversé, ni les disparus"
Le projet de centre des archives comme il est conçu consisterait à conserver, mais aussi à montrer. Le but, c’est que les gens puissent y avoir accès pour comprendre les enjeux liés à ces objets. Ce centre d'archives est vital. Ce sera aussi un lieu de recueillement et de transmission, d’échanges. C’est un objectif qu’on se donne tous et toutes d’en finir avec le VIH/sida mais il ne faut pas oublier ce par quoi on est passé, ce que les gens ont traversé, ni les disparus.
Les avis sont assez divisés sur le fait de diffuser certaines archives. Qu’est ce que vous pensez des questions déontologiques liées au respect de la vie privée des victimes du sida ?
Pour les personnes qui ont vécu à cette période, c’était hier. Et depuis quelques années, on constate un retour d’anciens militants dans les associations : pour eux, c’est extrêmement difficile de voir des expositions avec des archives personnelles. Ces documents font référence à leur propre vécu, à leurs amis, à leur entourage. La charge émotionnelle est grande. Ce n’est pas évident, mais je pense que la diffusion est utile si on prévoit de dire pourquoi on montre ces objets. Ce n’est pas du tout pour faire du voyeurisme ou de l'intrusion, mais pour expliquer en quoi ils sont importants. Il y a cette volonté de vouloir bouger les lignes pour la nouvelle génération qui arrive, qui imprègne les esprits d’anciens militants.
Les jeunes générations sont-elles au fait des événements d’il y a 40 ans ?
On constate un effondrement des connaissances des jeunes sur ce sujet et ça nous inquiète. Ils se mobilisent peu dans les associations. L’enjeu actuel, c'est de mobiliser autour des archives et de diriger ceux qui veulent s'investir vers les associations. Une compréhension de ce qui s’est fait est nécessaire pour mieux comprendre aujourd'hui, pour consolider une expertise, un regard sur la société, sur la prévention, sur tout ce qu'il se passe dans nos intimités. Il y a urgence et c'est encore plus avec le Covid, qui a entraîné une baisse des dépistages, ainsi que des suivis PrEP et des accès au TPE [traitement post-exposition]. De plus, l'accompagnement ne se fait plus dans les collèges et les lycées. On n’a pas encore assez de recul sur les conséquences de la pandémie, mais le constat sur le terrain est catastrophique.
LIRE AUSSI >> VIH : la prescription de la PrEP chez le médecin généraliste est arrivée
LIRE AUSSI >> Paris vote en faveur du tant attendu centre d’archives LGBTQI+
Crédit photo : Act Up via Facebook