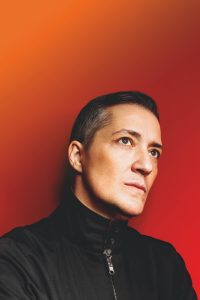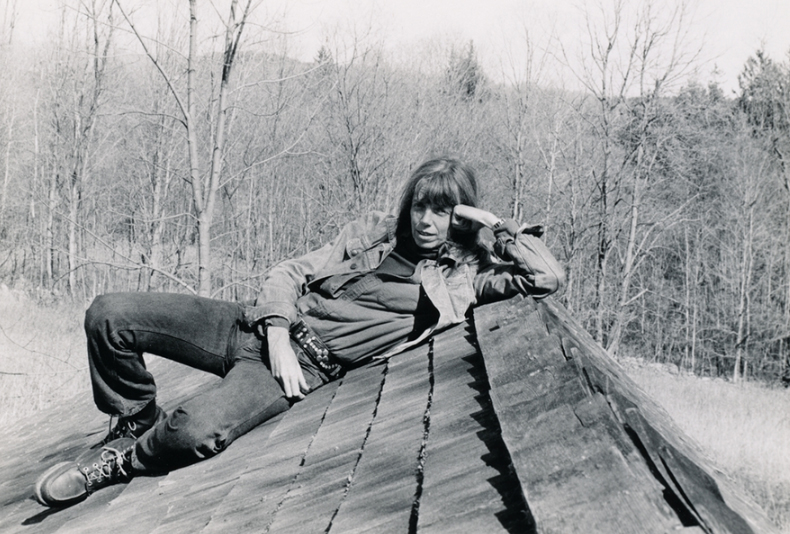[Article à retrouver dans le dossier spécial "Avoir 25 ans en 2025" de votre têtu· du printemps] Confrontée à l’urgence climatique et ses potentielles conséquences socio-politiques, la jeune génération LGBT+ a parfois le sentiment qu’il est déjà trop tard pour jouir de nos libertés durement acquises. Alors, sommes-nous cette fois bel et bien parvenus au point de "no future" ?
Un temps, mais juste un temps, la communauté s'est prise à rêver de la fin de l'histoire. L'acquisition des droits, le recul du sida, l'explosion de la visibilité LGBTQI+… en somme, tous les ingrédients d'un monde meilleur paraissaient enfin se réunir. Las, la réalité a vite douché nos espoirs : voilà que l'urgence climatique nous projette dans un futur infernal. Les potentielles conséquences socio-politiques d'une planète en débâcle, on les connaît, et certaines s'annoncent déjà : augmentation des violences, repli des peuples, montée des autoritarismes, développement de mouvements apocalyptico-religieux, etc. Or, nous le savons d'expérience : un monde en crise n'est jamais sûr pour les minorités.
À lire aussi : De La Grande Dame à François Ruffin, le sommaire du têtu· du printemps !
Avant les jeunes étaient inquiets pour leur avenir, aujourd'hui ils pensent qu'ils n'en auront pas – du moins, pas d'enviable. C'est déjà arrivé, remarquez : les jeunes punks des années 1970-80 ne proclamaient-ils pas "No Future" avec les Sex Pistols ? Sauf que cette fois, ce n'est pas un nihilisme anti-système qui en est à l'origine, mais un phénomène plus palpable, global et durable… Noura Yefsah, docteure en psychologie et enseignante-chercheuse au laboratoire Ladyss de l'université de Nanterre, a mesuré en 2023 l'impact de l'urgence climatique sur la santé psychologique des jeunes, en interrogeant 382 étudiants âgés de 17 à 24 ans. Résultat : 62% d'entre eux rapportent "un sentiment de malaise psychologique, de peur de l'avenir, d'angoisse et d'incapacité à se projeter dans un futur incertain". La chercheuse travaille alors la notion d'éco-anxiété, c'est-à-dire "un état de malaise psychologique caractérisé par l'appréhension d'une menace écologique, plus ou moins éloignée, et d'une catastrophe imminente".
Éco-anxiété
Dans les sociétés développées, le déni va bon train ; c'est ce que raillait le film Don't Look Up en 2021, un phénomène sur Netflix. Ainsi, depuis la France métropolitaine, on peut facilement se dire que l'Amazonie et Mayotte, c'est loin, en oubliant vite les canicules estivales ou bien que les inondations et les feux de forêt se multiplient jusque dans la banlieue de Valence (Espagne) et sur les collines de Los Angeles (Californie). "Pour le moment, l'Occident est encore peu confronté aux conséquences du réchauffement climatique à proprement parler", développe Cannelle Fourdrinier, consultante juridique de l'association écoféministe Les Impactrices. "Beaucoup n'ont pas cette impression d'urgence parce que la vie suit son cours comme elle l'a toujours fait, renchérit Inès, travailleuse agricole de 26 ans. Pourtant, c'est la merde." En 2024, elle a assisté à différents épisodes de pluies torrentielles en France, en grande partie dues à l'évaporation de la Méditerranée. "Ces phénomènes t'atteignent moins quand tu es dans un bureau en ville, observe-t-elle. Mais quand on est sur le terrain, on se rend compte. On continue tous de se dire que pour l'instant, tout va bien, mais le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'arrivée."

Inès avait d'abord choisi de se tourner vers des études de journalisme, mais ses angoisses autour des questions environnementales l'ont rattrapée quand elle a commencé à travailler. "Je suis devenue reporter d'images – ce que je voulais – sans arriver à trouver du sens dans ce que je faisais. Je ne me sentais ni libre ni utile, retrace-t-elle. J'avais besoin d'un projet plus concret, qui allait dans le sens d'une nouvelle ère climatique." Elle a donc tout plaqué pour devenir tour à tour ouvrière agricole, maraîchère et arboricultrice, afin d'acquérir une certaine autonomie. "Dans ce travail, j'ai trouvé la tranquillité d'esprit. Je cogite moins parce que je me sens moins impuissante, analyse-t-elle. Avant, je filmais, je faisais du montage, mais au fond je ne savais rien faire de mes mains et j'angoissais. Je m'imaginais les pires scénarios en me répétant que je serais incapable d'apporter quoi que ce soit de concret aux autres."
Impuissance et quête de sens
Ce fatalisme, Noura Yefsah a pu le constater chez une partie des étudiants interrogés, qui manifestaient un grand sentiment d'impuissance. Mais beaucoup ne baissent pas les bras pour autant. Sans forcément tout quitter pour revenir à la terre comme l'a fait Inès, ils prennent soin de choisir des parcours porteurs de sens. Après des études de droit, Cannelle avait aussi besoin d'un métier qui l'anime dans le monde qui s'annonce. De retour dans sa Martinique natale, elle a "trébuché dans le militantisme" avant de devenir lobbyiste d'un collectif d'ouvriers agricoles empoisonnés par le chlordécone, un pesticide très toxique pour l'homme qui a contaminé les sols et les eaux de l'île des Caraïbes.
Damien, 20 ans, a opté pour une licence de géographie afin d'étudier les relations entre les humains et leur environnement, en espérant pouvoir plus tard agir sur la façon dont ils l'occupent. "Ce serait naïf de penser qu'en y mettant simplement du sien, la situation ne va pas empirer", se tempère-t-il toutefois. Pour le jeune homme, il est indiscutable que l'humanité devra payer pour avoir vécu trop longtemps à crédit : "Mais je voudrais qu'on limite les pots cassés, qu'on aille vers du mieux, qu'on apprenne à mieux gérer nos ressources. C'est pour ça que j'aimerais étudier l'urbanisme, afin de repenser notre façon de vivre de manière concrète."

Après un master en droit international, Costanza, 23 ans, a voulu faire une pause dans ses études et effectue actuellement un stage à Action contre la faim. "Ça me permet d'avoir une idée globale des enjeux et des leviers sur lesquels agir, fait-elle valoir. Je ne cache pas que j'éprouve un sentiment d'impuissance. Aucune donnée scientifique ne va dans le sens d'un futur prospère et heureux. Mais on n'arrive à rien si on ne tente rien, alors je préfère m'investir dans l'associatif et trouver des solutions. Je ne vois pas l'angoisse comme quelque chose de foncièrement négatif lorsqu'elle s'accompagne d'une prise de conscience."
À l'aune du bouleversement climatique, on change de vie, on devient végétarien, on achète de seconde main, local et de saison, on remet en question ses modes de consommation… y compris sexuelle. "On est habitués aux relations fast food, regrette Inès. Ça en dit long sur notre rapport à la consommation. On veut tout, tout de suite." La jeune femme, bisexuelle, affectionne le couple ouvert et a plusieurs partenaires un peu partout en France. "Mais je ne me projette pas forcément à travers des relations amoureuses, précise-t-elle. Ce que j'aimerais, c'est monter une coopérative, travailler aux côtés de gens que j'aime."
En attendant l'apocalypse
De fait, les plans de vie personnelle sont aussi affectés par la noirceur de l'horizon. "Les jeunes semblent moins enclins à se projeter dans le long terme, par exemple à envisager de se marier ou d'avoir des enfants, confirme Noura Yefsa. Plusieurs étudiants m'ont confié ne pas vouloir fonder une famille en raison de l'incertitude liée à la situation climatique." Depuis 2021, les couples de femmes peuvent enfin accéder en France à la procréation médicalement assistée (PMA), un pas de géant en termes de droit à faire famille. La question est de savoir si on en a encore envie dans un monde en flammes… Hors de question pour Inès, tandis que Cannelle se montre moins catégorique. "Je ne suis toujours pas sûre de vouloir jeter un petit être qui n'a rien demandé dans ce marasme social, environnemental et économique, pose-t-elle. Mais quand je vois le nombre de fachos qui ne se posent pas la question, je me dis que c'est une erreur de renoncer à avoir des enfants. Ce serait se tirer une balle dans le pied."
Alors, nos luttes pour obtenir l'accès à la parentalité ont-elles porté leurs fruits trop tard ? Doit-on déjà renoncer, pour le bien de l'humanité, au prix de nos efforts ? Lorsqu'on lui demande s'il se voit père, Damien oscille sans parvenir à se fixer : "Je me verrais bien élever un enfant avec un mec… Mais je me demande souvent si ce serait égoïste au vu de l'état du monde. En même temps, si j'étais hétéro, je ne me poserais peut-être pas la question !" Pour les couples de garçons, une autre question se pose encore : comment être sûr d'avoir recours à une gestation pour autrui (GPA) éthique puisque, contrairement à la PMA, cette pratique n'est toujours pas autorisée en France ? "Je me vois mal dépenser une fortune pour avoir un enfant, ni fermer les yeux sur les conditions de vie des mères porteuses", tranche-t-il. Daniel trouve toutefois injuste que les jeunes queers aient à renoncer, pour le bien commun, à fonder une famille après que la communauté a tant lutté pour rendre cela possible. D'un autre côté, il ne souhaite pas faire partie d'une nouvelle génération qui détourne le regard et renvoie la balle à la suivante.

"En tant que meuf lesbienne, j'ai peur que mes droits soient menacés avec la montée de l'extrême droite et la mise en place de gouvernements à la fois climatosceptiques et LGBTphobes…" confie Costanza. Et quand les conservateurs prennent conscience de l'urgence climatique, c'est presque pire. "Dans une situation catastrophique, une population privilégiée, ou moins menacée, cherchera à maintenir ses privilèges", avance Antoine Dubiau, doctorant en géographie. Dans son livre Écofascismes, publié en 2022, il s'inquiète de l'illusion de croire que l'extrême droite est allergique aux questions écologiques : par nature, elle en fera son miel populiste, comme de tout le reste. La perspective préoccupe de plus en plus Inès : "Avec le réchauffement climatique, on prévoit des vagues migratoires, et de plus en plus de gens expriment leur peur d'être « submergés », « envahis », ce qui les rend plus enclins à voter pour l'extrême droite."
Il y a du vert dans l'arc-en-ciel
Dans un monde bouleversé, il n'y a pas que l'extrême droite qui menace. "Il y a toujours eu des mouvements écologistes essentialisant la nature, à l'extrême droite mais aussi à gauche, rappelle Antoine Dubiau. Ils la conçoivent évidemment sans les personnes LGBTQI+, puisque l'homosexualité et la transidentité sont vues comme des pathologies ou des lubies." Ainsi le philosophe Jacques Ellul, qui dans les années 1980 avait considéré le sida comme une punition divine de l'homosexualité, a inspiré certains courants décroissants ou anti-industriels qui assimilent les parcours de transition, la PMA et la GPA au transhumanisme. "Sauf que le but du transhumanisme, souligne Cannelle Fourdrinier, c'est d'atteindre l'éternité, de lutter contre le vieillissement et même contre la mort ; c'est une idéologie résolument individualiste, productiviste et capitaliste."
En réalité, il est difficile de penser l'écologie sans prendre en compte les questions sociales, économiques, féministes, queers et antiracistes qui sont aussi mises sur la table par les bouleversements en cours. "Les grosses transformations ne vont pas venir d'un mouvement uniquement écologique mais plutôt de l'engagement émancipateur, théorise Antoine Dubiau. Le politique doit être placé au-dessus si on ne veut pas d'une forme d'écologie qui reproduise les inégalités, qu'elles soient de genre, de race, de classe…" Or les jeunes queers aspirent légitimement à un avenir libre, quelle que soit la température extérieure.
À lire aussi : Grindr moi non plus : 16 ans de "tu ch" et puis s'en va ?
Crédit photos : AFP