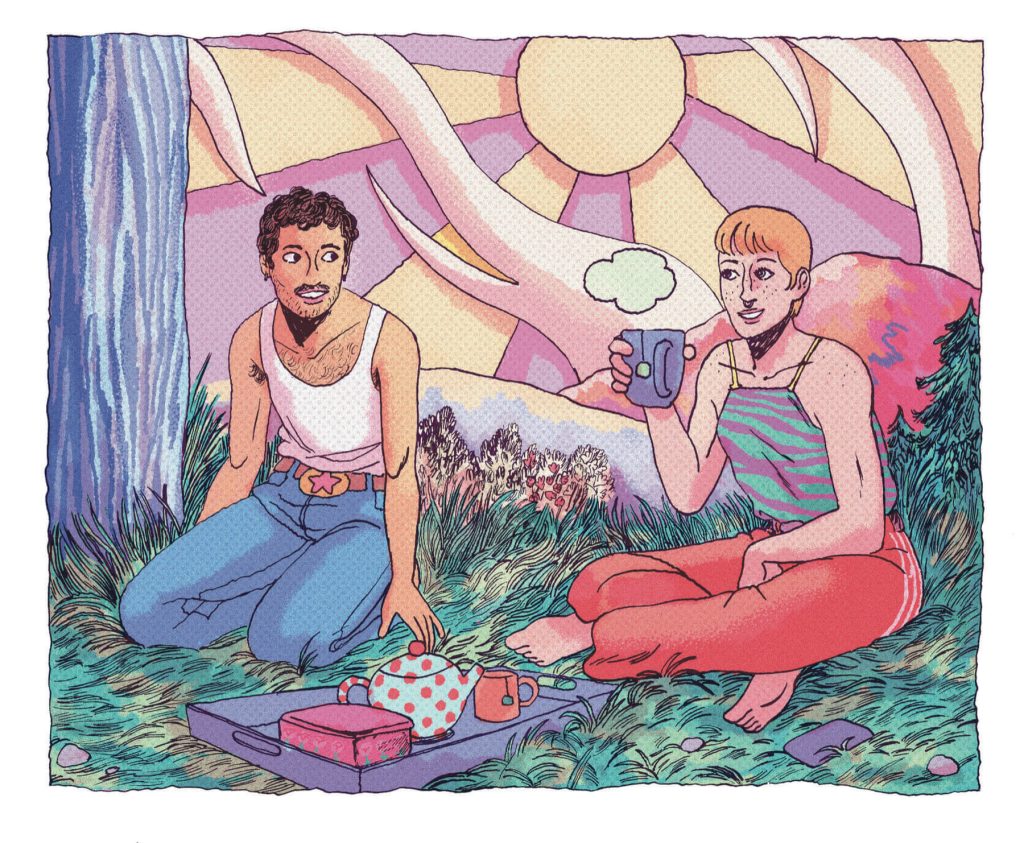Quand la consommation dérape, et que la vie quotidienne ne tourne plus qu’autour de plans cul sous drogues, l’arrêt peut effrayer, à plusieurs titres : peur de l’isolement, d’être pointé du doigt, doutes sur ses capacités... Des garçons qui ont décroché témoignent.
Depuis que j’ai commencé, je n’arrive plus à baiser sans produits.” Le désarroi de Nicolas*, un quadragénaire croisé en partouze dans un appartement parisien, est palpable dans ces quelques mots. Harnais sur les épaules et jockstrap sur les hanches, sa bouteille de poppers à la main, il vient “recharger” dans la cuisine. Comprendre : faire une pause, prendre une ligne de 3-MMC et du GHB. Il griffonne ses horaires de prises sur un papier – pour éviter de trop consommer – et repart dans le salon transformé en salle de jeux pour une autre longue session de chemsex, jusqu’au petit matin. Mi-excité, mi-résigné.
A LIRE AUSSI : Chemsex : 5 règles pour réduire les risques
Le phénomène du chemsex– contraction de “chemical sex”, soit le fait de consommer des substances psychoactives dans un contexte sexuel – n’est pas nouveau, mais se répand depuis une dizaine d’années dans le milieu gay. Il concerne, en France, entre 3 % et 14 % des homosexuels, selon la méthodologie des enquêtes sur le sujet. Il peut engendrer plusieurs problèmes pour ses adeptes : dépendance, isolement, troubles psychologiques, infections sexuellement transmissibles, surdoses, voire décès. Entre janvier 2008 et août 2017, les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance (CEIP-A) de Paris et de Grenoble ont recensé 24 cas mortels.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les associations et les médecins spécialistes voient les appels à l'aide se multiplier. Mais combien passent sous les radars, faute d’informations suffisantes ? Face à ces risques, pressentis ou vécus, certains chemsexeurs tentent de décrocher. Avec plus ou moins de facilité tant les motivations et les parcours sont différents, mais aussi complexes.
A LIRE AUSSI : Comment l'épidémie de Covid-19 met en danger les chemsexeurs ?
Paradis perdus
“Abandonner le chemsex revient à renoncer à une expérience de vie d’une grande intensité”, relève l’enquête Attentes et parcours liés au chemsex (Apaches), conduite par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) et publiée en mai 2019. “C’est dur”, reconnaît Francis*, qui a décroché il y a quelques mois après être tombé “dans une forme de déchéance”. “Je pensais être maître des chems, mais ce sont eux qui sont maîtres de nous, à vie. Je pense tous les jours à des pratiques, notamment au fist, qui me manquent”, explique-t-il, nostalgique.
Tim Madesclaire, cocréateur de la revue gay Monstre, cherche à relativiser ce ressenti, d’autant plus qu’il peut constituer un frein à l’envie d’arrêter : “Il y a souvent un sentiment de paradis perdu. Mais la vie entière n’est faite que de paradis perdus : l’enfance, l’adolescence, le début de la vie professionnelle, etc.” Mickaël*, quadragénaire lyonnais, ne regrette pas d’avoir arrêté : “Il y a une forme de nostalgie. Je rigolais bien, on faisait les connes avec les autres mecs. Mais ce contexte social n’appartient qu’à cette pratique, qu’à ce moment particulier. Avec le recul, quand je vois la tristesse que ça provoquait, je n’en ai plus envie aujourd’hui.”
Des espaces de socialisation
“Les craintes liées à l’abandon reviennent fréquemment chez les pratiquants qui envisagent d’arrêter”, confirme Muriel Grégoire, addictologue et psychiatre dans un centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) à Aix-en-Provence. La peur de l’isolement, également.
Et pour cause : les sessions de chemsex – très ritualisées, avec des rencontres sur des applications, des baises dans des lieux privés et des échanges facilités – “sont des espaces de socialisation très forts, explique l’addictologue. Si vous venez de vous séparer, de perdre votre emploi, vous rencontrez les produits – mais aussi des amis – et vous avez envie de vous y réfugier. L’addiction peut commencer au moment où ceux qui vont y trouver un réconfort n’ont pas d’autres supports autour d’eux (des loisirs, des amis, une relation stable, etc.).”
Elle assure néanmoins que tout le monde ne devient pas addict et qu’il faut un terrain “propice” : des traumatismes psychologiques, une carence affective, une situation personnelle compliquée à un moment donné...
"Solitude extrême"
“Quand j’ai arrêté, je me suis lancé à fond dans la réhabilitation de mon appartement. Ça m’a occupé un temps, et quand j’ai eu fini, j’ai ressenti un sentiment de solitude extrême, se souvient Mickaël. Les relations avec mes amis s’étaient distendues, et je venais de couper les ponts avec les personnes de mon réseau de chemsexeurs. J’étais seul, déprimé. Mais je me disais : « Tu vas évoluer, tu vas t’en sortir. »”
Si l’évolution dont parle Mickaël a pris quelques mois – compliqués –, il ne regrette rien aujourd’hui, car “le rapport bénéfice/risque est totalement déséquilibré”.
Manque de structures
Depuis qu’il a entamé l’arrêt du chemsex, Francis, lui, se fait accompagner par une addictologue et par un psychologue. Ce support est d’autant plus bienvenu que le manque de formation des professionnels de santé sur ce sujet est encore notable. “La problématique est très récente, à peine une dizaine d’années. Personne n’a eu le temps de s’organiser, assure Fred Bladou, chargé de mission nouvelles stratégies de santé à Aides. Il y a encore un manque de structures d’accueil, et les psychologues ou les soignants sont peu formés.”
Anesthésiste dans le service des urgences d’un grand hôpital parisien, Mehdi* explique n’avoir été formé aux surdoses de 3-MMC – une cathinone de synthèse, illégale depuis 2010, et dont l’usage est très répandu chez les chemsexeurs français – qu’en 2019. Une formation “complète, bienveillante et sans jugements”, précise-t-il.
Double stigmatisation
Le chemsex, et c’est bien une des difficultés pour l’appréhender, est à la croisée de plusieurs chemins. “Il ne s’agit pas d’un usage de drogues classique, il faut prendre en compte l’orientation sexuelle ou encore les problèmes personnels”, ajoute le chargé de mission à Aides. À tous ces niveaux de complexité viennent se rajouter deux autres couches : la stigmatisation et la honte.
Sur ces points, Tim Madesclaire et Fred Bladou sont tous deux d’accord : “Il y a une stigmatisation très importante des gays et c’est un frein à l’amélioration de la situation. Aujourd’hui, être gay et être consommateur de drogues, c’est même doublement stigmatisant.” “La culpabilité doit changer de camp. De quoi sont coupables les chemsexeurs ? D’avoir fait l’amour? Non. Ils ne sont coupables de rien”, assène Romain Amaro, sociologue et ethnographe, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années.
Prise de conscience
Comme le souligne l’OFDT, arrêter le chemsex, de façon temporaire ou permanente, peut prendre des semaines, des mois, voire des années, et la démarche varie en fonction des parcours personnels. Il peut être le fruit d’une réflexion personnelle, d’un déclic, d’une lassitude ou d’une réaction singulière de l’entourage. “L’arrêt doit venir de soi. Mais pour ce faire, il faut déjà être conscient de sa consommation”, assure Fred Bladou, qui ajoute qu’il n’y a pas de “recette magique”. Ainsi, Harry* a arrêté après une prise de conscience, seul, “comme la moitié des ex-chemsexeurs”, précise-t-il.
Dans les autres cas, l’accompagnement et l’écoute constituent autant de leviers sur lesquels il est possible d’agir. “Parler, être écouté sans jugements, cela fait du bien. Que ce soit par un addictologue ou dans un centre communautaire comme Aides”, ajoute Muriel Grégoire. “Verbaliser et ne pas rester seul face à sa consommation aide énormément”, ajoute le chargé de mission de Aides. Les amis et le cercle familial peuvent aussi jouer un rôle important. “Je connais un mec qui a arrêté le chemsex grâce à sa famille... qui lui était pourtant très hostile en raison de cette pratique”, assure Tim Madesclaire. Face au chemsex, il n’y a donc pas de fatalité, mais des doutes et des épreuves à résoudre, à son rythme.
Michael, 40 ans, employé à Lyon (69)
Mon premier cachet d’ecstasy, c’était vers 20 ans, quand j’ai commencé à sortir. Dès le début, j’ai senti que ça décuplait ma libido, mais je n’ai consommé des drogues dans un contexte sexuel que très tard, en 2010. J’avais 31 ans.
Après avoir goûté la MDAI, aux effets proches de la MDMA, j’ai fait mes premières partouzes, puis j’ai rejoint des réseaux de sex parties. C’était convivial : on prenait l’apéro ou on faisait la fête, on tapait un peu et on baisait. J’ai diversifié les drogues : coke, ecstasy, kétamine, 3-MMC, GHB – très désinhibant. L’usage des produits s’est banalisé et s’est tourné vers le sexe. Et le rythme s’est intensifié.
Les mois avant que j’arrête, j’étais en partouze tous les week-ends, avec une ou deux nuits blanches. J’ai perdu le contrôle à ce moment-là : je ne respectais plus mes engagements, je voyais moins mes amis...
J’ai eu une prise de conscience à l’été 2017, après un gros week-end de baise. J’avais arrêté de prendre mes antidépresseurs, prescrits depuis deux ans à la suite de la découverte de ma séropositivité et de tensions au travail. Je me suis réveillé un matin avec une forte angoisse, avec le sentiment d’être enfermé. Je ne trouvais plus de solutions pour me canaliser.
J’ai consulté une addictologue, j’ai discuté avec des associations de ma pratique du chemsex et j’ai réalisé qu’il fallait que je fasse le ménage dans ma vie. J’ai retapé mon appart, supprimé les applis de rencontres, coupé les ponts avec les personnes qui pouvaient me tenter. Il s’ensuivit un long moment de solitude durant lequel j’ai redécouvert une sexualité plus sobre. J’avais tout à réapprendre : j’étais un lapereau de six semaines qui jouissait rapidement. Mais au moins j’éjaculais !
Après une rupture, j’ai recommencé à mélanger alcool et Xanax pour me calmer. Je me suis tourné vers la sophrologie et j’ai arrêté les antidépresseurs en deux séances. En parallèle, je travaillais avec ma psychologue sur la “resociabilisation”. Et la phase ascendante est arrivée : je me suis lancé dans des activités artistiques, je me suis fait de nouveaux amis, j’ai amorcé des projets person- nels qui me procuraient beaucoup de joie. Pour moi, c’était gagné.
Je reste très prudent. En avril 2019, j’ai eu un plan chems. Un one shot que j’ai bien vécu. Je sentais un mal-être chez certains pratiquants, et moi, décrocheur, j’avais l’impression de rayonner. Oui, il peut y avoir une certaine nostalgie. Avec le recul, quand je vois la tristesse que ça provoquait, je n’en ai plus envie aujourd’hui.
Francis, 55 ans, cadre dans l'immobilier en Vendée (85)
J’ai démarré le chemsex il y a neuf ans, en découvrant le fist-fucking. Pour pouvoir me lâcher, il fallait que je déconnecte mon cerveau, que je puisse oublier les tracas de la vie quotidienne et arrêter de me demander si j’allais être à la hauteur des désirs de mon partenaire... C’était une échappatoire. Sans chems je réfléchissais trop et je n’arrivais pas à être concentré avec le mec de mon plan.
Pendant cinq ans, j’ai consommé exclusivement de la 4-MEC, en sniff, que j’achetais sur le net. Je ne cherchais pas la performance – plus loin, plus gros, plus intense – mais un moment de partage, un rapport affectif. C’est comme ça que j’ai associé les cathinones de synthèse, notamment la 4-MEC, à mes pratiques sexuelles, car celle-ci décuplait mon empathie.
Au début c’était soft, une fois toutes les trois ou quatre semaines. En 2015, j’ai essayé la kétamine avec un mec – mais nous n’avons pas eu de rapport sexuel –, puis la 3-MMC, la MDMA, la cocaïne... On m’a initié au slam – la consommation par injection –, et ça a été dramatique : dès la première fois, j’ai chopé une hépatite C, et il m’a fallu plus de deux ans pour en guérir. L’impact psychologique a été très fort : je ne voulais pas contaminer quelqu’un, ce qui me renvoyait à ma propre contamination au VIH vingt-cinq ans plus tôt. J’ai arrêté le chemsex, mais j’ai continué de consommer seul.
Après trente ans passés à Paris, j’ai décidé de partir : ça allait me tuer. Je me suis installé à Niort, en Nouvelle-Aquitaine, ma région de naissance, où j’ai commencé une nouvelle vie, avant d’atterrir en Vendée. J’ai vite repris mes mauvaises habitudes et j’ai recommencé le chemsex. Je n’avais plus d’amis, que des plans cul, et je me faisais licencier régulièrement à cause de mes retards. J’ai connu une sorte de déchéance, m’enfonçant financièrement et psychologiquement. Je croyais pouvoir maîtriser ma consommation, mais c’était illusoire.
Fauché, j’ai remplacé ma consommation de drogues par l’alcool. Si mon dernier plan chems remonte au début de l’année 2019, c’est ma consommation excessive d’alcool qui m’a conduit volontairement à l’hôpital, après sept jours de beuverie à la suite d’un burn out. Je suis maintenant suivi par un addictologue et par un psychologue depuis le début de novembre. Arrêter le chemsex, c’est dur. Je pense tous les jours à des pratiques qui me manquent. Mais j’essaye de rester lucide, de résoudre mes problèmes, d’avancer et de reconstruire une vie sociale et affective.
Harry, 28 ans, graphiste à Paris
Lors d’une soirée étudiante avec des amis, j’ai découvert la MDMA. J’avais tout juste 23 ans. Quelques mois plus tard, j’étais diplômé et j’enchaînais les sorties dans les clubs gays parisiens. J’ai ressenti une forte pression sociale dans ces soirées-là – il faut être mignon, musclé, pas timide –, alors je buvais de l’alcool pour me désinhiber, puis j’ai basculé dans la MDMA pour gagner en confiance. En quelques mois, ma consommation est passée du cadre festif au cadre sexuel avec les partouzes de fin de soirée.
La première fois, en 2015, j’étais peu à l’aise : je n’ai fait que “taper”, sans baiser. Dès la deuxième, je suis rentré dans un cycle de chemsexeur. J’ai commencé la 3-MMC, j’ai dé- couvert le GHB, dont la prise est très ritualisée, toutes les heures et demie. Ma consommation de drogues s’ins- crivait dans un schéma “clubbing et partouzes”, et le rythme s’est rapide- ment accéléré à raison de deux voire trois fois par mois. Je mélangeais la 3-MMC et la MDMA, j’ai testé la kétamine, la tina (méthamphéta- mine). Les drogues me désinhibaient avec les mecs : je pouvais juste dis- cuter avec eux, ou en encaisser une dizaine. À ce moment-là, j’étais une bonne salope, je me suis bien amusé. Ça a duré deux ans.
J’ai eu un déclic le 1er janvier 2017, en after. J’ai eu le sentiment d’avoir fait le tour. Je ne voulais pas que ce schéma s’inscrive dans la durée. J’en avais marre des coups de fatigue au boulot le lundi, de ma mauvaise humeur les mardi et mercredi... et de replonger le samedi. Les drogues commençaient à avoir un impact physique sur mon corps. J’ai eu plusieurs
torticolis par an, le GBL – un solvant industriel – flinguait mon transit. J’ai tout arrêté : les soirées masc for masc, les partouzes... Tout seul. J’ai découvert l’existence des groupes d’entraide bien plus tard, parce que je ne me considérais pas comme addict. Alors que je l’étais.
J’ai rechuté deux fois : après une rupture amoureuse, puis quand je me suis retrouvé au chômage, en novembre 2018. J’ai un peu “baisouillé”, mais j’ai surtout pris trop de kétamine, à la limite du K-hole, de la surdose. Là, je me suis dit que c’était terminé.
Je ne regrette rien de mon passé, mais j’ai évolué. Certes, je baise moins, mais je suis plus exigeant avec moi-même et les mecs que je rencontre, je suis moins dans une logique de tableau de chasse. J’ai compris qu’il ne fallait pas plaire à tout le monde, mais chérir ceux qui comptent, et je privilégie la construction de rapports durables plutôt qu’éphémères.
Crédit photo : TETU