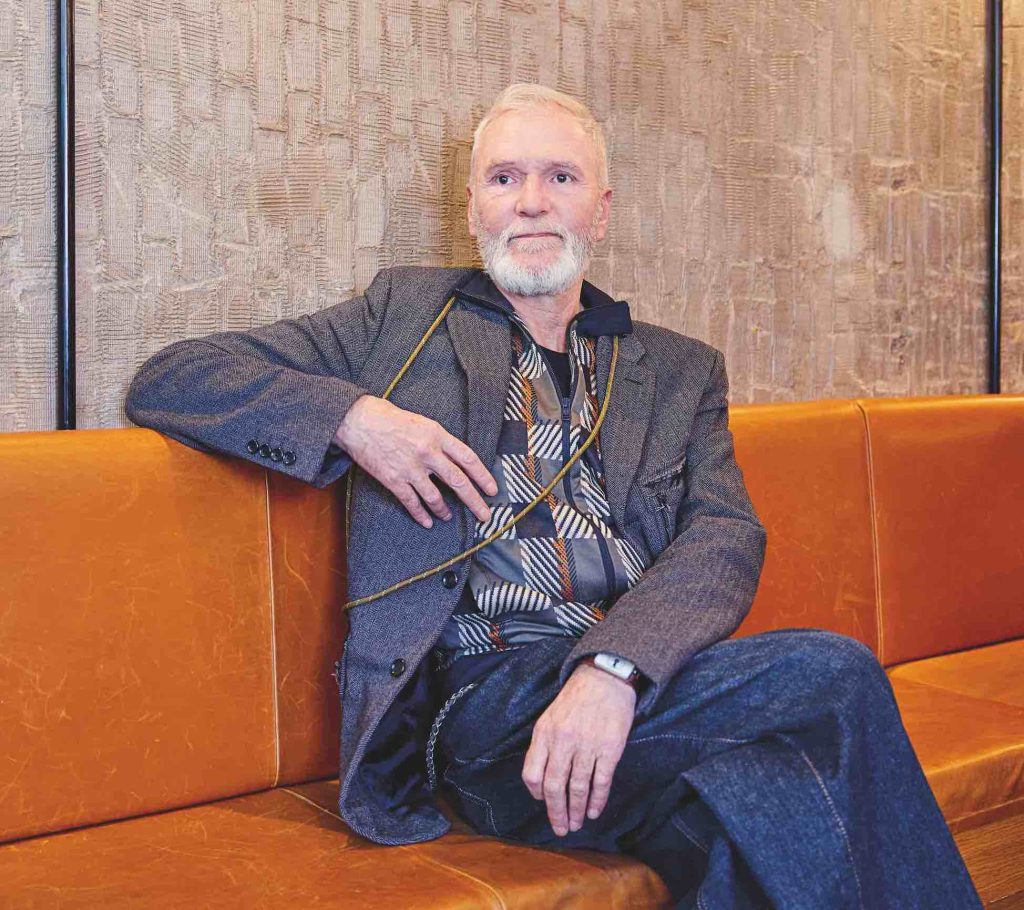[Interview à lire dans le magazine têtu· du printemps] Les récits de Vincent Dieutre, aussi intimes soient-ils, entrent en résonance avec nos vécus, notre époque, et la culture européenne au pluriel. En trente ans, ce cinéaste gay singulier a tourné plus d'une vingtaine de films de voyage, d'admiration et de désir.
S’il est assez facile de passer à côté de Vincent Dieutre, dont le cinéma d’auteur à la première personne s’est constitué avec les années un public d’avertis, il devient rapidement impossible d’en oublier, une fois croisés, les récits, les images et le timbre de la voix. À 63 ans, le réalisateur n’a jamais cessé d’être un homme de son temps, cherchant dans la forme même de ses films à dire quelque chose du monde où ils s’inscrivent. Un monde où les arts, des peintures du Caravage aux mélodies de Schubert, dialoguent avec le présent et s’y frottent pour en tirer du sens, toucher le contemporain, le "nerf de l’époque".
À lire aussi : Slimane, Eurovision, 40 ans de lutte anti-sida… au sommaire du têtu· du printemps
Cinéaste du voyage, dont les docu-fictions s’inscrivent dans des territoires précis de culture européenne – l’Italie, beaucoup, depuis son premier film, Rome désolée, mais aussi l’Allemagne à travers son Voyage d’hiver –, quand il n’en cherche pas les échos en Argentine (Después de la revolución) ou aux États-Unis (This Is the End), Dieutre est également un cinéaste de l’exil, de l’arrachement, de la solitude et des rencontres qui tentent d’en venir à bout. Dans ses films, nombreux sont les hommes qu’il a aimés, souvent avec passion, avant que la vie ne les sépare et que le cinéma leur donne l’occasion d’écrire une nouvelle page ensemble.
Vincent Dieutre est peut-être avant tout un cinéaste du désir. Ce désir qui le pousse à toujours reprendre la route, à rester curieux, à s’enfoncer toujours plus dans une subjectivité voulue à la recherche de commun. “Tu te demandes souvent quel est ton peuple, dit-il en voix off dans Leçons de ténèbres, tandis que la caméra filme en pleine nuit la place du Peuple, à Rome, depuis une voiture, dans un long plan-séquence. Au fond, tu le connais bien. Le petit peuple imprécis de ceux qui une minute, une semaine ou une année t’ont désiré, aimé, t’ont donné la vie. Comme tu les as aimés toi aussi, et comme ils te manquent tous maintenant. André, Alain, Antoine, Antonio, Ahmed, Armin, Bernard, Berthold, Benoît, Bruno, Bob, Barth, Boris, Colin…” Jusqu’à ce que les prénoms se superposent au point de disparaître sous leur propre nombre, comme si nous devions, tous, figurer parmi eux.
- En regardant vos films et tous les hommes qui les peuplent, on est frappé par l’intensité de ces amours successives…
Ah oui, c’est très lié à l’homosexualité je pense. Je m’en rends compte maintenant, avec le temps : effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont traversé ma vie. Ça s’empile, et ça finit par former comme une espèce de famille. En général, quand je fais un film avec quelqu’un, c’est vraiment qu’il y a eu quelque chose de fort. Et ce sont des gens qui ne sont pas forcément acteurs, donc ça donne une espèce d’abandon que je trouve formidable.
- Placer une relation avec un homme au cœur du film, en plus de fournir un processus de narration, n’est-ce pas aussi une manière de garder des souvenirs ?
Bien sûr. Avec Dean, dans This Is the End, ça a créé quelque chose d’irréversible : tant qu’on pourra voir le film, il y a cette trace de lui. Mais c’est aussi une façon de mesurer le temps, parce que chaque relation correspond à une époque, elle-même liée à un territoire. C’est l’une des questions fondamentales de mes films : qu’est-ce qu’un Européen, qu’un gay européen ou qu’un artiste européen… C’est pour ça que j’appelle Voyage d’hiver ou Leçons de ténèbres des films d’Europe.
- C’est aussi le cas du dernier, This Is the End, bien qu’il se situe en Californie ?
En effet. Il s’agit là aussi de tout ce qu’on amène là-bas, à Los Angeles, qui renvoie à la culture européenne. De même qu’Orlando Ferito, qui se déroule du côté de l’île italienne de Lampedusa, avec l’arrivée des migrants. C’est la grande question : comment on peut faire communauté avec des gens qui ne parlent pas la même langue, et faire que ces différences deviennent une richesse. Même quand je vais aux États-Unis ou à Buenos Aires, j’y recherche des traces, des échos de cette culture européenne.
- Qui chez vous apparaît plutôt déliquescente…
J’y pense beaucoup à cause de Pasolini, dont la grande thèse est de dire que la catastrophe n’est pas pour demain mais qu’on est en plein dedans. Cette idée d’assumer que “c’est la fin”, c’est pour ça que le film s’appelle This Is the End. Ça ne sert à rien de se morfondre : la fin est déjà derrière, et l’idée c’est d’assumer que rien ne va au sens propre du terme, et qu’il est de plus en plus difficile de tirer des utopies des horizons politiques et de faire bouger un pays entier. Il y a souvent dans mes films une analyse du monde assez pessimiste et plutôt radicale, avec une critique foncièrement politique des systèmes tels qu’ils existent.
- Tourner des autofictions vous permet de jouer avec ce réel ?
Je crée du vrai, justement, en jouant avec le réel. C’est un peu tricher, mais en même temps à partir du moment où l’on concentre toute une période en une heure trente, il y a forcément une organisation. Même dans le journal intime le plus précis, ce n’est pas la réalité, ce sont des bribes, des bouts.
- Ce serait en faisant entrer en collision tous ces bouts qu’on parviendrait à dire quelque chose du monde qui nous entoure ?
Mon idée, c’est de toucher le nerf de l’époque, de ne pas juste traiter un sujet mais de prendre mon expérience et d’arriver à mettre en images ce qu’elle a d’hyper particulier. Et en même temps, comme disait Proust, c’est de là que jaillit le général. C’est-à-dire ne pas penser qu’il y a une espèce d’objectivité sur quoi que ce soit, mais que la subjectivité poussée à fond est viable. En tout cas, je suis obligé d’être très sincère dans ce que je raconte, parce que je pense qu’on ne peut pas réussir dans cette économie très pauvre si on ne donne pas vraiment quelque chose, si on ne paye pas de sa personne.
"En plus du cinéma commercial et celui d’auteurs établis, il y avait tout un continent de films d’artistes ou d’écrivains."
- Est-ce le sens du "Tiers cinéma" que vous avez théorisé ?
C’est un concept que j’ai défini dans un texte au début des années 2000, à une époque où le documentaire de création était un peu oublié. En gros, on s’est rendu compte qu’en plus du cinéma commercial et celui d’auteurs établis, il y avait tout un continent de films d’artistes ou d’écrivains. Et c’est là, pour moi, où il se passait vraiment quelque chose. Godard venait de terminer Les Histoires du cinéma (1998) et Sophie Calle, No Sex Last Night (1996)… Chaque film se devait d’être une prise de risques formelle, de ne pas s’intéresser qu’à l’histoire et au scénario. Avec le numérique, les minorités se sont très vite emparées de cette possibilité, notamment les femmes et les gays.
- Sexe, drogue, intimité… Vous y êtes allé fort dès votre premier film, Rome désolée, en 1995…
Je l’avais fait à la première personne, comme une bouteille à la mer. D’ailleurs beaucoup disaient que je n’en ferais pas un deuxième parce que c’était tellement excessif dans l’aveu. C’est vrai que ça aurait pu être un one shot et puis je me suicide après… Mais non, justement d’ailleurs, le film a aussi eu un côté thérapeutique pour moi. Il y a des festivals gays qui ne voulaient pas le passer parce que ça liait trop la drogue et l’homosexualité.
- Aujourd’hui vous êtes régulièrement sélectionné dans des festivals gays…
Même si je ne parle pas au nom d’une communauté, je fais quand même partie de ce milieu. Et je pense que la position minoritaire des gays – et des artistes de manière générale – devient de plus en plus pertinente. On est un peu le laboratoire sociologique du futur. Ce qui m’intéresse, c’est de traduire cette expérience en images, de la façon la plus juste possible, pas simplement en faisant parler des acteurs mais en pensant la structure même du film, en cassant les rythmes, en jouant du off, du in…
- Vous ne parlez jamais de votre enfance, pourquoi ?
Pour moi ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment partageables. Tout ce qui m’a été donné, que je n’ai pas choisi, je ne le filme pas. C’est vrai qu’il y a un silence absolu sur l’enfance. Tout naît avec le désir, quoi.
- Dans Leçons de ténèbres vous dites : “Les années 1990 commencèrent plutôt mal. Revenu à la vie tu n’as fait que tester les autres, les choses.” Vous faites référence au VIH ?
Absolument. J’en ai parlé dans pratiquement chaque film, mais c’est encore plus clair dans Mon voyage d’hiver. En plus, comme je sortais de l’héroïne, j’avais un double risque d’être contaminé. J’ai fait un test pour la première fois quand je suis parti en Angleterre en 1990 pour suivre une cure de désintox… Et miracle, rien du tout. Donc après je me suis calmé. Je ne sais pas si la nouvelle génération se rend compte de tout ça, de tous ceux qui y sont passés, et ceux qui ont survécu mais dont ça a bouleversé le rapport à l’existence.
- Quels sont vos projets aujourd’hui ?
Tout d’abord je vais faire prochainement un téléfilm hommage à la cinéaste Chantal Akerman. J’avais ce film en projet depuis longtemps, mais les choses se sont débloquées depuis que Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles a été élu meilleur film de l’histoire du cinéma. Je l’avais vu à 14 ans et, même si ce n’est pas mon préféré de Chantal, je ne ferais pas de cinéma sans lui. Ce fut une révélation, à tous les niveaux.
- Chantal Akerman est aussi une cinéaste queer …
On ne s’en rendait pas tellement compte à l’époque. Je, tu, il, elle était un film incroyablement libre, avec cette scène de sexe entre deux filles très jeunes, en plan fixe. Sinon j’ai un autre projet, qui est beaucoup plus personnel puisque je vais retourner en Angleterre, là où j’ai fait une cure de désintox il y a trente ans – ça tourne beaucoup autour de la peinture, avec des aquarelles de Turner, du brouillard, l’Angleterre quoi. Et un troisième, un gros projet, lui aussi très queer, qui est plus dans la lignée de Fragment sur la grâce. Ce sera une sorte d’enquête autour de Saint-Just et de la Révolution.
"Il ne faut surtout pas trop muséifier les œuvres, parce que c’est ainsi qu’on leur enlève ce qu’elles ont de subversif."
- Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette époque ?
Il y a cette volonté de tout changer. Bon, après il y a eu des dérives, mais quand même tout vient à ce moment-là : l’abolition du crime de sodomie, et puis la Constitution, les juifs, les vieux, les bâtards, les protestants, les femmes, les musées, les conservatoires, l’école, le divorce… Et il y a cette ambiguïté de Saint-Just. C’était un jeune homme de 25 ans, à Paris… À l’époque, pour l’attaquer, on disait que c’était un inverti, et Danton, qui l’avait fait suivre, disait qu’il allait aux Bains chinois – je pense que c’était l’équivalent des saunas gays d’aujourd’hui. De ça, les historiens ne parlent jamais.
- Dans vos films, vous faites jouer aux arts un rôle de médiateur par la beauté, par l’émotion que suscite la beauté. Vous ne craignez pas de passer pour élitiste ?
Je pense que n’importe quel gamin de n’importe quel collège de banlieue a droit au Caravage et à Schubert. Tout le monde y a droit, ce n’est pas uniquement, comme dirait le sociologue Pierre Bourdieu, un capital culturel que j’expose pour me différencier. C’est au contraire dans l’idée d’une remise en commun de cette beauté. Il ne faut surtout pas trop muséifier les œuvres, parce que c’est ainsi qu’on leur enlève ce qu’elles ont de subversif. En Italie, on trouve la peinture ténébreuse du Caravage dans les faubourgs de Naples. Pour moi, il ne s’agit pas de remettre les artistes dans leur époque, mais plutôt de les réinjecter dans quelque chose d’actuel.
À lire aussi : Avant "Anatomie d'une chute", redécouvrez Swann Arlaud en amant gay de Duras
Crédit : Audoin Desforges