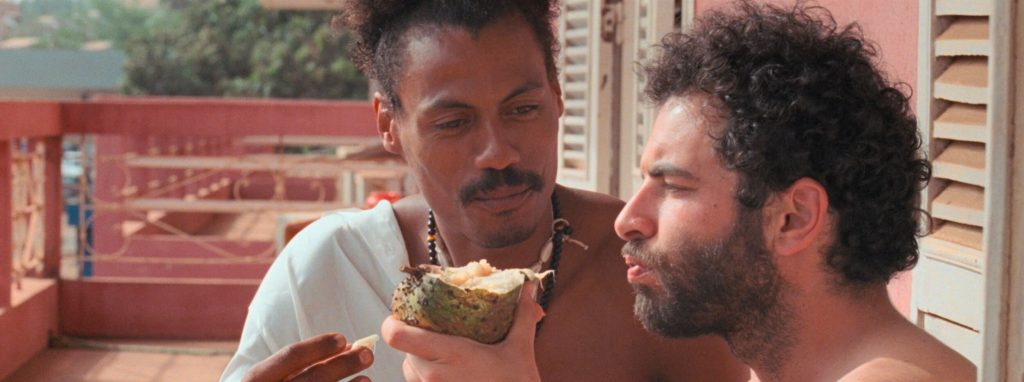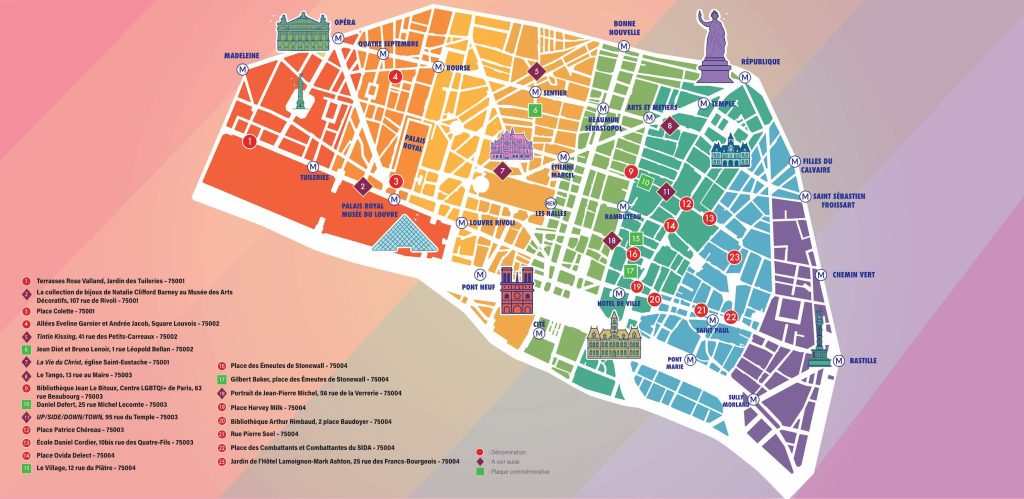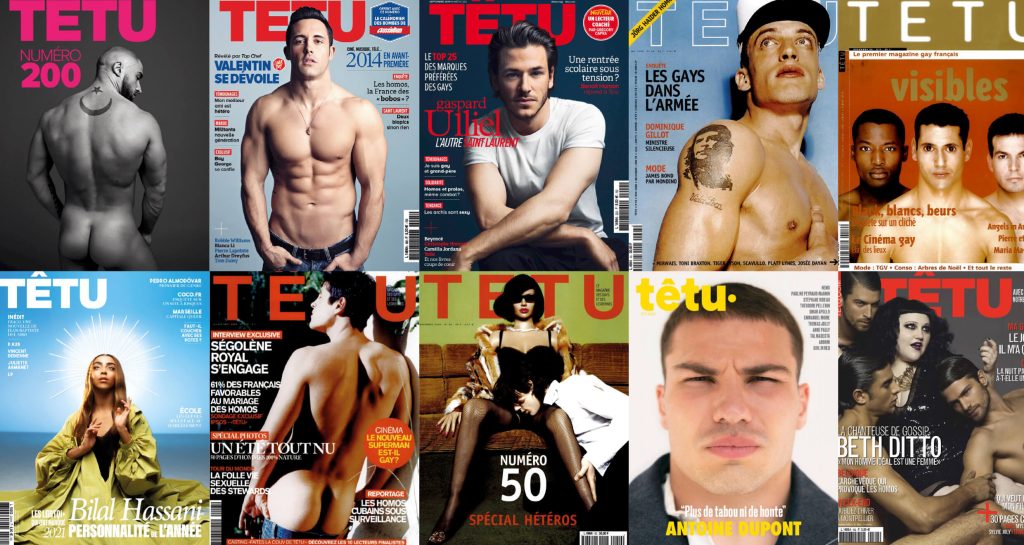À la fin du XXe siècle, le monde est enfin prêt : des films queers positifs arrivent en salles et connaissent même des succès populaires. Parmi eux Billy Elliot, But I'm a Cheerleader et Cecil B. Demented.
Il y a 25 ans, Britney Spears envahissait les radios avec son tube "Oops !… I Did It Again", tandis que la télévision française commençait à diffuser Queer as Folk (la version originale ; le remake américain, sorti en 2000 outre-Atlantique, n'arrivera en France qu'en 2005). Au cinéma, le monde fait la rencontre d'un jeune garçon pas comme les autres : chaussons de danse autour du cou, il dévale de ses pas déchaînés les rues d'une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre.
À lire aussi : Hafsia Herzi adapte avec grâce "La Petite Dernière" de Fatima Daas
Billy Elliot est un enfant de 11 ans que son père destine à la boxe, mais qui est pris de passion pour la danse, un "sport de fille". En plus de ce schéma – attendu aujourd'hui mais pas à l'époque –, le réalisateur Stephen Daldry situe l'action en 1984, pendant la grande grève des mineurs de fond contre le gouvernement de Margaret Thatcher qui veut fermer les fosses. Dans ce paysage de violences sociales, nul espoir : les enfants de prolo deviennent à leur tour des prolos, les hommes font de la boxe, les femmes restent à la maison… Mais Billy découvre les cours de Mrs. Wilkinson, et soudain son cœur de garçon bat pour le ballet.
Envers et contre tous, le jeune danseur s'extirpe des codes virils pour trouver, à travers l'expression du corps en mouvement, son échappatoire. Sa rébellion face à son père se déploie sous les yeux admiratifs de son ami Michael qui en pince secrètement pour lui. "Ce n'est pas parce que je fais de la danse que je suis un pédé, tu sais ?" lui lance maladroitement Billy, inquiet. Dans une scène enneigée pleine de tendresse, son camarade lui dépose un baiser sur la joue ; baiser que le héros lui rendra à la fin du film.
Par sa thématique et la sensibilité du tout jeune comédien qui le porte sur ses épaules – Jamie Bell, choisi parmi 2000 autres adolescents au cours de sept auditions –, Billy Elliot devient le dernier classique queer du XXe siècle, annonçant le nouveau millénaire (il sort en France le 20 décembre). D'abord présenté sous le titre Dancer à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, le film décroche trois nominations aux Oscars et attire plus de deux millions de spectateurs en France.
Les garçons sensibles – mais pas seulement – s'identifient à ce personnage symbole de liberté et d'émancipation. Les années suivantes, le monde de la danse observe même l'apparition d'un "effet Billy Elliot" : de plus en plus de jeunes hommes poussent les portes des écoles de ballet. L'engouement se prolonge jusque sur les planches où une comédie musicale, entièrement composée par Elton John, voit le jour en 2005. Le côté subversif du scénario n'échappe évidemment pas aux réactionnaires. En 2018 encore, l'Opéra d'État hongrois, à Budapest, annule quinze représentations du spectacle après qu'un éditorialiste d'un journal conservateur a accusé le héros de "promouvoir" l'homosexualité auprès des enfants.
But I'm a Cheerleader
En 2000, un autre film s'attaque aux stéréotypes de genre avec un style radicalement différent : But I'm a Cheerleader, de Jamie Babbit. Malheureusement, les distributeurs ont été frileux et la France ne l'a découvert qu'en 2004. Suspectant leur fille d'être lesbienne, les parents de Megan (Natasha Lyonne, qui prendra la lumière avec la série Orange is the New Black), une lycéenne pom-pom girl, l'envoient à True Directions, un établissement chargé de "corriger" son orientation sexuelle. Dans l'enceinte de ce centre, tout est fait pour que les patients rentrent dans le "droit chemin" : les filles portent du rose, les garçons du bleu, et tous sont soumis à des activités qui renforcent les pires clichés – stages de mécanique pour les uns, tâches ménagères pour les autres. Mais la "thérapie de conversion" se transforme vite en coming in : au contact d'une autre fille, Megan va vite découvrir son homosexualité. À noter l'apparition de RuPaul – qui était déjà la drag queen la plus célèbre au monde – en prof de sport homosexuel repenti dont le t-shirt proclame "straight is great" ("l'hétérosexualité c'est génial").
Mais la fantaisie joyeuse de But I'm a Cheerleader ne plaît pas à tout le monde, y compris au sein de la communauté. "À une époque où les homosexuels et les lesbiennes continuent de faire face à des préjugés donnant lieu à des agressions à la fois politiques et physiques, il est difficile de trouver quoi que ce soit de très drôle dans le film", écrit le critique de cinéma du Los Angeles Times Kevin Thomas, ouvertement gay. "La communauté était tellement affectée par l'épidémie de sida qu'il n'y avait pas beaucoup de comédies dans le cinéma gay, expliquera la réalisatrice, elle-même lesbienne, dans Variety, consciente du décalage entre son film et l'époque. Les gens étaient furieux que je puisse rire d'un sujet aussi sérieux."
Cecil B. Demented
Son irrévérence et son sens de l'absurde, But I'm a Cheerleader les doit au pape du cinéma queer, John Waters (Pink Flamingos, Hairspray), dont l'influence est perceptible tout au long du film – on y croise même une de ses actrices fétiches, Mink Stole. En plein été 2000 sort justement en France le très barré Cecil B. Demented. Avec cette histoire d'enlèvement d'une actrice (Melanie Griffith) par une bande de cinéastes underground, John Waters déclare la guerre à Hollywood et à son univers aseptisé, assoiffé de "normalité". Lors de sa sortie, des critiques pointèrent la faiblesse de sa réalisation et de son scénario, qui contribue pourtant à faire de Cecil B. Demented, évocation queer et presque nostalgique de l'esprit Jackass de la fin des années 1990, un film culte.
Crédit photo : BBC Films