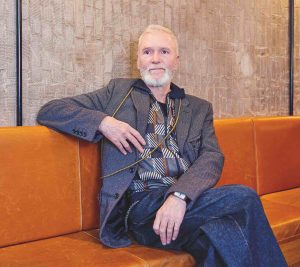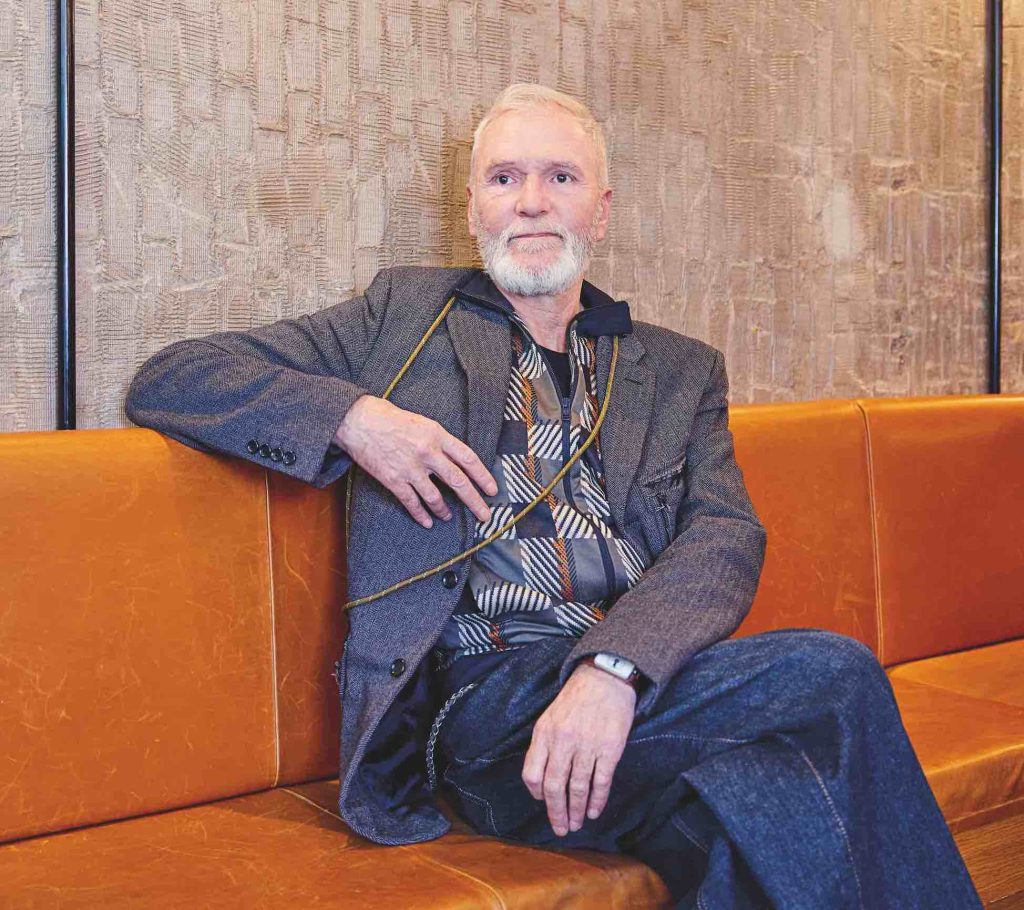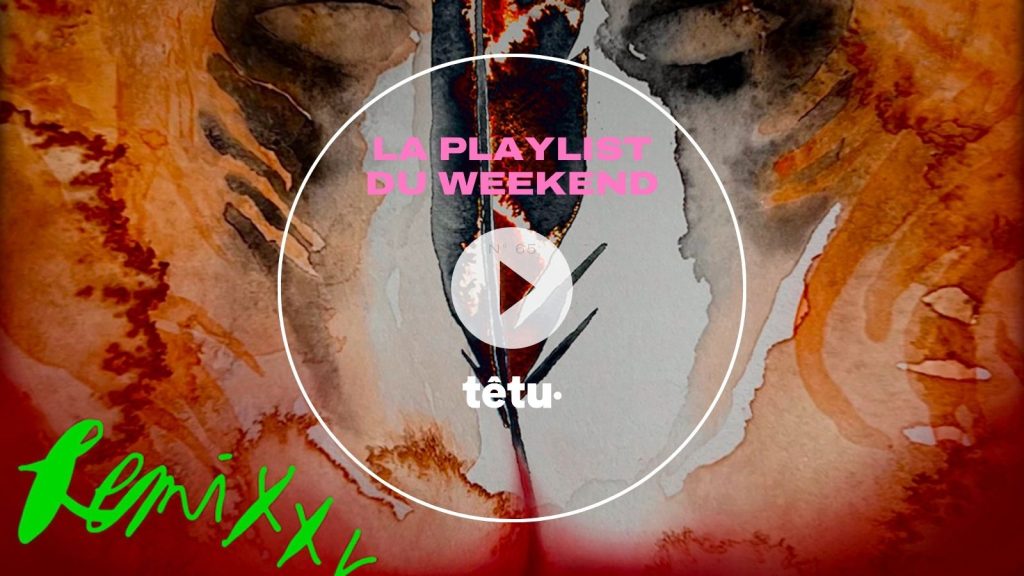Après l’immense "Moonlight", Barry Jenkins adapte un roman de l'Américain noir et ouvertement homosexuel James Baldwin et saisit le quotidien des afro-américains par la splendeur universelle du mélo. Un très grand film, audacieux et engagé, sur l’Amour fou comme rempart à la haine.
Barry Jenkins et James Baldwin : deux auteurs à la fois pudiques et mélodramatiques, deux hommes noirs, l’un hétérosexuel, l’autre homosexuel, qui utilisent leur art respectif pour porter la voix des minorités. Si avec "Moonlight", Jenkins avait réussi à faire entendre le travail du dramaturge afro-gay Tarrel Alvin McCraney au monde entier (avec à la clé une pluie très méritée d’Oscars), il s’attaque avec "Si Beale Street pouvait parler" (roman culte sur l’Amérique noire des années 1970) au style à la fois simple et très poétique de Baldwin. Le défi était de taille, la réussite est totale.
D’une rare maîtrise, le film sidère par sa beauté évidente, sa profondeur et sa justesse, son attention si particulière aux détails et sa façon délicate et si puissante d’être en colère. Dans les pas et les pensées d’une amoureuse (Tish, géniale Kiki Layne), le film saisit d’un même élan l’état de grâce de son amour pour Fonny (Stephan James), que l’état d’urgence qui la saisit lorsque ce dernier est accusé d’un viol qu’il n’a pas commis, par un flic raciste.
Amants maudits
Fragmenté, le récit compose un kaléidoscope de sentiments, de situations et de scènes qui, au départ, peuvent sembler disparates, perturbantes, pour quiconque viendrait ici chercher un énième film explicatif sur le racisme aux Etats-Unis. Ce n’est pas un film édifiant que cherche à faire Jenkins, non, c’est un film furieux, sentimental, universel, un film qui nous rappelle que la raison première pour se battre contre la haine, c’est l’amour de ceux qui nous sont chers.
Autour de ses amants maudits, une famille relève la tête. Ponctué de longs regards-caméras, le film, hyper sensuel et quasiment sensoriel, redonne un corps et un visage à l’Amérique des bafoués. Offrant à chacun de ses personnages une dignité, une profondeur rare (jusqu’à la victime de cette agression dont la parole est traitée avec délicatesse), le film n’élude jamais la violence du racisme. Mais, monté et pensé comme une rhapsodie, comme un morceau de jazz intérieur, le film suit la voix de Tish ( ses souvenirs, ses colères) pour prendre la forme de sa fierté. C’est bouleversant.
Evidemment, le racisme et les discriminations de l’Amérique des seventies résonnent avec l’état contemporain de notre monde. Mais Jenkins n’a même pas besoin d’insister. En offrant aux spectateurs d’aujourd’hui la grâce et la force de cette histoire d’amour universelle, la beauté inspirante de ces héros debout malgré tout, le cinéma démontre que, de l’indignation à la consolation, le cinéma est encore heureusement là pour nous rendre meilleur.
Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.
Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins avec KiKi Layne et Stephan James. En salles mercredi 31 janvier 2019.
Crédit photo : Annapurna Pictures