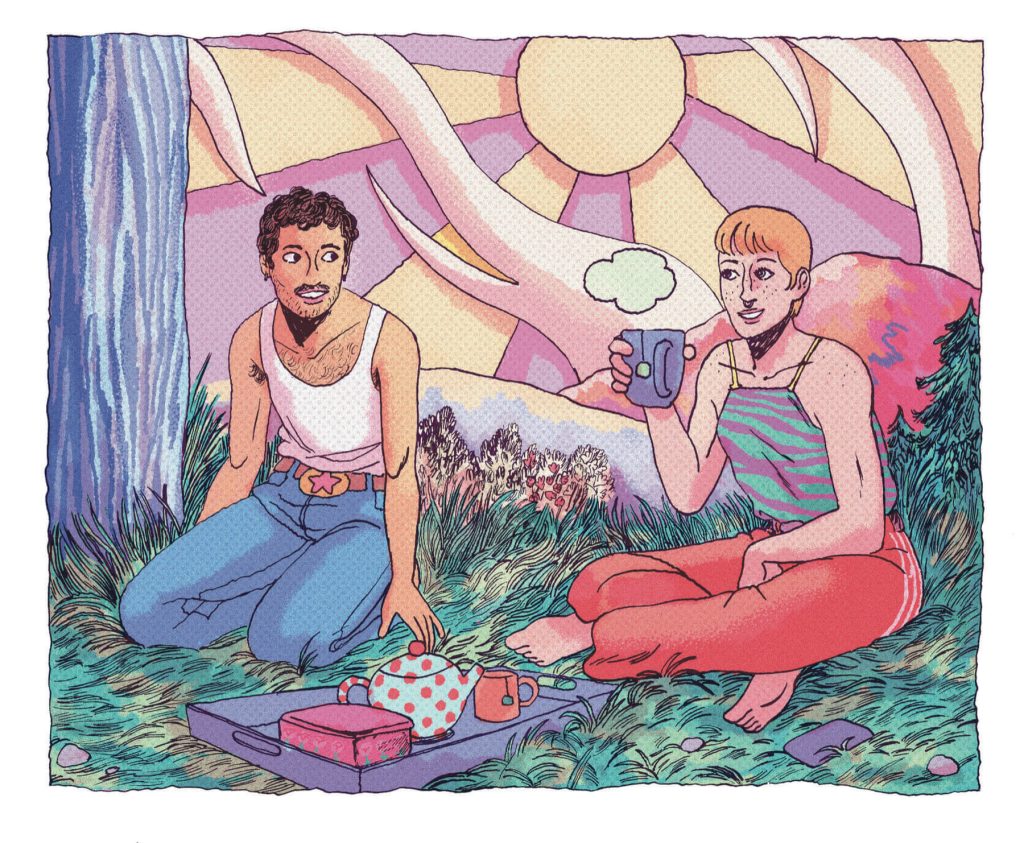MA STORY. Certains trouvent la calvitie très sexy. Mais parfois, pour ceux qui la vivent, elle peut-être un vrai problème. C'est le cas de Marceau*, qui nous avait déjà raconté son pire rencard Grindr. Cette fois, il nous raconte le traumatisme de la chute des cheveux. Et sa greffe, en Turquie.
Dans cette rubrique, vous pouvez raconter une histoire ou une anecdote de votre vie queer, de votre expérience de la masculinité ou de la féminité, ou de votre vie sentimentale ou sexuelle, qui vous a marqué pour le meilleur ou pour le pire. Pour cela envoyez nous vos textes par ici !
Dans les cheveux, on décèle l'identité. L’ADN. Le patrimoine génétique. Dans une mèche, on lit les six derniers mois de consommation. Parce que le cheveu confesse tout. Les nourritures, les substances, les blessures. Les traces de plomb et d'arsénique retrouvées dans les corps de Beethoven et Napoléon. Le cheveu trahit. Voilà pourquoi le chauve enfile un chapeau et le ravisseur une cagoule. Le cheveu révèle toujours qui on est.
Quand je découvre ma chute de cheveux, j’ai 22 ans. C’est un âge intense. A l’époque, mes cheveux sont bruns clairs. Ils ont foncé, année après année, sans me consulter. Au début
de cette histoire, je suis étudiant. J’apprends le droit, les lois, je dis aimer ça mais comme beaucoup, je fais semblant. Moi ce que je préfère, c’est marcher, grandir, jouer l’homme pressé et à mon image, mes cheveux me ressemblent. Je les colle en arrière, sur le côté, une raie quelque part, ou alors je laisse facilement une mèche me fissurer le visage façon barbelés. En somme, mes cheveux peuvent faire ce qu’ils veulent parce que je les pense éternels.
Alopécie androgénétique
Tout cesse un matin. Un matin, devant le miroir, quand, pour la première fois, je m’aperçois d’une forme claire sur le dessus du crâne. Une ombre qui rôde. Un endroit fantôme, qui murmure que quelque chose en moi s’interrompt à jamais. Très vite, je pars consulter un dermatologue. Dans une bâtisse lyonnaise, le type me reçoit, m’ausculte et son diagnostic ressemble à une condamnation ferme.
- Vous êtes atteint d’une alopécie androgénétique. Une calvitie.
Cet espace, cette blouse jaunie, ces yeux de renard, ce long mur tapissé de photos souvenirs du Marathon de Boston. Je m’en souviens comme ci c’était hier. C’était il y a dix ans. Désormais, je vis avec ma calvitie depuis une décennie. Pour lutter contre la chute, je lis. Des livres, des revues, des sites experts sur le cheveu. J’apprends mille choses. Une chevelure normale compte environ 120 000 à 150 000 cheveux, soit 6m2 en surface habitable. En moyenne, cinquante à cent cheveux tombent chaque jour. On dit que c'est normal. Cent cheveux, tout va bien, tout est en ordre, mais combien de cheveux meurent pour moi ? A vingt-sept ans, ma chute de cheveux s’accélère drastiquement. Mes cheveux restent dans ma main, comme des soldats paresseux et pour moi, bientôt trentenaire, chaque cheveu qui tombe est un cheveu qui compte.
Prêt à tout pour mes cheveux
Nuit et jour, je me réfugie sur Internet d’où l’on évoque trois traitements. Une lotion appelée minoxidil, une pilule, le Propecia, à base de finastéride qui permet d’inhiber la 5- alpharéductase, enzyme responsable de la chute, et dernier recours, l’opération d’implants capillaires. Sur les forums, le médicament Propecia a mauvaise presse. On parle de risques dépressifs, de chutes de libido, de pilosités excessives, même de suicides, et je suis prêt à tout pour mes cheveux, sauf finir en loup-garou écrabouillé sur le toit d’une Opel Corsa.
Longuement, je pèse le pour et le contre. Je fais des calculs d’échantillonnage. Idée noire contre cheveu brun, cela vaut-il le coup ? Dans une pharmacie en plein Paris, une employée me
donne la réponse : "je ne conseillerais pas ce médicament si vous étiez mon fils". Sa tirade m’anéantit et ce jour-là, je repars de la pharmacie sans Propecia mais avec la fameuse lotion 5% entre les bras. J’étale le minoxidil, matin et soir, durant cinq ans, précautionneux, visant les golfes, l’arrière du crâne, entre les tempes, comptant jusqu’à sept pour atteindre le nombre
journalier de pulsations. Le cheveu repousse et cela ressemble à un début de victoire. Mais l’illusion n’a qu’un temps. Les effets s’arrêtent brutalement. Retour à la case départ.
Ma vie change de trajectoire. Je suis un homme dégarni. Et dégarni, je ne vais plus à la piscine. Encore moins à la mer. J’évite les trajets en bateau, en décapotable et tout autre engin
qui me mettrait face au vent et aux autres éléments. Je ne sors plus sans une bouteille de laque puissance 8 dans le sac. Au restaurant, je fais face à la salle. J’évite en public les miroirs. Les courants d’air des métros. Les mouvements de foule et l’imprévisible.
Greffe de cheveux
Il y a trois mois, je pars à Essaouira. Je n’y attends rien d’un grand voyage. Après l’écriture de mon dernier roman, j’y aspire à une semaine de trêve. Le matin, je fais du sport dans cette grande salle cernée de miroirs. Tout autour, des hommes chevelus, déterminés, confiants, beaux à s’en ronger les ongles. Au milieu de l’arène, je cours, je vois mon visage, mon reflet, mes cheveux dégarnis. Et voilà le déclic. Faire une greffe de cheveux le plus vite possible. De retour à Paris, je suis dévoré à l’idée de faire des implants. J’en parle à la Terre entière, à mes amis, voisins, concierge. Je tape les premiers mots clés sur le moteur de recherche. Greffe, implants, cheveux, capillaires, cliniques, médecins, devis, consultations, résultats. J’y passe des nuits et des poussières. Je découvre les différentes méthodes de greffe. Méthode FUT, FUE, Sapphire, DHI/CHOI. Sur ces pages mal traduites, je lis sans rien comprendre. Trois jours à décrypter. Décrypter que la FUT est une méthode depuis longtemps dépassée, que la FUE, par extraction d’unité de greffon, ressemble à s’y méprendre à la DHI et que les différences entre les deux sont assez minimes (stylet d’utilisation, parfois cicatrisation, volume utilisé).
D’un geste, je contacte quelques cliniques. Je choisis les premières sur la page Google, ces cliniques françaises qui avertissent en première page du danger des cliniques turques.
J’ai déjà un faible pour celles du 17e arrondissement et de Neuilly parce que c’est chic, Neuilly. Parce qu’il n’y a jamais d’ordure sur les trottoirs, pas d’attentat au couteau et peut-être
même, pas d’homme chauve. Les premiers devis français tombent.
On me répond que cela couterait 10.000 euros.
- C’est hors de prix.
- Oui, monsieur.
- Avec rasage du crâne ?
- Avec rasage. Obligatoire.
- 10.000 vous dites ?
- 10.000, oui.
- Vous savez ce que je gagne par livre vendu ?
- Pardon ?
En route pour la Turquie
En raccrochant, je clique sur les sites turcs. L’un m’interpelle. Il s’appelle Elithairtransplant et malgré ce nom tiré par les cheveux, cette clinique située à Istanbul dispose d’un site
web et d’avis internautes impeccables. Je me dis qu’ils sont sûrement faux, achetés ou bien voilà. Mais je contacte la clinique par mail. Je ne pense plus qu’à ça. L’image du remède. La fin du tunnel.
Il est onze heures et alors que je rentre chez moi, des sacs de légumes verts dans les bras, un numéro m’appelle. Il s’appelle Sébastien. Il est chargé d’accompagner les clients français au nom d'une clinique turque, et la première chose que je me dis, c’est que Sébastien est un nom d’emprunt. Au cours de la conversation, je réalise que comme ces cliniques françaises mensongères, j’associe l’étranger au danger.
De jour en jour, Sébastien répond à mes questions. Opération, hôtel, chauffeur, chapeau post-greffe. Mais peureux, je tergiverse. Sébastien s’arme de patience, répète des listes et des listes d’instructions tandis que je continue de palabrer à propos de ce chapeau post-opération hideux. Mais un soir, alors que je sors d’une séance de méditation Petit Bambou, je me
décide, clique sur répondre, choisis la date du 23 juin. Dans la foulée, je réserve mes billets d’avion.
Sur mon siège low cost, je passe les trois heures du vol à écrire et en boucle, je repense aux instructions, au chapeau, à l’homme qui m’attend au café façon film d’espionnage. A l’atterrissage, le type est là, sa pancarte à mon nom brandie dans les airs. Sans parler un seul mot d’anglais, il patiente avec moi jusqu’à ce qu’un van se gare.
Salle d'attente
Pour se rendre à la clinique, il faut compter entre une et trois heures, selon traffic. Il faut traverser la ville étalée sur deux continents, saisir rocades et autoroutes, prendre son mal en patience. Il est presque 21h. Et même au milieu d’une voie rapide, Istanbul ressemble à une splendeur. Dans l’hôpital, j’entre, la peur au ventre. Je demande ma route à un guichetier de nuit qui, lui non plus, ne parle pas anglais mais qui me désigne son front en me disant transplant, transplant ? Au bout d’un couloir, une femme blonde récupère mon passeport, me fait signe de la suivre pour procéder aux examens sanguins et me donne l’heure de ma greffe. 8h30.
A Istanbul, le ciel est clair et j’ai très mal dormi. Dans le van qui me conduit vers mes cheveux, je retrouve les trois hommes qui attendaient hier soir dans le hall de l’hôpital universitaire. Un allemand à peine dégarni, un footballeur espagnol aux mollets de petit poulet et un autre plus bien âgé, un Japonais venu d’Osaka. Ensuite, on nous installe au 12e étage de la clinique, face à des immenses pancartes qui ressemblent à des posters d’enfance. Le vieux Japonais tente des clins d’œil pour décompresser. L’allemand est taiseux. Le footballeur scrolle sur son Instagram. Sur place, d’autres hommes vont et viennent. Ils ont des bandages sur la tête ou ce fameux chapeau post-opératoire. J’essaie de ne pas trop fixer ces hommes comme des bêtes à concours. Parce que dans quelques heures, j’en serai aussi.
Boule à zéro
Une interprète sur place m’emmène rencontrer le docteur Balwi. Un docteur discret, à la voix fluette, aimable mais réservé, à la tête de cette équipe spécialisée en chirurgie capillaire. Filmé par une caméra, le docteur Balwi m’explique le rasage, l’anesthésie, le prélèvement des greffons, l’implantation et trace au feutre une ligne sur mon front désertique. Tout va très vite ensuite. On me demande d’enfiler une blouse, et une petite femme d’un mètre soixante postée derrière moi tient dans sa main un rasoir électrique et sans attendre, me fait la boule à
zéro. Dans la chambre, il y a un lit, un bureau, une salle de bains, une grande baie vitrée qui s’offre sur la ville et des tablettes amovibles sur lesquelles deux hommes préparent leurs instruments. Pourtant pas de frisson, pas de sueur froide. Je m’allonge sur la banquette, tête offerte. Les deux hommes ne parlent pas anglais et la seule chose que je retiens, c’est que l’un porte une blouse bleue, l’autre, une blouse noire.
L’anesthésie par pulsation fait un mal de chien. Bien plus que je ne le pensais. Il faut souffler par le nez, surmonter la douleur. Les deux blouses piquent à des dizaines d’endroits. Après l’anesthésie, elles procèdent au prélèvement des greffons. Un par un. Jusqu’à 3600. Je ne sens plus rien. Dans ma tête, une sensation inédite mêlée d’un bruit d’automne ou bien d’hiver.
Un craquement, comme lorsqu’on marche sur un tapis de neige. Le prélèvement dure cinq heures. Je m’arme de patience malgré les crampes à la mâchoire et dans la nuque. Pour ne pas
y penser, je visualise l’après. Les jours chevelus qui m’attendent. La fin des névroses, des rites incompréhensibles. La fin de ma "grande maladie".
Un miracle
Il est quinze heures et je me relève, le corps en vrac. On me sert un plateau-repas que j’avale en moins de deux parce que c’est le corps qui dicte, qui réclame les nutriments et les
vitamines. D’un œil timide, je regarde les deux grands récipients dans lesquels reposent mes greffons sur ces petits carrés de coton imbibés de sang. Bientôt, ils seront sur mon crâne.
Bientôt, ils me reviendront. Je me rallonge une seconde fois. Une seconde fois, l’anesthésie, le souffle par le nez, ces secondes suspendues dans le temps où par magie, douleur devient néant. Un homme, grand comme un viking, fait son entrée et entaille mon crâne de micros trous de 0.6mm. Pour éviter toute maladresse, je dois me faire immobile. Je deviens une terre à fertiliser et 3600 trous plus tard, la blouse bleue revient.
La transplantation dure plusieurs heures. Cette fois, je suis sur le dos. Je peux écouter de la musique, des podcasts de France Culture, retrouver Sonia Kronlund ou errer sur les réseaux sociaux. Je consulte mes mails. Séances de médiation avec Petit Bambou. Je deviens zen. Tandis que les blouses implantent, je deviens bambou, mousse, lichen au fin fond du Japon. Mais une envie pressante me prend. Je demande aux blouses si l’opération est bientôt finie et ceux-là me répondent, fifteen, is ok ? Ok is ok ? Plusieurs quarts d’heure s’enchaînent. Je perds patience. Je vais me faire dessus. J’aurai bientôt plus de cheveux et zéro dignité. Combien de temps peut-on retenir une envie de pisser ? Est-ce scientifique ? Je garde mon calme parmi les nippons. Il est 20h ou presque, je ne sais plus, l’opération s’achève. Je me relève péniblement tandis qu’une jeune femme me nettoie le crâne et les éclats de sang. Je ne réalise rien. J’ai
des vertiges, des palpitations. Je fixe la baie vitrée, la ville imperturbable et son ciel au teint de lait. Un homme me fait un gros pansement et mes pieds balancent dans le vide avant de
retoucher terre, l’un après l’autre, comme après un long sommeil, jusqu’à la salle de bains.
C’est terminé. Je me répète cette phrase sans y croire, comme une monodie, un miracle. Après tant d’années malheureuses, je refuse d’y croire. Impossible. Mais le miroir est là, tout près, pour s’en persuader. Il suffit de se regarder pour y croire. Il suffit de faire un pas, jeter un oeil. Et se découvrir une nouvelle fois.