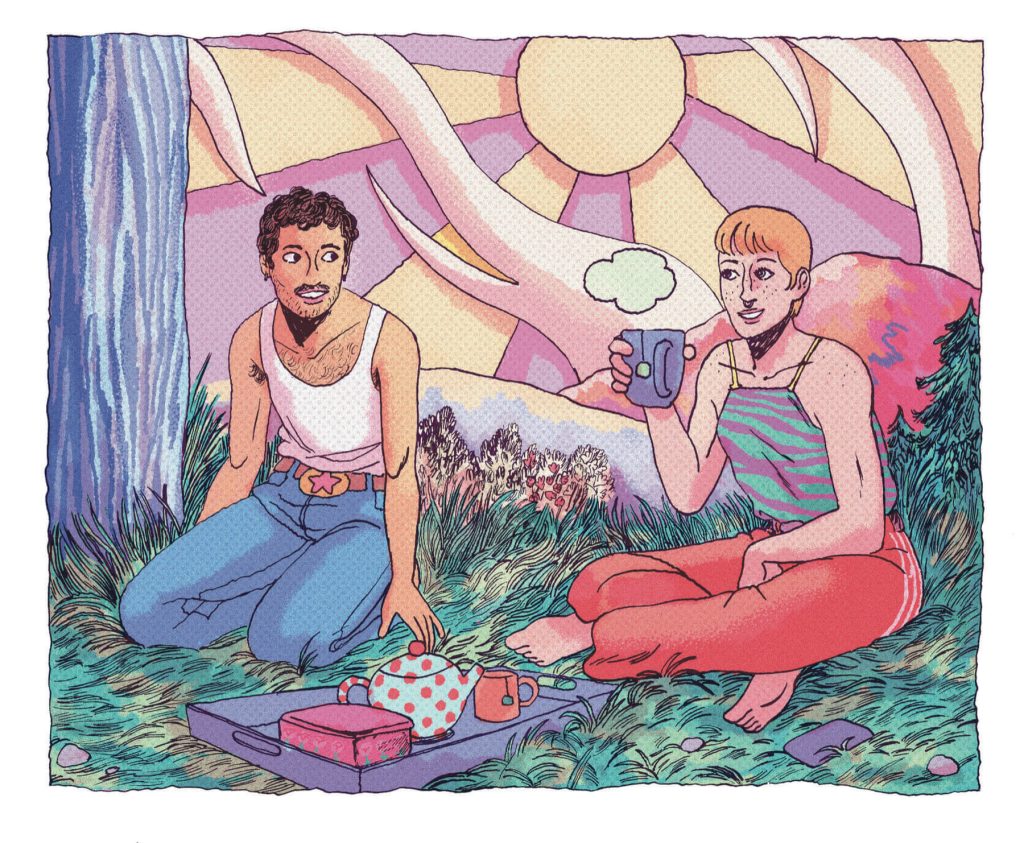De plus en plus d’hommes gays pratiquant le chemsex, en particulier le slam, perdent le contrôle de leur consommation de drogue. Parmi eux, certains en meurent, sans chiffres officiels pour mesurer le phénomène. En l'absence de politique de prévention nationale solide, les proches et les aidants se retrouvent souvent démunis.
Disparaître. Pour un marathon de sexe, pendant un, deux jours, souvent tout un week-end. Les drogues de synthèse et les “hey” qui partent à la chaîne sur Grindr ou Scruff remplacent alors volontiers le sommeil. Quand l’autre s’éclipse de plus en plus “loin” et de plus en plus souvent, le partenaire ou les proches envoient des bouées de sauvetage, puis des appels au secours, avant souvent de se résigner et d’assister, impuissants, à la valse fascinante et déprimée de l’addiction. Face au phénomène du chemsex, l’entourage des consommateurs se sent bien démuni.
À lire aussi : Dossier spécial : il faut qu'on parle du chemsex
Mon expérience personnelle a bâti les fondations de ce récit, me permettant d’accueillir avec une certaine sérénité les mots d’hommes fébriles, d’amis fidèles restés envers et contre tout “anges gardiens”, ou d’ex-consommateurs interrogés pour cet article. Mon mari, qui a 58 ans, est un “ancien” accro à la méthamphétamine – aussi appelée crystal meth, ou Tina. Cette drogue de synthèse, revenue sur le devant de la scène avec la série Breaking Bad, fait des ravages dans la communauté gay américaine depuis presque trente ans. J’utilise ici l’adjectif “ancien” avec un optimisme quelque peu naïf : je sais bien que cette partie de lui l’accompagnera jusqu’à la tombe. Si l’on en croit les conséquences irréversibles sur son corps, son esprit et sa libido, les traces du slam (l’injection de drogue en intraveineuse), pratiqué avec plus ou moins d’intensité depuis une vingtaine d’années, le définissent et le hantent.
Dans l’immense famille des addictions, celles issues du chemsex (contraction de chemical sex), c’est-à-dire le fait de consommer des stupéfiants dans un contexte sexuel, ressemblent aux autres pour les “aidants”. Amis, amants, parents, on pense tous, pendant un certain temps, pouvoir jouer les sauveurs. On appelle parfois les hôpitaux ou les dealers pour amorcer des conversations sans retour lorsque l’objet de notre affection ne donne plus de nouvelles. “On commence par aider en ami puis on finit froid, avec la distance d’un médecin qui s’attacherait aux faits, rien qu’aux faits, raconte Thomas, dont le meilleur ami est pris depuis quelques années dans une spirale infernale qui lui a fait quitter son job et ses potes avant de se terminer par une grave dépression, assortie d’une très récente embolie pulmonaire. Je suis le seul à être resté, quand tous les autres amis se sont petit à petit éloignés. La prochaine étape après cette thrombose, j’en ai peur, c’est la mort”, lâche-t-il, fatigué.
Slam et prise de risques
Alain, contacté via l’application de rencontres Scruff, a préféré se protéger. Lorsque son petit ami a commencé à fréquenter les soirées chemsex, il lui a posé un ultimatum avant, finalement, de partir. “On buvait, prenait de la coke et partouzait ensemble, c’était fun et bon enfant. Mais, à partir du moment où il a commencé à s’injecter les produits, c’est comme s’il avait cassé quelque chose entre nous, se souvient-il. Notre vie sexuelle s’est dégradée très vite, et c’est ce qui m’a poussé à fuir. J’étais déjà veuf, en partie à cause de l’addiction à l’alcool de mon ex-compagnon, et je ne voulais pas revivre quelque chose d’aussi toxique. Aujourd’hui, j’en ai un peu honte mais j’ai déménagé et bloqué son numéro, ce qui ne m’empêche pas d’imaginer parfois les pires scénarios à son sujet.” Face à des comportements devenus incontrôlables, chacun réagit comme il peut.
Comme on est une communauté qui en a vu d’autres, on apprend à laisser l’autre gérer ses démons et ses limites, car, parfois, cela suffit. “Les accidents sont de plus en plus médiatisés, mais la majorité des personnes que l’on reçoit en consultation n’a pas de difficultés à gérer sa consommation”, tentent de rassurer Pierre Cahen, sexologue, et Léon Guillou, infirmier spécialisé en addictologie. Ils interviennent tous deux au Checkpoint Paris, un centre de santé sexuelle dédié au dé- pistage et à la réduction des risques. “Comme dans toute addiction, la potentielle situation à risques va vraiment dépendre de la façon dont la personne la gère, si elle est désocialisée ou non, si la drogue l’empêche d’avoir une vie sexuelle en dehors du chemsex ou non, détaillent-ils. Il existe autant de profils que d’usagers.” De plus, un tiers des consommateurs serait des hommes séropositifs, des survivants habitués à naviguer entre les obstacles. Sur son blog, le psychanalyste Vincent Bourseul parle à ce sujet d’une “tentative de subversion de la jouissance”.
"La fréquence me fait plus peur que la potentielle toxicité de chaque produit."
L’ami/amant apprend, se renseigne, il rationalise et évite de tomber dans le piège de l’inutile guerre à la drogue, qui ne voit les usagers que par le prisme de leur rapport à l’illégalité. “Si tu commences à faire une hiérarchie entre les produits, tu ne t’en sors plus, et ça en dit beaucoup plus sur toi que sur ton mec, qui va s’éclater tous les week-ends, estime Matthieu*, dont le copain disparaît de temps en temps sans que ça le fasse flipper outre mesure. Je me fous de ce qu’il prend. Ce qui m’intéresse, c’est comment il le prend, et avec qui. La fréquence me fait plus peur que la potentielle toxicité de chaque produit.” Son analyse, que je partage, a sauvé mon mariage.
Cependant, beaucoup ne parviennent pas à se débarrasser de l’incompréhension, de l’inquiétude et de la peur, conjuguées ici avec la honte, le souvenir hantant des années sida, les stigmates intériorisés et les discours bien- veillants sur des consommations raisonnées. “Tous les types vous diront qu’ils gèrent, jusqu’à ce qu’ils ne gèrent plus du tout”, avertit Antoine*. Lui-même explique n’avoir “pas touché le sol” pendant cinq ans d’orgies. “Comme je n’avais pas un fond dépressif, que j’avais un boulot qui me plaisait et que j’étais en couple, je considère ces années comme les plus belles de ma vie. Sexuellement, c’était incomparable, assure-t-il. Mais je me suis ramassé comme une merde quand j’ai compris trois choses : qu’un accident était très vite arrivé, qu’il me serait difficile d’arrêter seul, et que j’allais perdre mon mec. J’ai dû faire le deuil de cette période où je me voyais pourtant comme un super-héros à qui rien de mauvais ne pouvait arriver.”
"Vivre et baiser plus fort"
Bien qu’il ait cessé sa consommation il y a plus de quatre ans, il en parle avec la même nostalgie nerveuse dans les yeux que mon époux, pour qui le chemsex a constitué une porte de sortie et un monde enchanteur pendant presque vingt ans. Concrètement, avec l’addiction comme barrage, nous avons mis des années à construire une relation de confiance afin que la stigmatisation liée à son état soit la plus légère possible, et que sa situation ne soit ni rédhibitoire ni une responsabilité pour moi. Mais je mentirais si je disais que je n’ai pas, plusieurs fois, pensé à prendre mes jambes à mon cou, au moins les deux premières années, notamment quand le poids de la honte était trop fort pour assumer sa vérité.
Depuis, la relation est réellement apaisée, sa consommation régulée et nos interactions très saines. Seules les conséquences néfastes d’un récent sevrage ont laissé quelques blessures sur l’aspect sexuel de notre union. L’amour, une psychothérapie et de longues soirées dans des groupes de parole ont fait le reste. “Il n’y a pas de recette miracle, me confirme cependant Pierre Cahen. Ce qui a l’air d’avoir marché pour votre couple ne fonctionnera pas forcément chez un autre.” Le sexologue aide ses patients à renouer avec une sexualité sans produits, mais en s’assurant de ne pas juger.
À lire aussi : Chemsex : où trouver un accompagnement face à l'addiction
Les cathinones (4-MEC, 3-MMC...), le GHB, le GBL, la cocaïne ou la kétamine sont désinhibitrices. Que ces drogues soient “anciennes” ou “nouvelles”, quels que soient les chemins de vie qui vous y mènent, elles (re)donnent des ailes ou simplement l’impression de “vivre et baiser plus fort”, résume prestement Benjamin*, une connaissance. Comme le décrit l’étude Attentes et parcours liés au chemsex (Apaches), produite en mai 2019 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), “le chemsex a l’épaisseur d’une expérience de vie ouvrant sur la relation à l’autre, amoureuse, amicale ou d’appartenance communautaire, et favorisant l’expression de soi, une expé- rience libératrice dans un environnement global encore hostile à l’homosexualité”. Néanmoins, par peur des clichés associés à une sexualité dite “déviante” et forcément imbriquée dans un traumatisme fondateur, on minimise quelque peu les risques en les romantisant ainsi. “Ce sont les risques du « métier » (en anglais : “It comes with the territory”), note Paul*, un ami américain qui justifie ses années de consommation par une honte de sa sexualité. J’en avais besoin pour baiser ; sans ça, je détestais mon corps et mes envies. Ça m’a ouvert des portes insoupçonnées. Je n’en suis sorti qu’avec l’aide de mes parents.”
Addiction et prévention
Comment expliquer ou juger l’incompréhensible quand on arrive soi-même à partouzer en sirotant des grenadines à l’eau ? Pour Matthieu, dont le mec slame seulement quand ils ne sont pas ensemble, “le fait que je ne prenne rien est un garde-fou évident, une sorte de cocon régulateur en dehors de ses pratiques extrêmes. Étant donné qu’entre nous la sexualité est traditionnelle, j’ai accepté le fait que, tant qu’il est sous PrEP, il puisse s’amuser.” Sauf qu’en août 2020 son compagnon a fait un G‐hole (surdose de GHB ou de GBL) qui l’a envoyé à l’hôpital. Dans un silence coupable, la communauté gay masculine, aussi ouverte soit-elle, compte à nouveau ses morts et ses blessés. Entre janvier 2008 et août 2017, les centres d’évaluation et d’information sur la pharmaco-dépendance-addictovigilance (CEIP-A) ont dénombré 24 décès liés au chemsex en France, constatant une augmentation exponentielle ces dernières années.
Thibaut Jedrzejewski est un médecin généraliste parisien qui partage son temps entre Le 190, un centre de santé sexuelle, et Gaïa, une association médico-sociale. Spécialisé en santé gay et en réduction des risques, il confirme une augmentation du nombre de consultations depuis cinq ans, et un changement des pratiques de consommation depuis le début de la crise du Covid-19. “Depuis un an, nous voyons une aggravation de la situation chez les chemsexeurs, en termes d’addiction mais aussi concernant d’autres problèmes de santé liés à l’usage de drogues. C’est une impression qui remonte du terrain, car nous manquons encore de chiffres précis, ayant peu de moyens et de temps pour en obtenir, note-t-il. Le bon côté, c’est que de plus en plus de professionnels de santé s’intéressent au sujet.”
"Sous prétexte de ne pas stigmatiser les consommateurs, on ne parle pas des mecs qui meurent."
Du côté du ministère de la Santé, silence radio. Thomas est en colère : “Je n’en veux même pas aux pouvoirs publics, ce sont les associations qui me rendent dingue. Sous prétexte de ne pas stigmatiser les consommateurs, on ne parle pas des mecs qui meurent. Ces morts sont comptabilisées en simples surdoses, mais elles ont pourtant un dénominateur commun très spécifique : le sexe entre hommes sous drogue. Donc ça nous concerne.”
Les associations de lutte contre le sida multiplient pour- tant les initiatives face aux possibles conduites à risques. Plaquettes de prévention, groupe Chillout Chemsex au Spot Beaumarchais, à Paris – proposée par Aides, c’est l’une des seules soirées hebdomadaires sur le sujet, en Europe –, études, centres de santé... Pour Tim Madesclaire, accompagnateur PrEP à Aides, “le chemsex fait désormais l’objet d’une surveillance accrue, tant le phénomène inquiète et interroge à la fois.”
Jean-Luc Roméro-Michel, conseiller régional d’Île-de- France et adjoint à la maire de Paris, a attendu la fin d’une longue enquête de police sur la mort de son mari, Christophe, pour révéler dans un livre sorti en 2020 les causes dudit décès : de l’alcool et de la MDMA mélangés à une dose importante de GBL. Dans Plus vivant que ja- mais ! Comment survivre à l’inacceptable ?, il détricote son deuil, entre souvenirs et amertume, accusant au passage l’homme qui a laissé son époux agoniser dans son salon après qu’il eut consommé des produits. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour homicide involontaire.
Faire confiance
En toute logique, la quasi-totalité des proches de chemsexeurs français m’ont dit faire plutôt confiance à leurs partenaire, ami ou fils, mais avoir peur des mauvaises rencontres que ces derniers pourraient faire. Réaction classique face à l’incompréhensible. Comme l’écrit Tim Madesclaire dans le journal Swaps, certains consomma- teurs et proches “sont dans une sorte de déni, considérant tou- jours l’usage dans le cadre récréatif : le chemsex, c’est les autres”. “Je n’arrive toujours pas à croire que je n’ai vu aucun signe. Christophe n’était jamais épuisé, n’agissait pas de manière différente durant les derniers mois, précise Jean-Luc Roméro. Après sa mort, j’ai eu envie de comprendre. Je n’avais aucune idée de l’ampleur du phénomène. Maintenant, je n’entends plus parler que de ça autour de moi.”
“Au 190, on reçoit également des gens qui sont inquiets pour leurs proches. Dans les consultations, je pars du principe que tout homme gay est confronté aux produits, même ceux qui disent que ça ne les intéresse pas. J’en parle presque à chaque fois, ajoute Thibaut Jedrzejewski. Ceux qui ne consomment pas peuvent être témoins d’accidents, être sollicités régulière- ment sur les applications ou lors de plans, avoir des proches en détresse, etc.”
"Il y a toute une batterie de conséquences à moyen terme sur la santé mentale et physique."
Un rapport publié en 2016 par le centre médical Marmottan, spécialisé à Paris dans l’accueil gratuit et ano- nyme des addicts, assure que la moitié des chemsexeurs interrogés disent avoir subi des violences sexuelles lors de leurs escapades, notamment lorsqu’ils étaient trop défoncés pour consentir à quoi que ce soit. Tous les hommes interviewés pour la rédaction de cet article m’ont aussi rapporté des comportements agressifs et/ou borderline à leur endroit, ou dont ils auraient été témoins. Le meilleur ami de Benjamin a récemment quitté Paris, en partie pour s’éloigner de son dealer, en partie pour fuir une expérience traumatisante (rappelons que le GHB est surnommé “la drogue du violeur”). “On parle toujours des overdoses, mais il y a toute une batterie de conséquences à moyen terme sur la santé mentale et physique, mais aussi sur le stress post-traumatique qu’impliquent de telles pratiques”, explique-t-il.
Il y a quelques années, mon mari a quitté son pays, les États-Unis, pour me suivre en France. S’éloignant par la même occasion d’habitudes de consommation prises dans le confort de sa ville d’origine. “Je me suis fait peur à plusieurs reprises, je commençais à voir des choses, je devenais parano”, m’a-t-il raconté dans le cadre de cette enquête. J’avais eu l’occasion d’observer ces comportements en vivant à ses côtés aux États-Unis. En pleine descente, il était persuadé que les voisins nous espionnaient depuis la cour de l’immeuble, lui habituellement si pragmatique. Puis il a partagé un élément de sa vie que je ne connaissais pas jusqu’ici : il y a une quinzaine d’années, un homme, devenu paranoïaque à la suite d’une grosse prise de crystal meth, a poignardé à mort l’un de ses amis durant une session de chemsex à New York.
“Quand on reste trois ou quatre jours sans dormir, déshydraté après une vingtaine d’injections, qu’on commence à avoir des éruptions cutanées, le cœur est à 130 ou 140 battements par minute pendant plusieurs jours”, rapportait en 2019 l’un des patients suivis par l’OFDT. “On se rend compte que la communauté gay a peu conscience de ce que sont l’addiction et la réduction des risques. Les dialogues se polarisent sur la diabolisation et la banalisation des drogues. Il y a pourtant des études, des chiffres très carrés”, conclut Thibaut Jedrzejewski. S’il admet que les pouvoirs publics “n’ont pas assez conscience des enjeux de ce phénomène”, il constate un vrai frémissement dans certaines mairies, dans les agences régionales de santé et à la Direction générale de la santé (à l’origine de l’étude Apaches) : “Le but n’est pas de dire « la drogue, c’est mal », mais plutôt de complexifier la perception qu’on en a. Plus les proches obtiendront des informations éclairées, mieux notre communauté saura se protéger.”
À lire aussi : Chemsex : guide des produits et conseils de consommation à usage préventif
Crédit photo : Shutterstock