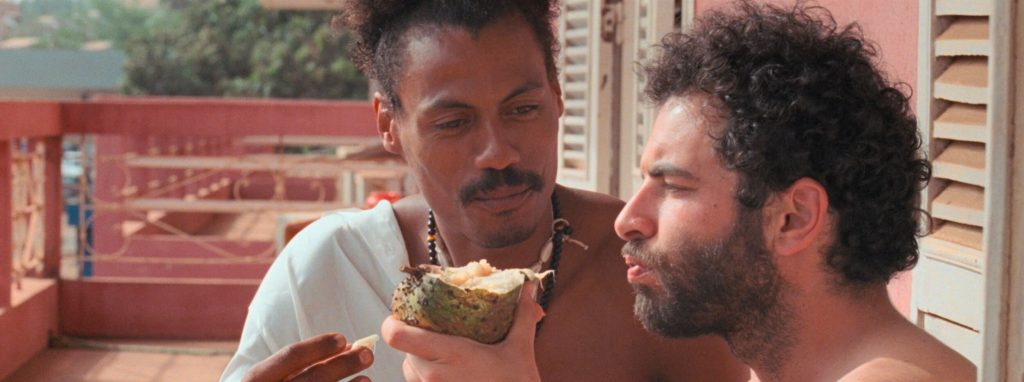Dans un rapport publié ce mardi, la Défenseure des droits met en lumière les discriminations subies en matière de santé par les minorités, notamment les personnes LGBT+.
Il ne fait pas bon avoir besoin de soins lorsqu’on n’est pas un homme cisgenre, hétérosexuel, valide et issu d’un milieu aisé. C’est, en substance, ce que souligne un rapport de la Défenseure des droits rendu public ce mardi 6 mai et intitulé "Prévenir les discriminations dans les parcours de soins : un enjeu d’égalité". Fondé sur les réclamations adressées à l’institution, la jurisprudence existante ainsi que sur 1.500 témoignages recueillis auprès de patient·es et de professionnel·les de santé entre novembre et janvier derniers, ce rapport met en lumière les nombreuses discriminations – directes ou indirectes – que subissent les personnes minorisées à différentes étapes de leur prise en charge médicale.
À lire aussi : Comment les (futurs) médecins se forment au soin des personnes LGBT
LGBT et parcours de soin : de nombreuses discriminations
Les discriminations à l’encontre des personnes LGBTQI+ se manifestent d’abord dans l’accès aux soins. Le rapport évoque notamment des cas où, en raison de leur statut sérologique, des personnes vivant avec le VIH se voient refuser une consultation médicale ou dentaire. Il souligne également les refus de prise en charge que rencontrent des personnes trans auprès de gynécologues, dermatologues, radiologues ou psychiatres, uniquement en raison de leur identité de genre.
Le document aborde aussi les obstacles rencontrés dans l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) qui, malgré les récentes évolutions de la loi bioéthique, peut encore être refusé à des couples de femmes ou à des couples hétérosexuels dont l’homme est trans.
Les discriminations persistent aussi au cours de la prise en charge. Cela peut passer par des manquements au devoir d’information, empêchant les patient·es de faire des choix libres et éclairés, notamment en ce qui concerne les différentes options de chirurgie d’affirmation de genre. Le non-respect de la vie privée est également mentionné, par exemple lorsque l’orientation sexuelle d’un·e patient·e est révélée dans un compte rendu médical ou devant des tiers.
À l’intersection de plusieurs discriminations, les travailleur·euses du sexe – en particulier trans ou gays – subissent une stigmatisation renforcée. Iels peuvent être infantilisé·es, faire l’objet de remarques déplacées ou encore se voir refuser une prescription de PrEP.
Enfin, la présomption d’hétérosexualité et la méconnaissance des besoins spécifiques des personnes queers entraînent des carences en matière de prévention en santé sexuelle. Certaines sont écartées de programmes de dépistage adaptés. Le rapport cite ainsi le cas de lesbiennes et d’hommes trans exclus du dépistage du cancer du col de l’utérus, ou encore la minimisation du risque de cancer de la prostate chez les femmes trans.
Des conséquences pour la santé des personnes LGBT
Ces discriminations ont des conséquences directes sur la santé des personnes concernées. Elles entraînent souvent des retards de prise en charge et donc une perte de chance. Beaucoup en viennent à reporter leurs soins, voire à y renoncer, par crainte d’être stigmatisées ou maltraitées. Les personnes trans, par exemple, limitent souvent leurs consultations médicales aux seules étapes nécessaires de leur parcours d’affirmation de genre, tandis que les personnes vivant avec le VIH restreignent leur suivi à leur infectiologue.
Ces discriminations ont également un impact psychologique important. Souvent traumatisantes, elles contribuent au stress minoritaire, augmentent l’anxiété, la dépression, et fragilisent la confiance en soi ainsi que la reconnaissance de ses propres symptômes.
Mieux prévenir les discriminations dans les parcours de soin
Pour lutter contre les discriminations que subissent notamment les personnes LGBTQI+ dans leurs parcours de soins, la Défenseure des droits appelle à une réponse globale. Elle recommande de :
- Structurer l’action publique en intégrant la lutte contre les discriminations dans les politiques de santé, via un pilotage fort et transversal au sein des ministères concernés (Santé, Solidarité, Égalité).
- Documenter les discriminations en améliorant les outils d’observation, en collectant des données fiables et désagrégées, et en produisant des indicateurs spécifiques.
- Former les professionnel·les de santé en intégrant la lutte contre les discriminations et les biais dans les formations initiales et continues, y compris dans le référentiel des compétences médicales.
- Rendre effectifs les recours en faisant mieux connaître les droits des patient·es, en rendant les procédures de signalement accessibles et en protégeant les personnes qui signalent des discriminations.
- Adapter le système de santé pour garantir une prise en charge adaptée à la diversité des patient·es en travaillant sur l’accessibilité, l’information, les accompagnements personnalisés et l’offre de soins.
- Assurer la prévention et l’égalité d’accès : éviter les ruptures dans les parcours de soins, renforcer l’accès à la prévention et aux droits, et lutter contre les refus de soins injustifiés.
- Renforcer les sanctions en les rendant effectives et dissuasives à l’encontre des professionnel·les ou structures discriminantes.
L’objectif est simple et nécessaire : garantir un égal accès à la santé, sans distinction d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de statut sérologique ou de situation sociale.
À lire aussi : Santé mentale : connaissez-vous le stress minoritaire ?
Crédit photo : Creative Commons