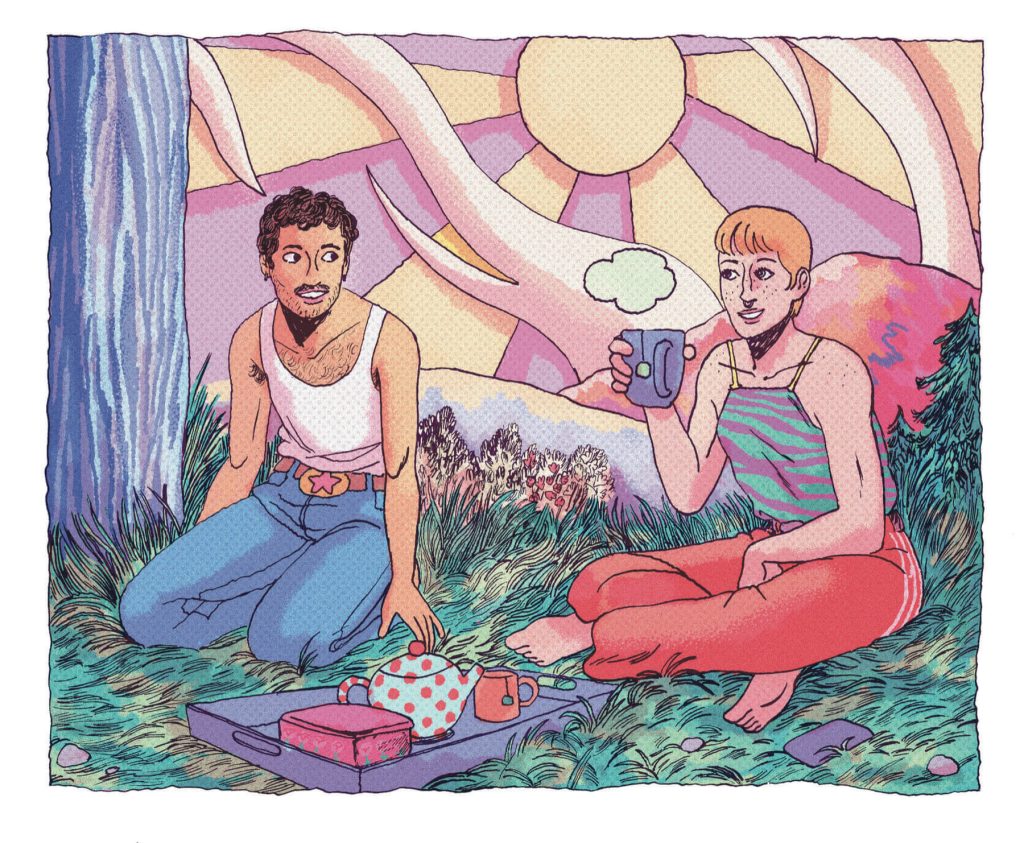Après la sortie de Camélia Jordana dans "On n'est pas couché", de nombreux témoignages montrent qu’on peut avoir peur de la police à cause de sa couleur de peau. Mais aussi de son orientation sexuelle...
Samedi soir, dans l'émission de France 2 "On n'est pas couché", Camélia Jordana a provoqué un tsunami. La chanteuse a déclaré "ne pas se sentir en sécurité face à la police" en tant que personne racisée, provoquant une vague de haine sur Internet (notamment avec le hashtag #JeNeSuisPasCameliaJordana), mais aussi de nombreux témoignages de soutien, comme de la part de la superstar belge Angèle ou du chanteur Slimane. Sur les réseaux sociaux, ils sont des centaines à avoir pris la parole à travers le hashtag #MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice, pour rapporter des faits de violences policières, de discriminations ou d'humiliations. Et parmi elles, plusieurs personnes LGBT+.
"Sale pédé, grosse merde"
“T’es posé dans un endroit. Ils commencent à venir et te demander des papiers. Pour affirmer leur autorité ils commencent à t’insulter, te rabaisser, pour te montrer qu’ils ont des armes et que toi t’en as pas. À ce moment là ça traite de sale pédé, de grosse merde.”, se souvient Yanis Khames, 21 ans, non binaire, et cofondateur de l’association Saint Denis, Ville Au Cœur, qui a organisé la première Marche des fiertés en banlieue. Si il précise que “je suis pas forcément identifiable comme une personne queer dans la rue”, il considère que “moi la police, je les vois pas comme quelque chose qui protège. C’est plutôt une source de problème que de solutions. Si il y a la police pas loin de chez toi, tu te fais petit, tu passes. Tu sais pas si tu peux finir la nuit au poste ou pire.”
“Je ne crois pas avoir jamais fait confiance à la police. J'ai grandi avec mon père arabe et je l'ai vu subir des contrôles au faciès, être emmené au poste parce qu'ils refusaient de l'accompagner jusqu’à sa voiture où étaient ses papiers.” témoigne Nahib*, 26 ans. “En tant que personne transmasculine métisse, j'ai vécu jusqu'à maintenant dans le genre féminin et les policiers sont moins durs avec nous.” Ce qui ne l’empêche pas de s’inquiéter pour sa transition : “J'hésite à changer officiellement mes papiers par peur des discriminations et des violences.”
“On peut pas appeler au secours parce que normalement c’est la police qui vient au secours.”
Contrôles de police brutal
Et pour cause, il a lui-même vécu des violences de la part de policiers. “J'ai déjà fait des gardes à vue et les policiers étaient transphobes avec moi. Ils se moquaient de mes poils. Ils riaient du fait que j'étais "français" en sous-entendant qu'avec mon nom je ne l'étais pas vraiment. Quand ils n'avaient pas mes papiers d'identité sous les yeux, ils ne savaient pas qui devait me fouiller et m'engueulaient pour me sommer de répondre sur la nature de mes organes génitaux. J'ai finalement été fouillé par des femmes, dénudé en entier et touché. Mais bon, voilà, maintenant que je prends de la testostérone je pense que je serai juste directement maltraité comme tout jeune homme nord-africain.” Il précise toutefois que ces faits ne se sont pas déroulés en France mais dans d’autres pays de l’Union européenne, ce qui a néanmoins terni sa vision de la police en général.
C'est pourtant bien dans l'Hexagone que Victor Laby, 22 ans, a vécu contrôle de police brutal il y a plusieurs années, dont plusieurs médias s'étaient fait l'écho. Il raconte l'homophobie du discours (“Tu le suces ton copain, il te défonce hein, pédé ?”) et “des palpations au corps brutales, avec un coup dans le plexus. Ils se marraient, ils se faisaient plaisir.” Avec en prime l’angoisse d’être sans recours. “On peut pas appeler au secours parce que normalement c’est la police qui vient au secours.” Il considère malgré tout que “si je n'avais pas été blanc, peut-être que ça aurait été encore pire. Je ne veux pas tirer pour moi la question des violences policières.”
Lesbophobie
Même sentiment pour Florence Pic, 33 ans, cofondatrice du collectif Irrécupérables : “Mon rapport à la police en tant que femme blanche dans l’espace public n’est pas problématique. Par contre en tant que lesbienne, quand une voiture de police passe, on a les regards.” C’est pendant un dépôt de plainte pour agression homophobe qu’elle a subi des comportements lesbophobes de la part de la police, qui a d’abord refusé de prendre sa plainte avant de se raviser. “Dans le dépôt de plainte, j’expliquais que ma copine était présente. Le policier a préféré écrire que c’était une amie”.
Les propos déplacés se succèdent : “Le policier m’a appelé Monsieur. Il m’a regardé fixement, puis il a regardé ma poitrine puis il m’a finalement appelé Madame”. Quand elle parle de leur futur mariage à l’agent, il lui demande : “Vous allez faire quelque chose pour la nuit de noce ? Une hypersexualisation, comme d’habitude”. En fin de compte, pour Florence, “la seule chose qui l’intéressait est de savoir comment mon agresseur savait que j’étais lesbienne, et donc savoir ce que j’avais fait pour qu’on m’agresse.”
Violence indirecte
Car si les violences physiques ne sont pas régulières, les discriminations sont encore courantes au moment des dépôts de plainte pour LGBTphobies. C'est d'ailleurs ce que semble confirmer le coprésident de SOS homophobie Jérémy Falédam : “Dans notre dernier rapport, on met en avant le fait que les forces de l’ordre sont pas toujours une protection pour les LGBT. Il y a énormément de cas où on a des refus de plainte ou des refus de catégoriser la plainte homophobe ou transphobe. Quand on est mal accueilli une fois, ça pousse à une plus grande banalisation des LGBTphobies. C’est une violence indirecte générale qui explique pourquoi si peu de personnes vont porter plainte.”
À LIRE AUSSI : La galère du dépôt de plainte pour homophobie
“La police a toujours une attitude avec une méconnaissance totale des réalités LGBT”, analyse Giovanna Rincon, directrice de l’association Acceptess-T. Constat qu’elle illustre d’innombrables exemples concernant les personnes trans : “Quand une femme trans et travailleuse du sexe a été victime d’un viol, la police, au lieu de rassurer la personne, a tendance à faire culpabiliser la personne parce que ce n’était pas bien d’être là”. Pire encore selon elle, “quand des personnes trans se retrouvent à faire appel à la police pour se plaindre qu’on les insulte ou qu’on leur crache dessus, la police minimise et se moque des filles. Ça se transforme en problème entre la police et les trans.” Il va sans dire encore une fois que les personnes racisées subissent une double-peine. “Il y a douze jours, une fille d’origine latine est allée au commissariat pour porter plainte. Elle est sortie avec un avis d’expulsion. Si c’est pas de la xénophobie, je ne sais pas ce que c’est.” En résumé pour elle, “la méconnaissance et le manque de pédagogie sur les questions LGBT est une réalité traduite par des ratés, des situations de reproduction des violences.”
"Une partie de notre communauté se fait écraser"
Le constat est sans appel selon Jérémy Falédam : “Il y a des violences directes de la part des forces de l’ordre à l’encontre de personnes LGBT. Les violences policières de manière générale semblent rester impunies. Elles concernent les populations les plus précaires et marginalisées dont font partie les LGBT et les LGBT racialisés.”
Pour Youssef Belghmaidi, femme trans et marocaine de 23 ans, et organisatrice de la Pride des banlieues, “quand on est LGBT et racisé, les différents points de nos identités ne sont pas dissociables. Si je me fais violenter, je me fais violenter.” Celle qui habite à Aubervilliers considère que “les violences policières c’est aussi l’affaire des LGBT. La LGBTphobie au sein de la police n’est pas nécessairement combattue, et il y a une partie de notre communauté qui se fait écraser. Je pense aux personnes migrantes et les sans-papiers persécutés pour leur genre ou leur orientation et qu’on ne protège pas véritablement en France.”
Crédit photo : Unsplash