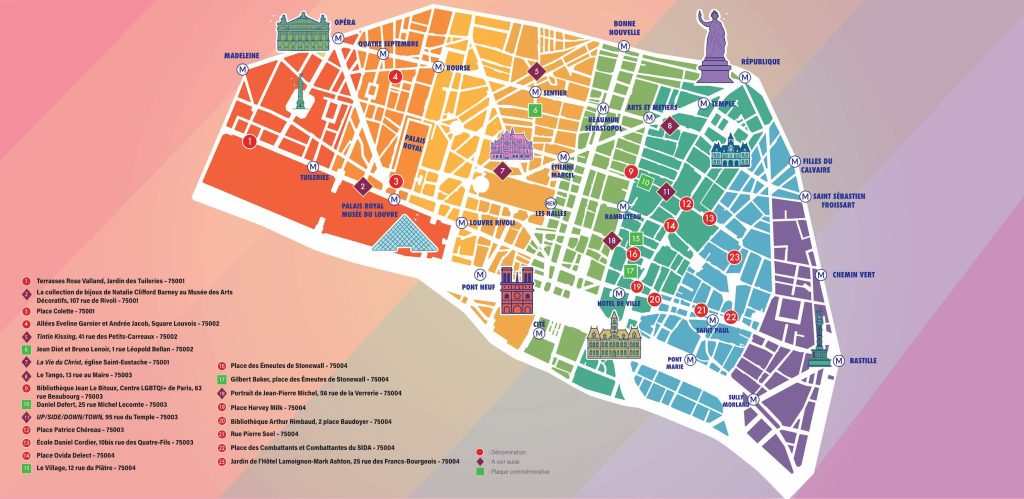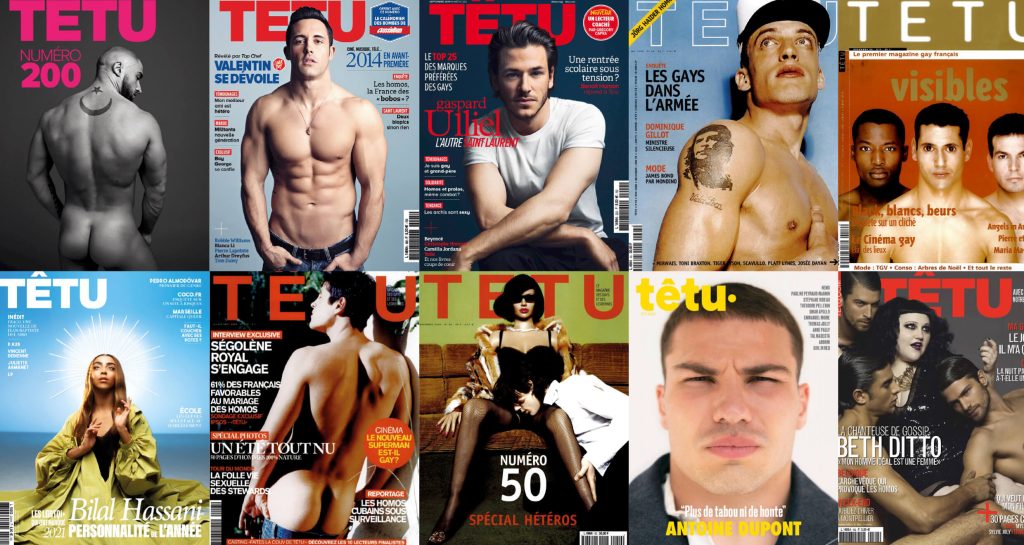Loin des fantasmes et des contre-vérités agités par ignorance ou transphobie, des spécialistes offrent aux mineurs en questionnement de genre un cadre serein et bienveillant pour explorer leur identité. Car s’il y a quelque chose à soigner, c’est une société malade de sa cisnormativité binaire.
"C’est très fréquent de se poser des questions sur son genre !" Denise Medico sait de quoi elle parle. Cette psychologue, autrice notamment de Jeunes trans et non binaires, accompagne depuis près de 25 ans des personnes en questionnement sur leur genre."On devrait dire d’affirmation de genre puisqu’on peut aussi être agenre ou fluide", précise cette pionnière de l’approche trans-affirmative, également professeure au département de sexologie de l’UQAM, à Montréal, et cocréatrice de la Fondation Agnodice. "En tant que psychologue-psychothérapeute, j'accueille ces questionnements, j’écoute la demande, j’offre un espace pour réfléchir sans préjuger de quel serait le genre de la personne", développe Denise Medico. Selon elle, s’il y a ces derniers temps davantage de demandes directes en consultation, "c’est parce que ce type de questionnement a davantage de voix dans l'espace public et que les coming out se produisent dans plusieurs générations – aujourd’hui nous avons des très jeunes, des ados, des adultes mais aussi des personnes plus âgées –, mais ce n’est pas nouveau pour autant !"
À lire aussi : Transidentité : la parole essentielle de trois personnes concernées sur M6
En consultation, développe la praticienne, elle commence par dire aux jeunes qui viennent la voir : "Je ne sais pas où cela va nous mener. Peut-être vous direz-vous que, finalement, vous êtes bien dans le genre qui vous a été assigné, peut-être réaliserez-vous que vous êtes non-binaire, agenre, fluide, ou alors peut-être déciderez-vous d’entamer une transition de genre binaire…" Elle précise ainsi le rôle des psychologues dans cette approche non-psychiatrisante et non-pathologisante des questionnements de genre : "Notre but est de faire que les personnes se sentent bien dans leur genre, c'est-à-dire que cela ne soit pas une obsession. Et qu’elles y trouvent une expression de soi suffisamment confortable. Cela passe par une reconnaissance de ce genre, par une exploration et une affirmation."
Impliquer les parents
Un soutien nécessaire dans une société obsédée par sa cisnormativité, d’autant plus lorsque ce sont des enfants et des ados qui s'interrogent sur leur genre. Mehdi Liratni, docteur en psychologie, psychologue et coordinateur du "Pôle Trans" de l’association Fierté Montpellier Pride, vient de publier 100 idées pour accompagner la transidentité chez l’enfant et l’adolescent aux Éditions Tom Pousse. Il précise d’emblée : "Il ne devrait pas y avoir besoin de voir un médecin ou un psy pour qu’un enfant explore son identité de genre. Le problème majeur provient des représentations sociales obsolètes et erronées qui ne font que freiner la fluidité de genre et engendrent des discriminations des publics transidentitaires. J’espère que dans 20 ans mon livre sera totalement obsolète, non par son contenu, mais sur le fait qu’un psy ait dû écrire un livre pour faire comprendre et valider la transidentité sur le plan social !"
Mais alors, comment cela se passe t-il concrètement ? Comment ces enfants et ces ados, ainsi que leurs parents, sont-ils accompagnés ? Pour Mehdi Liratni, la première étape passe par la création d’une alliance avec les parents : "Tout questionnement autour du genre de la part d’un mineur nécessite un partenariat avec les parents car de nombreuses démarches (changement du prénom, démarrer un traitement) nécessitent leur accord." Sans ce partenariat, le risque est en effet de freiner l’expression de genre de l’enfant ou de l’adolescent·e, ce qui peut aggraver les problématiques autour de l’estime de soi. Il s’agit donc avant tout de faire des parents des alliés qui seront les premiers accompagnateurs de leur enfant. "Dès lors que l’on a une bonne alliance thérapeutique, le cadre est déjà plus apaisé. La reconnaissance des parents est très importante pour les enfants/adolescents transgenres. Un manque de reconnaissance crée des souffrances qui perdurent à l’âge adulte."
Le psychologue montpelliérain explique ainsi : "ll y a un vrai travail à faire du côté des parents. S’ils sont ouverts, je fais de la pédagogie, j’explique que le genre est une construction sociétale et je leur fournis des données scientifiques rassurantes. Si les parents sont davantage fermés, ils auront tout un cheminement à faire, un travail thérapeutique sur leurs représentations sociales, par exemple. Ils se rendront compte que, finalement, ce qui compte le plus, c’est l’amour qu’ils portent à leurs enfants."
Explorer l'identité de genre
En parallèle, il faut aussi, bien sûr, prendre soin des jeunes. Un point régulièrement soulevé par les proches est : "Ce questionnement de genre n’est-il pas le symptôme d’une pathologie psy sous-jacente ?" Pour Denise Medico, une maladie comme la dépression affecte peu le jugement. De son côté, Mehdi Liratni explique : "En consultation, on voit très vite si l’enfant est bien dans un questionnement de genre ou s’il y a – c’est très rare – une psychose qui se manifeste par des discours décousus, peu raisonnés." Il faudrait davantage prendre la question à l’envers : "Une identité de genre non reconnue peut être un facteur de troubles anxiodépressifs, d’automutilation, etc. Il s’agit donc d’être vigilant sur ces problématiques et de les accompagner au plus tôt", souligne le psychologue pour qui "autodétermination n’est pas antonyme de prévention".
Le psychologue raconte comment il travaille avec les enfants : "Avant la puberté, on ne parle pas encore d’hormones ou de chirurgie; le questionnement sur le genre est avant tout centré sur le social. Il s’agit alors de les laisser librement explorer leur identité de genre. Pour ceux qui souhaitent être rassurés, nous proposons des petites étapes successives rassurantes, d’abord dans l’espace thérapeutique, puis dans la cellule familiale restreinte, puis plus élargie, pour voir comment il ou elle se sent. On voit que l’on est sur le bon chemin dès lors que l’enfant est plus épanoui." Exemple : "Je propose à l’enfant de le genrer différemment dans nos interactions, et je lui demande ensuite comment il ou elle s’est senti·e. Après une expérience dans le genre désiré, les parents témoignent qu’ils n’avaient pas vu leur enfant avec un visage aussi souriant depuis longtemps. Pour certains, c'est même l’envie de vivre qui réapparaît. Quand on sait que le genre est uniquement sociétal, il serait aussi stupide d’interdire l’exploration du genre que d’interdire l’exploration de certains centres d’intérêt !"
"Ils ont le droit de changer d’avis, droit d’avoir un genre à elleux, un genre qui leur est propre, loin des constructions sociales."
Clément Moreau, psychologue et coordinateur du pôle Santé mentale de l'association Espace Santé Trans, reçoit quant à lui des jeunes un peu plus âgés : "Les jeunes que nous recevons à l’association sont déjà dans un processus de puberté. Iels ressentent une pression, une urgence par rapport à elle. C’est par exemple la poitrine qui pousse et qui amène des réflexions du type 'comment je vais gérer ça?', 'je ne suis pas du genre que l’on m’a assigné à la naissance'…" Il adopte lui aussi une démarche qui propose au jeune et n’impose rien, lui offrant simplement un espace d’exploration et de réflexion : "Nous défendons une approche trans affirmative. C’est-à-dire qu’il s’agit d’accompagner les jeunes où ils sont, afin qu’ils sachent qu'ils ont le droit de changer d’avis, qu’ils ont le droit d’avoir un genre à elleux, un genre qui leur est propre, loin des constructions sociales."
Le psychologue détaille plus précisément son accompagnement : "Mon travail est de récolter les envies du jeune, sans lui faire de propositions à partir de ce que je pourrais avoir en tête. Par exemple, je ne vais pas lui proposer de changer de prénom et/ou de pronoms si ce n’est pas quelque chose dont iel a envie. Ensemble, on peut essayer de comprendre ce que cela peut changer de laisser ses cheveux pousser ou de les couper, de porter d’autres vêtements, de tester du maquillage, de porter un binder… On tente ce qui est possible et ce qui peut être exploré dans tout le champ des possibles réversibles." Il ajoute : "Nous réfléchissons aussi aux traitements, aux chirurgies… en nous efforçant d’informer au plus juste."
À lire aussi : Les cas de détransition sont rarissimes chez les enfants trans, montre une étude
Parcours trans et solidarité
Les jeunes en questionnement de genre doivent aussi pouvoir rencontrer des personnes qui partagent une expérience similaire : "Les jeunes trans ou en questionnement de genre ont besoin de rencontrer des personnes trans au moins un peu plus âgées. Elles sont en effet peu visibles en société, et il est difficile de trouver des pairs aidants qui peuvent un peu les accompagner et partager avec elleux leur expérience. Ainsi, iels peuvent poser des questions, comprendre ce qui est possible ou non, ce qui va se passer à la puberté et au-delà", explique Clément Moreau. C’est d’ailleurs, signale-t-il, un intérêt majeur de la sollicitation d'associations "par et pour" : "En tant que pairs, en tant que personnes concernées, nous avons également vécu ces questionnements. Je dirais qu’il n’y a pas de meilleur·es théoricien·nes du genre que les personnes trans ! Nous avons l'expertise issue de notre expérience, et des savoirs spécifiques. Nous savons que les catégories proposées par l’extérieur sont figeantes et figées, et nous leur offrons une espèce de bac à sable où iels peuvent tester des choses."
C’est dans ce type de démarche, mais aussi celle d’inclure les parents, que l’association Outrans propose un groupe de parole destiné aux enfants et aux ados (6-18 ans) d'une part, et aux parents ou aux adultes proches d'autre part. L’accueil s’y fait en commun, puis les parents et les enfants se retrouvent dans deux groupes distincts : un groupe où les mineurs trans ou en questionnement peuvent échanger entre eux au cours d’activités ludiques, et un groupe où les parents peuvent poser des questions et partager leur expérience.
Puberté et hormones
On ne saurait finir cet article sans parler des bloqueurs de puberté tant leur prescription – pourtant toujours validé au préalable par l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne le/la jeune et sa famille au cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire – cristallise les plus vifs débats. "Les bloqueurs de puberté sont un élément parmi d’autres dans tout l’éventail des choses que l’on peut proposer aux jeunes en questionnement de genre. Ce sont des outils qui permettent de lutter contre le stress minoritaire, contre l’anxiété", expose Clément Moreau, qui iniste : "C’est une perte de chance pour les jeunes qui les demandent que de leur refuser."
Laetitia Martinerie, professeure en endocrinologie et diabétologie pédiatrique à l’hôpital Robert Debré, explique de quoi il s’agit : "Le principe repose sur un arrêt de la progression pubertaire afin d’atténuer la détresse et l’anxiété liées à l’apparition des caractères sexuels secondaires. Les aGnRH sont l'option de traitement actuellement préférée et sont utilisés de la même façon que dans la puberté précoce. Ce traitement peut être initié du stade 2 au stade 4-5 de la puberté, ainsi que chez les adolescent·es post-pubertaires afin de bloquer les effets non désirés des hormones endogènes." Elle insiste sur le fait qu’aucun traitement hormonal n’est prescrit avant que la puberté ait débuté. Effets attendus de ces traitements : "En fonction du stade pubertaire, les caractères sexuels secondaires peuvent soit régresser (lorsque le traitement est débuté au stade 2 de la puberté) soit s'arrêter dans leur développement. Chez les garçons trans, les règles cesseront et le tissu mammaire deviendra atrophique. Chez les filles trans, la virilisation ne progressera plus."
La scientifique rappelle que les effets du traitement par aGnRH sont réversibles : si l’ado ne souhaite plus une transition hormonale, le traitement peut être interrompu et la puberté physiologique reprendra. S’il existe des effets sur la croissance du jeune qui nécessiteront une prescription de vitamine D et une augmentation des apports en calcium, tout est fait dans le respect du consentement éclairé : "Le médecin recueille au préalable le consentement du jeune et de ses parents/représentants de l’autorité parentale, et s’assure que les effets attendus et les effets secondaires potentiels ont été compris", précise Laetitia Martinerie. Et Denise Medico de conclure : "Les bloqueurs de puberté permettent de faire une pause, de se donner du temps. On ne peut pas faire une psychothérapie avec quelqu’un qui est aux abois, qui voit son corps se féminiser ou se masculiniser en le vivant mal. Souvent, les choses s’améliorent dès le début du traitement médicamenteux et l'on peut avancer en parallèle en psychothérapie. Ces bloqueurs répondent à un vrai besoin." Un besoin de créer une pause pour se trouver, tandis que les soignant·es écoutent ces jeunes et leur proposent un espace serein, pour qu'iels aient une chance de trouver leur place dans une société qui s'agrippe à ce qu'elle croit savoir sur le masculin et le féminin.
À lire aussi : Comment un enfant transgenre est (vraiment) pris en charge en France
Crédit photo : Shutterstock