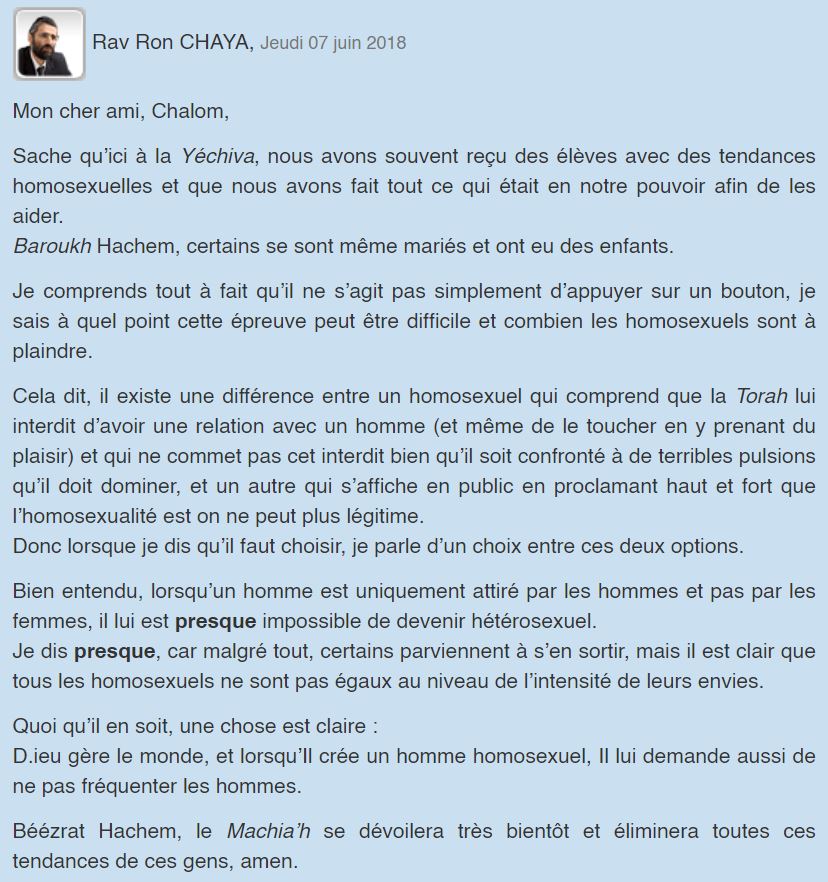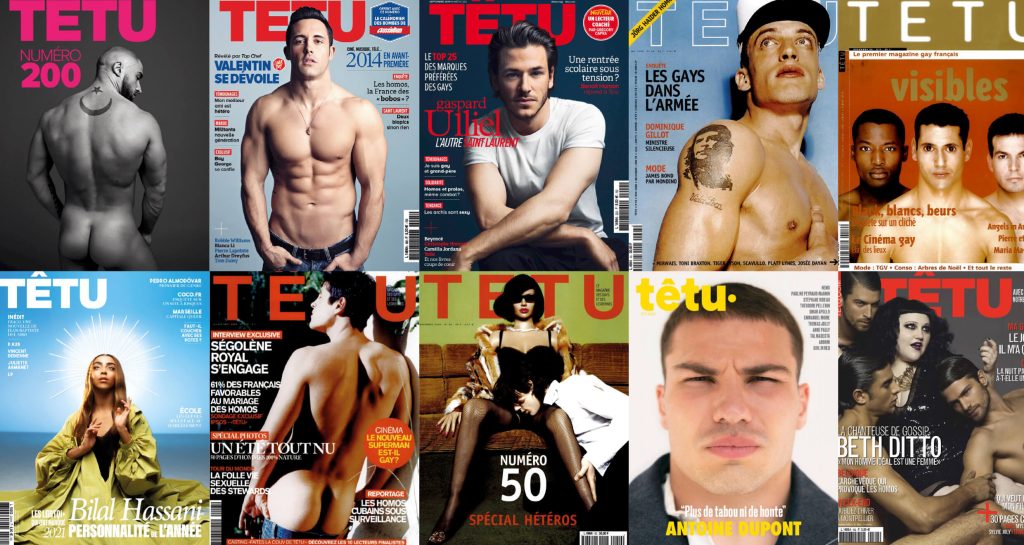Dans le judaïsme, le courant orthodoxe, majoritaire en France, considère toujours l'homosexualité comme une « abomination ». Les plus radicaux promeuvent même des formes de « thérapies de conversion ». Enquête.
« Il était persuadé que j'étais pris par Satan, que j'allais tuer nos parents. » Quinze ans après, Mikael se souvient encore avec précision de cette soirée au cours de laquelle il a fait son coming out à son frère. Le quadragénaire a grandi dans une famille juive « très pratiquante, très religieuse » à Toulouse. Il a fait sa scolarité auprès de « profs orthodoxes » à l'école Ozar Hatorah, celle qui a été attaquée en 2012 par le terroriste islamiste Mohammed Merah.
Mikael sait qu'il est homosexuel depuis l'âge de 14 ans. À 26 ans, alors qu'il vient de s'installer à Paris pour « vivre [sa] liberté », il retourne à Toulouse pour les fêtes de Roch Hachana et de Yom Kippour. Le soir de Kippour, « le jour le plus saint du calendrier », il décide de s'ouvrir sur son homosexualité à son frère. Celui-ci se met alors à pleurer, lui dit que « c'est une épreuve envoyée par Dieu » dont il « [ressortira] plus grand ». Les deux frères en viennent aux mains.
Calmants
À la suite de la fête juive, Mikael est « convoqué » par un rabbin orthodoxe qui, en présence de son frère, le sermonne. « On m'explique qu'on commence par les femmes, puis les hommes, puis les animaux, puis la pédophilie, puis on devient meurtrier. C'était horrible parce qu'on mettait les homosexuels dans ce cadre-là, celui du meurtrier et du coupable. »
Sous le choc, Mikael reste silencieux. Alors qu'il doit repartir le lendemain pour la capitale, c'est au tour du directeur de son ancienne école, un autre religieux orthodoxe, de le « convoquer » dans son bureau, pour lui tenir le même type de discours. Son frère est toujours présent, mais cette fois leurs parents se joignent à eux. « Je rate mon avion, je ne peux pas repartir à Paris, on me confisque la carte SIM de mon téléphone, ma carte d’identité. On me donne des calmants très forts pour que je ne puisse pas réagir. »
« Ramener les brebis égarées »
Finalement, le jeune homme parvient à s'enfuir et à rentrer à Paris, laissant sa famille en pleurs. Il sait très bien à quoi il a échappé : des rituels religieux, notamment le « tikkoun olam », une prière de « réparation », censée en l'occurrence supprimer son attirance homosexuelle. « C'est ce qu'on suggère pour les homosexuels qui sont dans le « mauvais chemin ». Le travail des religieux orthodoxes est de ramener les brebis égarées dans la communauté. »
À LIRE AUSSI : Colère en Israël après les déclarations homophobes d’un ministre
Aujourd'hui, Mikael a tourné le dos à la religion. Longtemps, sa famille et lui ne se sont plus parlé. Son frère, orthodoxe « plus que jamais », ne lui adresse de nouveau la parole que depuis cette année. Ce coming out familial est resté pour lui un traumatisme, au point de voir apparaître le visage de son père à chaque fois qu'il avait un rapport sexuel pendant une période. Un temps, il s'implique dans l'association juive LGBT+ Beit Haverim (« maison des amis » en hébreu), créée en 1977. « Je pense que les choses évoluent. Malheureusement, il y a une grande homophobie au sein même de la communauté juive. »
« C'est une abomination »
Le judaïsme français est divisé en trois grands courants : orthodoxe, libéral et Massorti. Le courant orthodoxe, majoritaire en France, est aujourd'hui représenté par le Consistoire central israélite de France, seul interlocuteur reconnu auprès des pouvoirs publics. Contacté, celui-ci renvoie vers Michaël Azoulay, chargé des affaires sociétales auprès du grand-rabbin de France, Haïm Korsia. Le rabbin est une des rares figures publiques de la tendance la moins conservatrice du judaïsme orthodoxe, juqu'à contribuer en 2017 à l'ouvrage Judaïsme et homosexualité pour les quarante ans du Beit Haverim. Mais il se veut transparent sur la position du Consistoire, qui condamne « clairement » l'homosexualité. « Je ne fais pas partie du courant le plus accueillant », prévient-il d'emblée.
Contrairement aux deux autres, en effet, le courant orthodoxe « s'en tient à la lettre du texte biblique, du Lévitique ». Celui-ci interdit, parmi une série d'autres pratiques comme la zoophilie, la sodomie entre deux hommes : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Quant à l'homosexualité féminine, qui n'est pas mentionnée dans la Bible, elle est tout de même « prohibée » par la Halakha, ensemble des prescriptions, coutumes et traditions qui forment la loi juive, même si l'interdit n'est « pas de même nature et de même gravité », précise Michaël Azoulay.
« Politique du silence »
Le judaïsme libéral ou réformé, majoritaire aux États-Unis, existe depuis le début du XXe siècle en France. « [Ses tenants] considèrent que la loi écrite n’a pas de caractère immuable, chaque rabbin dans sa communauté peut l'adapter aux réalités sociales », explique la sociologue au CNRS Martine Gross, par ailleurs première présidente du Beit Haverim. Ainsi, la très médiatique Delphine Horvilleur, rabbin libéral, appelait en 2015 à « briser le tabou de l'homosexualité » dans le judaïsme.
À LIRE AUSSI : Un évêque français condamne les « thérapies de conversion »
Dans l'entre-deux, le courant Massorti ou conservateur, présent en France depuis une trentaine d'années, cherche à s'ancrer dans la tradition tout en l'adaptant à la modernité. « Le judaïsme n'a jamais vraiment réfléchi à l'homosexualité jusqu'à très récemment, estime le rabbin Yeshaya Dalsace. C'est plutôt une politique du silence assez criante. » Chez les Massorti, assure-t-il, « le débat existe » mais il y a une « tendance vers l'acceptation » et les rabbins essaient de « légaliser le phénomène homosexuel » sans se détourner de la tradition juive. Lutter contre l'homosexualité d'une personne lui paraît « absurde » et « bidon ». « Il y a une éthique de la sexualité dans le judaïsme : je pense que les homosexuels en couple ont les mêmes devoirs qu’un couple hétérosexuel, la fidélité etc. »
« Statu quo »
À l'inverse, il estime que « la tendance consistoriale depuis une trentaine d'années est celle d'un renforcement très net du conservatisme, d'orthodoxie stricte ». Michaël Azoulay préfère parler d'un « statu quo » sur la question de l'homosexualité. « Il y a un mouvement de compréhension, pas de rejet. Mais c'est un tabou qui persiste. On est bien démunis, on n'a pas d'arsenal. Chaque rabbin fait comme il peut. La ligne est plutôt de ne pas offrir de solutions, sans offrir de fausses solutions. » Ce tabou ouvre la porte à des discours et des pratiques qui se rapprochent, comme l'expérience de Mikael, des « thérapies de conversion ». Michaël Azoulay le reconnaît : « Il y a un discours qui consiste à dire qu’il faut essayer de changer d’orientation sexuelle, parce que vous êtes en infraction avec la Halakha. Ce discours est toujours présent. »
En 2007, dans une étude de Martine Gross pour la revue Archives de sciences sociales des religions, certains rabbins orthodoxes avaient affirmé qu'ils renvoyaient leurs fidèles homosexuels vers la psychothérapie ou une pratique accrue de la religion afin de se débarrasser de leur attirance homosexuelle. « Un des rabbins m’avait dit qu’il conseillait de faire partie d’un groupe d’étude religieuse », se souvient la chercheuse.
Yechivah
Alain Beit a échappé à une expérience de ce type. Président du Beit Haverim depuis six ans, il a les larmes aux yeux en se rappelant sa découverte d'une synagogue LGBT+ à New York, dont il n'existe pas d'équivalent en France : « En les voyant tous prier et assumer leur orientation, je me suis senti tellement bien, des larmes ont coulé. Cette expérience a contribué à faire de moi le militant que je suis. » Avant cela, il a vécu un coming out particulièrement difficile. C'est son ex-femme, « juive traditionnelle » comme lui, qui l'a outé auprès de sa famille, de ses voisins et même de leurs jeunes enfants après la séparation.
Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.
Un jour, en voyage à Jérusalem, il se confie à son cousin, très orthodoxe : « Il pense qu'on a le choix, que ce n'est pas une orientation qui s’impose à nous. C'est la position de la plupart des religieux. Ils pensent qu’on essaie de se marginaliser. Ils nous disent : il faut que tu fasses des efforts, que tu te rapproches de Dieu. » Son cousin lui propose alors de le faire entrer dans une yechivah, un centre d'étude de la Torah et du Talmud, où des hommes homosexuels seraient déjà passés avant d'épouser une femme et d'avoir des enfants. « J'avoue que je me suis projeté un moment. Ça m’a intrigué et même un peu attiré. Je me suis dit : et si ça pouvait être la fin de toutes les emmerdes ? » Cet épisode de sa vie, il l'a confié en novembre dernier à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information sur les « thérapies de conversion ».
« Passage vers l'hétérosexualité »
Ce type de discours existe aussi sur Internet. Le site francophone Torah Box, édité par l'association Tov Li, elle-même créée en 2009 à Villeurbanne, fait peu d'efforts pour cacher son homophobie. Sur ce site, qui dispose aussi d'une chaîne YouTube à 29.000 abonnés, des rabbins répondent à tout type de questions. En juin 2016, le rabbin Mordehai Bitton, ancien vice-président de SOS Racisme, répondait à la question « Comment soigner l'homosexualité ? » sur une page supprimée depuis mais toujours accessible via les archives. L'homosexualité y est présentée comme une « maladie » (entre guillemets dans le texte) qui « coïncide toujours avec une certaine morbidité, c'est-à-dire une manière de tourner l'exercice du désir vers des pratiques destructrices ».
Le religieux écrit plus bas : « La guérison passe donc par une psychothérapie de longue durée qui permet de tracer le pourquoi de l'apparition de ces symboliques de substitution (à l'homme masculin, s'est substitué un autre être, féminin, masculin travesti, nié etc. etc.), la cause de cette apparition et ses différentes formes. Dans le même temps, il faut beaucoup prier, énormément étudier, et faire beaucoup de Tsédaka [l'équivalent de l'aumône dans le judaïsme, ndlr]. » En février dernier, une nouvelle réponse a été publiée. Elle est un peu plus nuancée mais continue à parler de « passage vers l'hétérosexualité ». Sollicités par TÊTU, ni Torah Box ni Mordehai Bitton n'ont répondu à nos questions.
Proches des évangéliques américains
Bien que radicale, la position de Torah Box est loin d'être isolée dans le monde juif. « Ils représentent une tendance du judaïsme aujourd'hui en France, très inspirée par le judaïsme ultraorthodoxe d'Israël », explique Michaël Azoulay qui, lui, ne se reconnaît pas dans Torah Box. Certains rabbins consistoriaux interviennent d'ailleurs sur ce site. « Ils ont une influence terrible chez les Français, juge Yeshaya Dalsace, du courant Massorti. Ils sont proches, dans leur état d'esprit, des évangéliques américains. Pour moi, ce sont des gens qui sont à la limite d’une pensée païenne, je ne crois pas que ce soit très casher. »
Avant de faire son « Alya », c'est-à-dire de partir en Israël, Mordehai Bitton a travaillé auprès d'un autre rabbin, Ron Chaya. Sur le site de l'institut religieux Leava, celui-ci dit avoir déjà reçu des homosexuels dans sa yechivah et affirme que certains peuvent « devenir hétérosexuels ». Il ajoute : « Dieu gère le monde, et lorsqu’Il crée un homme homosexuel, Il lui demande aussi de ne pas fréquenter les hommes. Le Machia’h [le messie qui doit venir sur Terre, ndlr] se dévoilera très bientôt et éliminera toutes ces tendances de ces gens, amen. » Ron Chaya, qui n'a pas répondu à notre demande d'interview, fait partie des soutiens controversés du député français UDI Meyer Habib, fervent défenseur du gouvernement israélien.
Orthodoxie moderne
Malgré cette poussée ultraconservatrice, des ouvertures existent, y compris dans le courant orthodoxe. En 2019, le Beit Haverim, qui compte une centaine d'adhérents, a intégré le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) après trois demandes d'admission. Un « moment historique » pour Alain Beit : l'institution, qui a plutôt un rôle politique, comprend tout de même des représentants religieux. La même année, en novembre, le président du Beit Haverim est intervenu pour la première fois lors des Assises du judaïsme à Bordeaux, au cours d'un discours très applaudi appelant notamment à former les rabbins à l'accueil des fidèles LGBT+. Le grand-rabbin de France n'était pas présent à cet événement, pourtant organisé par le Consistoire.
À LIRE AUSSI : Argentine : premier mariage juif célébré entre deux femmes
Emile Ackermann, 23 ans, a créé en 2017 le cercle d'étude Ayeka pour promouvoir en France le courant de l'orthodoxie moderne, très développé aux États-Unis. « C'est l'idée qu'il peut y avoir un tri bienveillant dans les valeurs occidentales, notamment sur les grandes questions comme la place de la femme ou des personnes LGBT », développe-t-il auprès TÊTU. Lui et sa femme Myriam étudient à New York pour devenir rabbins. En revenant en France pour exercer leur fonction religieuse, ils espèrent bien faire bouger les lignes au sein du Consistoire. « Notre but, c’est que l’accueil existe partout. On ne peut plus s’abriter derrière la question légale pour refuser de traiter tout le monde comme des êtres humains. Il y a un danger de mort, la communauté LGBT a un taux de dépression et de suicide très élevé, c'est une urgence. »
Une démarche que salue Alain Beit, le président du Beit Haverim auprès duquel le couple Ackermann est déjà intervenu : « Beaucoup de gens me demandent : « Alain, pourquoi tu perds ton temps avec le Consistoire ? On a de toute façon les mouvements libéraux. » Je leur réponds que, dans le Consistoire, il y a énormément de monde, des familles, des gens confrontés à ce sujet. On ne peut pas les laisser tomber. »
Crédit photo : Pxfuel