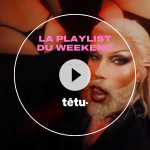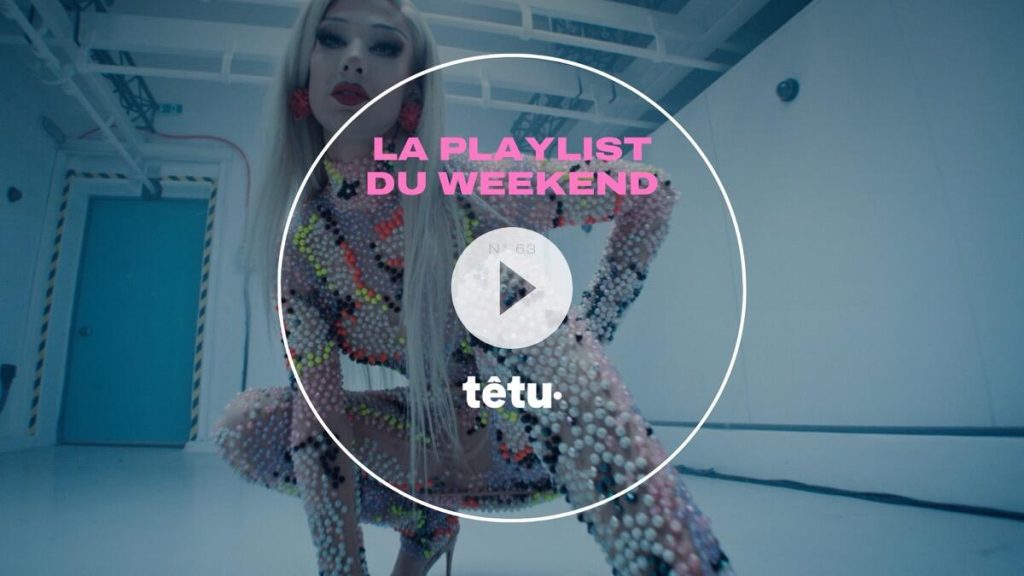Il est timide. On sent ses hésitations, chauqe mot est pesé. Les phrases sont brèves. Presque trop. On se dit que son style est un peu court et puis finalement non. Il dit peu, mais dit l’essentiel. Précis et calme. De passage à Paris avant de rentrer chez lui et de s’isoler, à Montréal, cause Covid et quatorzaine, Antoine Charbonneau-Demers nous a répondu dans les locaux de la maison Arthaud, place de l’Odéon. Un bureau face au théâtre dans le quartier historique de la littérature française, celui des éditeurs, du jardin du Luxembourg. Un décor pas très raccord avec la conversation de ce jeune écrivain qui n’a rien d’académique.
Antoine est arrivé à Montréal en 2014 après une enfance et une adolescence passées à l’ouest du Québec, en Abitibi, né dans une ville minière de parents profs qui l’ont toujours poussé à lire. Sans doute trop. Avant l’âge de dix-huit ans, il n’avait pas ouvert un livre. Il a commencé au Cégep — une classe, au Québec, entre lycée et université — où il découvrit la chose, émerveillé. Le déclic : Coco, prix du premier roman, des nouvelles, et puis ce second, Good boy, roman d’apprentissage. « Ce livre est né quand j’ai vécu mes premières expériences urbaines, amoureuses, mais aussi paranoïaques. »
Chez Charbonneau-Demers, la frontière entre réalité est fantasme est poreuse : « Le réalisme magique me plait beaucoup. Les rêves font partie du réel. Ça me frappe que les gens se focalisent sur les événements observables par tous, alors que ce qui nous arrive comme des hallucinations est aussi important. »
Dans un roman d’apprentissage, on fait des découvertes. « Il est question de la sexualité, de l’utiliser comme ascenseur social. C’est aussi une façon de répondre à ma famille. Montrer la sexualité, ça veut dire : regardez. Regardez enfin ce que je suis devenu. Je suis une personne sexuelle. Au fond, c’est très frustrant, quand on est homo, d’être désexualisé pour ne pas déranger. Cette sexualité racontée, c’est en quelque sorte : regardez-moi. J’ai vécu dans un monde qui ne peut me compter, alors je vais inverser les choses. »
C’est ce rapport au corps masculin qui est au coeur de ce livre, un corps homosexuel dont on lit les désirs. Après le Cégep, Antoine Charbonneau-Demers a fait le conservatoire. Une formation d’acteur, dont il a gardé le gout de la mise en scène. « J’utilise mon compte Instagram de cette même façon. J’ai l’impression de devoir, à travers la littérature et mes personnages, me donner en spectacle. Avec la pensée que si je ne montre pas un corps homosexuel, il est inutile. S’il reste intime, il n’en vaut pas la peine. Ce qui est vivant parle de soi-même. » Montrer et écrire des corps homosexuels, pas uniquement parce qu’il les connait, mais parce que c’est à ses yeux un devoir. « Ce qui me fâche le plus, c’est de voir des auteurs gays écrire des histoires d’hétéros. »
Il s’agit donc de se raconter. Si on ne connait pas le prénom de son narrateur qui dit je, c’est simplement que c’est lui, le je, en grande partie. « Ce sont souvent les femmes qui ont fait l’autofiction. Des gens comme nous, les homos, qui ont été tassés. L’autofiction des hommes blancs, c’est de celle dont on ne veut plus, celle des cis', on la connait… Ça me frustre au plus haut point quand quelqu’un me dit : ‘Tu as de bonnes idées.’ Non, c’est la réalité de ce que je vis, je ne passe pas par des détours. Ce n’est pas être nombriliste, c’est dire au monde : j’ai quelque chose à dire que vous ne connaissez pas. »
Ceux qui en ont marre des Christine Angot ou des Annie Ernaux peuvent passer leur chemin. Angot, Ernaux, Hervé Guibert, les influences premières de l’auteur pour qui cette autofiction, explique-t-il, ne rime pas forcément avec une écriture du quotidien, plaintive, auto-centrée. Par ailleurs, il dit ne lire que peu d’auteurs gays : « J’ai peur de voir que d’autres sont allés plus loin que moi. C’est comme les réseaux sociaux, encore une fois. On y a toujours l’impression que les gens font des choses extraordinaires. Ça me fait peur. Guillaume Dustan, par exemple. Il était plus gay que moi et meilleur. J’en ai honte. »
Il y a le sexe. Et il y a la mère aussi. Un thème qu’il n’a pas fini de creuser… « Quand on la quitte pour rejoindre une grande ville, on ne peut plus s’en occuper. Mais peut-être qu’on ne le peut jamais vraiment, au fond, je ne sais pas… J’ai voulu travailler là-dessus en tout cas, sur cette frustration. Ma mère était malade pendant l’écriture de ce livre. C’était lié. Je sentais que là où je devais être c’était près d’elle, mais l’ascension sociale à laquelle j’aspirais prenais plus de place. »
La culpabilité est tenace. Une de ses nouvelles racontait l’histoire d’un garçon qui perd sa mère et se met à lui ressembler, transformant son corps par la chirurgie pour retrouver ses traits. Récemment, il a sorti un roman au Québec qui s’appelle Daddy. « Ça parle de ma relation avec un amant, mais aussi de la pandémie. Je l’ai écrit en me disant que je voulais être le premier Québécois à écrire là-dessus. » En parlant de québécois, certains dialogues de Good boy ne sont pas traduits. Il préfère que les Français devinent, certains jurons par exemple. « C’est une couleur, davantage que quelque chose de précis. » On imagine qu’il pourrait dire : « Regardez, lisez cette langue que vous ne connaissez pas. » On entend une gifle dans le filet de sa voix.
Extrait
« J’entre dans ce magasin qui coûte trop cher. Je sais ce que je veux, les tailles les plus petites, pour une fois, même si ma mère m’a toujours préféré dans du linge trop grand. Maintenant, je m’aime mince, maigre. Ceux qui disent que ce sont les gros qui sont normaux, qui disent : voici la vraie beauté, des corps normaux, et nous montrent des gros, allez chier, j’encule vos trois cents livres avec mes cent dix-huit. J’adore mes os, les hommes rêvent la nuit de me les arracher pour les briser, je chéris les petits muscles sous ma peau fine. Parfois, je tâte les os de mon bassin, je presse mon ventre jusqu’à sentir ma colonne à travers et je m’imagine une queue là-dedans qui viendrait me mélanger les organes, les presser contre les parois de ma petitesse, me trouer le boyau central et me dériver le réseau transitoire. Brassez-moi ça, ça stagne depuis bientôt vingt ans. C’est pour ça qu’ils doivent avoir l’âge de mon père, être bâtis comme du bétail à la charge, pour que je sente que je suis le plus petit de toute la race, le plus jeune, le plus frais, je sors d’un oeuf, gluant comme au premier jour, les yeux noirs de n’avoir encore jamais vu clair. C’est tout rose en dedans, jouissez-y avant que le temps ne le fasse à votre place. »