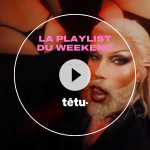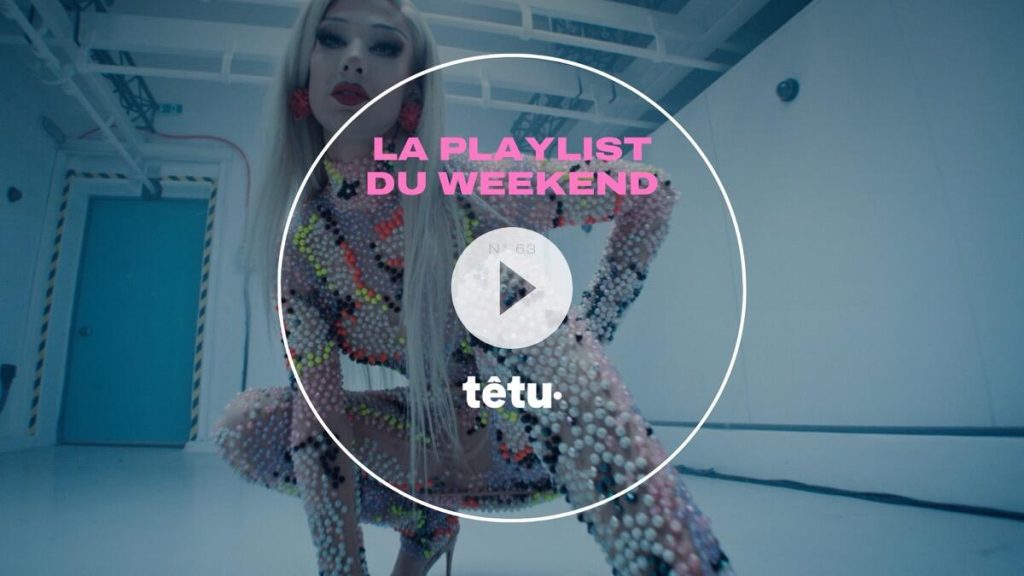À 91 ans, Dominique Fernandez signe L’Homme de trop aux éditions Grasset. Son 57e livre, premier volet d’un dyptique romanesque qui retrace, à travers la vie d’un homme gay, quarante ans d’histoire.
C’est un immeuble comme un autre, quelque part du côté de Pigalle, entre le Moulin-Rouge et deux sex-shops. Le vieil écrivain nous répond à l’interphone d'une voix claire, nous accueille en chaussons, la porte ouverte. Il nous attendait sans manière, sourire aux lèvres et taille de guêpe. On avait presque le trac de le rencontrer. L’Académicien français s’empresse de nous assurer qu’il a reçu ses deux doses de vaccin, histoire de nous mettre à l’aise. On s’assoit à la table d’une salle à manger qui pourrait être une bibliothèque tant des centaines de livres y trônent en majesté. Partout dans la pièce, mais en fait partout dans l’appartement – un grand appartement-bibliothèque qui abrite quatre-vingts ans de littérature et plus encore – les livres de sa vie et ceux qu’il a hérités de son père, l’écrivain et critique collabo Ramon Fernandez, dépeint avec sa femme dans L’Amant de Duras.
À lire aussi : Alain Guiraudie : "J’écris contre ce que je fais au cinéma"
Dominique, miroir de ce père aussi aimé que détesté, a appelé son fils Ramon aussi pour perpétuer la tradition mexicaine. C’est pourtant vers l’Italie qu’il s’est tourné ensuite, agrégé d’italien, docteur ès lettres, auteur de dizaines de livres sur le pays de la ville éternelle. Des dizaines d’ouvrages surtout sur l’homosexualité, au premier rang desquels peut-être L’Étoile rose en 1978. Un titre qui renvoie sans détour à la barbarie nazie, étoile symbole de la persécution séculaire des homosexuels. Fernandez y racontait la traversée, sur plusieurs décennies, d’un homme qui en aimait d’autres. L’homosexualité masculine, c’est le grand sujet de l’auteur.
Il y eut Porporino ou les mystères de Naples sur un castrat, prix Médicis ; Dans la main de l’ange autour de Pasolini, prix Goncourt ; Tribunal d’honneur à propos de Tchaïkovsky ou La Course à l’abîme du Caravage… On était impatient d’écouter celui qui aime à se présenter comme « le premier immortel ouvertement gay », même si on ne sait pas ce que Marguerite Yourcenar et Jean Cocteau penseraient de cette assertion. Écouter les souvenirs de celui qui, du haut de ses 91 ans, a l’élégance de la sagesse. Apprécier l’esprit d’un homme qui se sent jeune et qui, jusque l’année dernière encore, continuait à nager tous les jours ou presque. Qui n’a pas oublié pour autant les épines des roses qu’il a reçues. Qu’il soit ici profondément remercié pour la parole et la plume qu’il a tenues.
L’Homme de trop est-il une suite de L’Étoile rose, votre livre paru il y a plus de quarante ans ?
Dominique Fernandez : J’avais écrit L’Étoile rose comme une histoire de l’homosexualité à cette époque, c’est-à-dire le début de la libération des homosexuels. J’ai eu l’idée d’écrire non pas une suite, car ce ne sont pas ici les mêmes personnages, mais un nouveau point sur la question gay. Il y a tellement de changements, c’est prodigieux ! C’est peut-être sur ce point, dans une société où tout va mal, que l’on a fait le plus de progrès. Je voulais voir justement où l’on en est, est-ce que tout va bien, est-ce qu’il y a encore des réserves… Sous forme romanesque toujours, non pas comme un essai. Je l’ai commencé il y a trois ou quatre ans, la seconde moitié est déjà écrite mais paraîtra dans un an et retracera l’histoire du mariage pour tous jusqu’à aujourd’hui. En décembre 2012 il me semble, j’avais défilé avec d’autres de la Bastille au jardin du Luxembourg. J’ai milité pour le mariage comme j’ai milité pour le Pacs. J’ai toujours voté socialiste, contre de Gaulle, mais les socialistes ont souvent été homophobes… François Hollande a attendu bien trop longtemps pour faire passer le mariage ! Il fallait le faire tout de suite après son élection. Pour revenir à ce livre, l’idée était de raconter un homme d’une soixantaine d’années qui dit je, qui n’est pas moi, mais qui raconte à un homme plus jeune qui ne sait pas. À un homme qui est né libre. Il y a un tel fossé entre mon époque, antédiluvienne, et les années quatre-vingts, quatre-vingt-dix… C’est effarant.
"La France, c’était la Russie d’aujourd’hui. C’était horrible."
Un autre monde ?
Avant, nous étions les parias. Dans mon enfance, dans mon adolescence, plus tard quand j’étais étudiant, personne n’en parlait jamais. Ni dans les journaux, ni dans les discours. Il n’y avait pas de film, pas de roman, pas de publicité. Évidemment, il y avait des gens. On savait que Gide ou Cocteau étaient homosexuels, mais c’était lointain, la stratosphère… Les hommes ne vivaient pas ensemble, cela n’existait pas, c’était impossible. Pour les filles, ça pouvait passer, c’était un peu différent. À mes yeux, c’était le critère : quand deux garçons pourraient vivre ouvertement ensemble un jour, payer un loyer commun, ce serait alors la liberté. Ce qui est toujours bien sûr impossible ailleurs, comme en Russie par exemple. La France, c’était la Russie d’aujourd’hui. C’était horrible. (Silence.) Horrible de ne pas pouvoir parler, à ses parents bien sûr, à ses profs non plus, mais même à ses camarades. Certains étaient comme moi, sans doute, mais on était muré sans espoir dans une solitude totale. Nous ne vivions que des aventures sordides de temps en temps. Il n’y avait pas de vie ouverte possible, pas de vie « publique ». Voilà ce à quoi ressemblait ma jeunesse, si différente de celle des gens d’aujourd’hui.
À quel moment avez-vous vu cette libération que vous espériez ?
En 1968. Ça a été le pivot, les verrous ont sauté. Reste de mai 68 la libération des moeurs, pour les hétéros aussi. La politique, le reste n’ont pas beaucoup changé, mais les moeurs, oui. Tout à coup, quelque chose a éclaté. Dès lors il y a eu le Fhar (Front homosexuel d’action révolutionnaire, ndlr) en 1971, puis le journal Le Gai pied fondé en 1979 par Jean Le Bitoux, auquel j’ai participé. Je m’étais marié en 1961, avec une femme (l’écrivaine Diane de Margerie, ndlr) qui savait très bien que j’étais homosexuel. Je voulais vivre avec la personne que j’aimais, les petites aventures ne m’intéressaient pas. Je ne pouvais vivre avec un homme alors j’ai été avec cette femme très intelligente, nous nous sommes très bien entendus pendant dix ans. C’est grâce à mai 68 que j’ai pu vivre avec un garçon ensuite.
"Gide fut à mon sens la personne la plus courageuse sur la question de tout le XXe siècle."
Est-ce l’enfermement de votre jeunesse qui vous a amené à placer la question gay au coeur de votre oeuvre ?
Oui. J’imaginais être comme un juif dans un ghetto. Mais un juif qui n’aurait pas le droit de parler à un autre juif du ghetto. J’ai grandi avec cela, alors je me suis interrogé là-dessus, j’ai lu tout ce que je pouvais. C’est devenu mon sujet principal. Je me suis passionné pour Gide, pour Cocteau que j’ai déjà cités. D’autres écrivains étaient cachés : François Mauriac, Henry de Montherlant… Jean Genet vint plus tard, Julien Green aussi, mais c’était encore une fois toujours dans la culture, pas dans la vie quotidienne. C’est bien beau la culture, mais il nous fallait des exemples familiers ! Ces gens-là, comment vivaient-ils ? Gide n’a jamais vécu avec un garçon, il était surtout pédophile, allait en Algérie… Cocteau, contrairement à ce que l’on croit, n’a pas vécu avec Jean Marais. Il était lâche, il a écrit le très beau Livre blanc en 1928 mais sans nom d’auteur, connu des seuls initiés, tiré à un très petit nombre… L’édition publique fut posthume, cela n’a pas été très utile. Bien sûr, Corydon, l’essai de Gide, a été capital. Il n’est plus lu aujourd’hui, il est moqué… Gide y écrit que les canards aussi sont pédés ! (Rires.) On parle là tout de même d’une parution en 1924 sous son nom. Tous ses amis se retournèrent contre lui ! Gide fut à mon sens la personne la plus courageuse sur la question de tout le XXe siècle. Il le pouvait parce qu’il était riche, bien sûr, mais même dans son milieu on l’a critiqué. Marcel Proust quant à lui est très sévère contre l’homosexualité… Charlus est plutôt un personnage décadent, perverti, qui à la fin se fait fouetter dans le Temps retrouvé. Proust n’a pas contribué à véhiculer une bonne image de l’homosexualité.
C’est donc parce que Cocteau n’a jamais dit publiquement son homosexualité que vous êtes devenu le premier membre de l’Académie française ouvertement homosexuel, en 2007 ?
Oui, c’est vrai ! Comme partout, il y avait évidemment déjà eu des homos sous la Coupole. D’illustres, comme Julien Green qui ne l’a jamais dit. Comme Montherlant, encore moins. J’ai voulu quelque part assurer à l’homosexualité une reconnaissance officielle. D’ailleurs, je pensais que pour cette raison les Académiciens ne m’éliraient pas. La majorité des membres est d’une homophobie effrayante. J’ai su ce qu’on a dit après mon élection… Je me présentais face à Assia Djebar, qui a été élue après. Un académicien lançait : « On a le choix entre une bougnoule et un pédé ! » Un autre : « Oh, je croyais qu’il y en avait déjà assez comme ça ! Je croyais que le quota était atteint ! » Des gens comme Jean Dutourd, par exemple. Jacqueline de Romilly, elle, a dit un drôle de truc : « Nous avons deux candidats. Une qui aime trop les femmes — Assia Djebar était féministe — et l’autre qui ne les aime pas assez. » Qu’est-ce que j’ai entendu, vous savez… La différence, c’est qu’aujourd’hui sans doute il n’oseraient plus le dire. Ça n’empêche pas de le penser, comme le fait de dire que l’on est antisémite est impossible mais n’empêche pas de l’être. Je voulais que l’homosexualité sorte définitivement du ghetto. Autrement, l’Académie ne m’intéressait pas tellement. C’est un cénacle de droite. Jusqu’à la fin du XVIIIe, la moitié des académiciens étaient des prélats. C’est pour cela que j’ai voulu rentrer, pour mettre un coup de pied dans tout ça !
Et vous avez fait graver Ganymède sur votre épée !
(Il se lève et va la chercher.) Vous voyez, Ganmyède (un amant de Zeus dans la mythologie, ndlr) est à cheval sur son aigle. C’est une statue qui se trouve à Florence, reproduite. Ça aussi, ça les a beaucoup choqué… Aujourd’hui je crois qu’ils comprennent quand même que les homosexuels ne sont pas des dépravés, des pervers. En tout cas je me suis engagé. J’ai milité, signé des tribunes notamment dans le Nouvel observateur. J’ai écrit le premier livre sur le Pacs (Le Loup et le chien, Pygmalion, 1999, ndlr), le premier roman sur le sida aussi (La Gloire du paria, Grasset, 1987). Ce serait bien que je ne sois pas le seul à l’assumer à l’Académie, que d’autres entrants le soient ouvertement.
"Les purs hétéros se foutent complètement de la vie privée des autres."
Avez-vous tout de même été soutenu par certains ?
Par Angelo Rinaldi, oui. Yves Pouliquen. Et Valéry Giscard d’Estaing. Giscard m’avait appelé pour me dire qu’il soutenait ma candidature. Il était le seul. Il était même venu chez Grasset, le soir de mon élection, pour le pot organisé par mon éditeur ! Il m’avait lancé ce soir-là (il imite Giscard) : « Je suis très très content que vous soyez élu, mais pas trop de prosélytisme quand même ! » (Rires.) Au fond, souvent les homophobes sont des homos refoulés… Ils sont furieux que les autres soient libres quand eux ne le sont pas. Les purs hétéros se foutent complètement de la vie privée des autres.
Vous avez signé en 2006 un livre de correspondance avec Arthur Dreyfus, Correspondance indiscrète (Grasset). Quel regard portez-vous sur son dernier ouvrage, Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui qui vient de paraître chez P.O.L ?
Dans notre livre, on avait voulu expliquer justement, un peu comme je le fais aujourd’hui, les différences qui existaient entre la jeunesse d’un homosexuel de mon âge et la vie aujourd’hui d’un jeune comme lui. Arthur, je suis son premier lecteur. Je l’aime beaucoup, on est très amis. Je suis un peu perplexe, je dois dire. Embarrassé. Il avait déjà écrit Histoire de ma sexualité (Gallimard, 2014). Il a raison de le faire, si c’est une nécessité, mais je suis personnellement contre l’étalage de la sexualité. Contre c’est beaucoup dire, mais disons que ça ne m’intéresse pas. Il y a là une franchise, une crudité d’ailleurs très belle, très forte. Tout ce qui est vrai, quelque part, est bon, mais je vois plutôt ça comme un document que comme une oeuvre d’art. Un témoignage d'une sexualité éparpillée, multipliée, frénétique, ininterrompue…
À lire aussi : Arthur Dreyfus : "Je suis plutôt doué pour l'autodestruction par le sexe"
Il fait beaucoup penser au journal non expurgé de Julien Green...
On voit bien là les deux époques. Julien Green y décrivait en effet ses aventures homosexuelles dans le Paris gay de l’avant-guerre et avait lui-même censuré son journal. Il avait bien fait la différence entre ce qui est arrivé dans sa vie, et ce qui était intéressant pour les autres… Bien sûr, il y avait l’impossibilité de faire publier cela à cette époque. Il avait un public féminin, il était très lu ! Mais Julien Green suggérait. Les malfaiteurs, les rôdeurs, les fantômes, les mystères… Je trouve cela plus fort, la suggestion, mais c’est un point de vue personnel.
Pensez-vous qu’écrire la sexualité aujourd’hui n’a plus d’importance ?
Autrefois, c’était important. C’était écrire contre le pouvoir, les autorités, les conventions, contre tout. Aujourd’hui, non, moins… C’est politique en Russie, en Iran, au Brésil, dans les 9/10e du monde, mais en France non. Il y a surtout encore du travail à faire dans l’opinion. Dans les campagnes, dans les petites villes, dans certains milieux à Paris, l’homophobie continue, bien sûr. Des gosses sont mis à la porte par leurs parents. Mais l’homophobie, à mon sens, ne disparaitra jamais vraiment. Le différent, le juif, le Noir… La société a besoin de boucs émissaires que l’on charge de tout ce qui va mal. Il y a en revanche, pour les droits des homosexuels, toujours un retour de bâton possible. Imaginons une certaine droite au pouvoir : il faut être vigilant, ne rien laisser passer ! La PMA, la GPA… Ce sont des avancées, qui me sont plus éloignées, mais qui sont nécessaires aussi à mener.
Songez-vous aux traces que vous laisserez ?
Vous savez, seul le temps décide. On peut disparaître complètement. Quand je regarde les écrivains du passé qui avaient la gloire il y a cinquante ans et que personne ne connait plus… Regardez Paul Bourget, Henri de Régner, Anatole France même, tous ces gens-là… Ils existent, mais on ne les lit plus. Il y en a qui restent, qui deviennent de grands classiques, et d’autres qui disparaissent sans que l’on sache trop pourquoi. Si l’on doit retenir certains de mes livres, j’aimerais que ce soit ceux-là, ceux qui parlent d’homosexualité. J’ai contribué un peu à faire avancer les choses ! Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur de François Mitterrand dès 1981 était l’époux d’Edmonde Charles-Roux, une de mes grandes amies. Elle lui avait faire lire L’Étoile rose. Sa première mesure, place Beauvau, avait été d’interdire aux flics de tabasser les pédés. Defferre avait fait passer une circulaire en ce sens, après avoir lu le livre. L’Étoile rose était sur sa table de chevet quand il est mort.