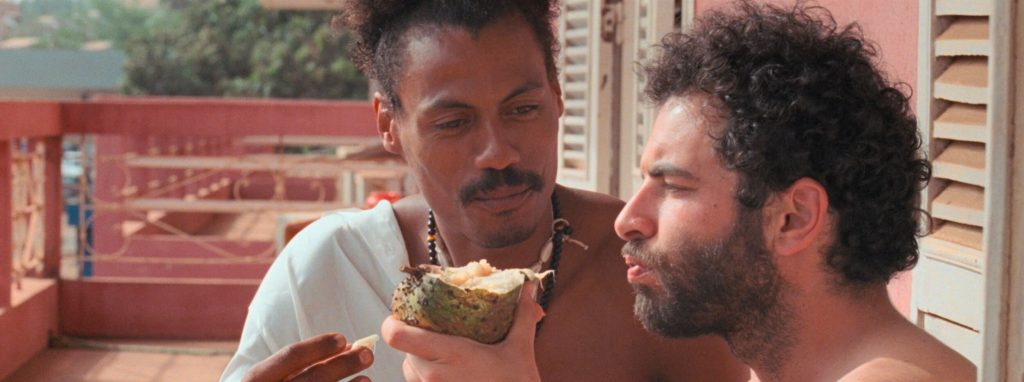[Article à retrouver dans le magazine têtu·] Entre le coming out de Bertrand Delanoë en 1998 et la nomination de Gabriel Attal à Matignon, la société française a bien changé. Mais, chez certains, l'identité sexuelle reste un angle d'attaque contre un adversaire politique.
En 1998, en plein débat sur le pacs, Bertrand Delanoë, sénateur socialiste et futur maire de Paris, parle de son homosexualité dans un portrait que lui consacre Zone interdite sur M6. Dans notre histoire politique, c’est le premier coming out au retentissement national (l’ancienne députée Françoise Gaspard et l’ancien maire de Pau André Labarrère avaient moins de surface médiatique). “J’étais adolescent à l’époque, dans ma petite ville de province, et je me rappelle l’avoir vu à la télévision, ça m’a bouleversé. Je me suis dit que c’était possible de réussir en politique”, se souvient Maxime Crosnier, aujourd’hui porte-parole des Écologistes à Paris, dans le livre de Sonia Tir, Sortir du placard, LGBT en politique (Fayard).
À lire aussi : 9 docus et films à voir pour la Journée mondiale contre les LGBTphobies
À l’époque, le risque de la visibilité homo en politique est assez simple : perdre le vote des électeurs et flinguer sa carrière. “Je voulais déjà être candidat à la mairie de Paris et j’étais persuadé que si je me révélais comme cela, c’était fichu, je perdrais la campagne. Mon entourage politique dans mon propre parti me disait de ne pas le faire car je risquais de m’affaiblir”, se souvient l’ancien maire de Paris dans le livre. La droite lui chante l’air de la vie privée, bien pratique pour interdire de parler d’homosexualité sans avoir l’air homophobe. “Ils disent que j’ai été impudique, mais bon, ceux qui exhibent leur vie privée hétérosexuelle, ce n’est pas moi. Quand c’était un mec qui s’affichait avec sa femme dans Paris Match, ça ne posait pas de problème, tout le monde le faisait et trouvait cela super”, rétorque Bertrand Delanoë à Sonia Tir.
Des magazines people…
À gauche aussi, quelques voix militantes venues de la communauté LGBTQI+ s’en prennent à sa visibilité, jugée insuffisamment politique. Pour la mairie de Paris, elles préféraient un Jack Lang gay-friendly à un Delanoë out. Dans un article de Libération en 2000 sur le coming out en politique, la politologue ouvertement lesbienne Fiametta Venner résume : “Delanoë a une conception idiote de l’intégrationnisme. Il ne se mouillera pas pour les causes homosexuelles, il aura toujours peur d’être soupçonné de communautarisme.” Thomas Doustaly, alors directeur de la rédaction de têtu·, explique au quotidien : “Son coming out renforce ce besoin d’être accepté, d’être ‘normal’. Il dit en substance : il n’y a pas de lien entre ma vie privée et mes engagements politiques.” Une flèche un peu rude, alors que Bertrand Delanoë assume bien seul sa visibilité. Et s’il a effectivement toujours tenu à ce que son engagement politique ne puisse pas être réduit à son homosexualité, il signale : “C’était du militantisme car, à l’époque, je voulais déjà être candidat à la mairie de Paris.”
Vingt ans plus tard, le secrétaire d’État au Numérique d’Emmanuel Macron, Mounir Mahjoubi, veut définitivement ranger l’homosexualité dans la case “normal”. En 2018, il accepte de poser avec son mari dans le magazine Paris Match. Cette mise en scène de son couple homo est une première pour un membre du gouvernement en exercice. Mounir Mahjoubi enfonce le clou sur France Info : “Nous sommes heureux, nous sommes normaux, nous sommes même assez chiants si on se dit les choses. On est absolument comme tous les couples.” SOS homophobie salue alors “un exemple positif pour toutes les personnes LGBT”. En octobre 2018, on voit même le couple main dans la main sur le perron de l’Élysée, à l’occasion d’un dîner d’État.
Le secrétaire d’État a mis une condition à cette peoplisation : “Je ne voulais pas être le ‘ministre gay d’internet’, je voulais quand même qu’on mentionne mon action et pas juste mon orientation sexuelle.” Il était loin d’imaginer que les photos allaient traverser la Méditerranée jusqu’au Maroc, où vit une partie de sa famille, notamment le père du ministre avec qui il n’a plus de relation depuis ses 16 ans. Dans ce pays où l’homosexualité est illégale, son couple est mentionné jusqu’au journal télévisé. Sa mère reçoit des pressions et des insultes. “Je sais la responsabilité que j’ai en tant qu’Arabe, gay, marié à un Juif. Je suis le seul dans ma situation politique et c’est important d’être un modèle pour les jeunes et ceux qui n’osent pas”, assume-t-il auprès de Sonia Tir.
…à Matignon
Six ans seulement ont passé, et l’initiative pionnière de Mounir Mahjoubi paraît déjà loin, maintenant qu’un homme ouvertement homosexuel a été nommé à Matignon. Une séquence qui a montré un nouveau durcissement des positions sur la visibilité gay en politique. C’est en effet de la communauté LGBTQI+ qu’est parti l’essentiel des critiques adressées sur le sujet à Gabriel Attal. Manifesto XXI, média intersectionnel, y voit une “pilule rose pour faire avaler une ligne politique raciste, liberticide et anti-démocratique”. Mediapart le considère comme “gay mais pas trop”, voulant pointer par là que “cette visibilité ne gomme pas le bilan d’un fidèle parmi les fidèles de Macron”. Et d’appeler en renfort un doctorant en sociologie qui dénonce “les horreurs racistes, classistes, cishétérosexistes que son homosexualité rendra possible” : “Un gouvernement dirigé par un homme gay est nécessairement un gouvernement respectable. Le gouvernement a voté une loi raciste ? Impossible, il est dirigé par un homme gay. Le gouvernement a voté une loi sexiste ? Impossible, il est dirigé par un homme gay.” Ainsi, Gabriel Attal n’est plus un homme politique qu’on attaque sur son bilan, ses idées ou son programme : il est “un gay”, réduit à n’être qu’une caution gay, dont on peut attaquer l’identité sexuelle.
D’autres ministres d’Emmanuel Macron ont fait leur coming out, comme Franck Riester (dès 2011), Clément Beaune (en 2020 dans têtu·), ou Sarah El Haïry (en avril 2023), sans que leur sexualité et leur visibilité deviennent des arguments utilisés à leur encontre. Celui d’Olivier Dussopt dans têtu·, en revanche, a fait l’objet des accusations les plus virulentes. Alors ministre du Travail, il vient de remettre au Conseil constitutionnel sa réforme des retraites adoptée par 49.3 quand nous publions le 24 mars 2023 notre interview, titrée par cette citation : “Nous aurons peut-être à réutiliser le 49.3.” Bien que ces propos ne soient absolument pas de nature à démobiliser les opposants à la réforme, une horde de militants s’abat sur le journal en hurlant à une opération de diversion concertée avec le pouvoir. Comme si têtu· ne devait pas s’occuper de sujets politiques, l’élue écologiste Sandrine Rousseau nous compare sur BFMTV à “Pif Gadget et Playboy”…
Je vous adore @TETUmag @Pifofficiel @Playboy
J’aime moins la stratégie de communication du gouvernement. https://t.co/SrGdoqnUl8— Sandrine Rousseau (@sandrousseau) April 1, 2023
Revenant sur cette séquence, Olivier Dussopt répond à Sonia Tir : “Ce n’était pas une interview complaisante, [la rédaction de têtu·] partait du postulat que la réforme était nuisible pour les LGBT. J’ai dû m’expliquer. Et, oui, effectivement (…), je suis fin prêt à parler de ma vie privée, je savais que la question me serait posée et je ne l’ai pas esquivée. Voilà, c’est tout, et le reste, je m’en fous, je laisse les malades de méchanceté méditer. Si on est convaincu que l’orientation sexuelle ne pose plus de problème, on ne devrait même pas pouvoir me reprocher cela.”
Dans son livre Le Génie lesbien, Alice Coffin écrit : “S’en prendre à une femme de pouvoir, c’est débrider la machine à sexisme.” La phrase a été saluée, mais a-t-elle été comprise ? La conseillère de Paris fait partie des politiques qui ont toujours porté leur visibilité en bandoulière : “M’afficher et me proclamer lesbienne, je le fais tout le temps, explique-t-elle à Sonia Tir. Être lesbienne me rend meilleure politique, cela permet d’être aux prises avec ce système qui peut écraser les minorités, de comprendre la politique sur les gens. Je le vis au quotidien en tant que femme lesbienne politique, donc je peux d’autant plus savoir comment le combattre.”
À l’exact opposé, “Gabriel Attal ne souhaite en aucun cas que l’on puisse se servir de son orientation sexuelle comme d’une loupe pour juger son travail et son implication”, fait savoir son équipe à Sonia Tir. Lors de sa nomination à Matignon, Libération a salué “que le fait même qu’être gay soit considéré comme une information parmi d’autres (comme son âge ou ses origines) montre les progrès majeurs dans l’opinion publique depuis l’adoption du mariage pour tous en 2013”. À en croire un sondage Ifop réalisé pour Sortir du placard, effectivement, il y a un net progrès. En 1981, 61% des Français estimaient “choquant” qu’un président de la République soit homosexuel ; ils ne sont aujourd’hui plus que 20%. À la question “cela vous gênerait-il de voter pour un·e candidat·e qui ne cacherait pas son homosexualité ?”, seuls 34% des Français·es répondent désormais par l’affirmative, contre 47% en 1996. C’est la bonne nouvelle du livre : un quart de siècle de visibilité croissante en politique semblent, bel et bien, avoir érodé le plafond de verre.
À lire aussi : Violences anti-LGBT en France : tous les voyants sont au rouge
Crédit photographique : Philippe Desmazes/AFP