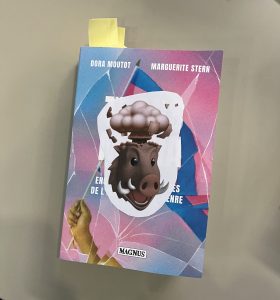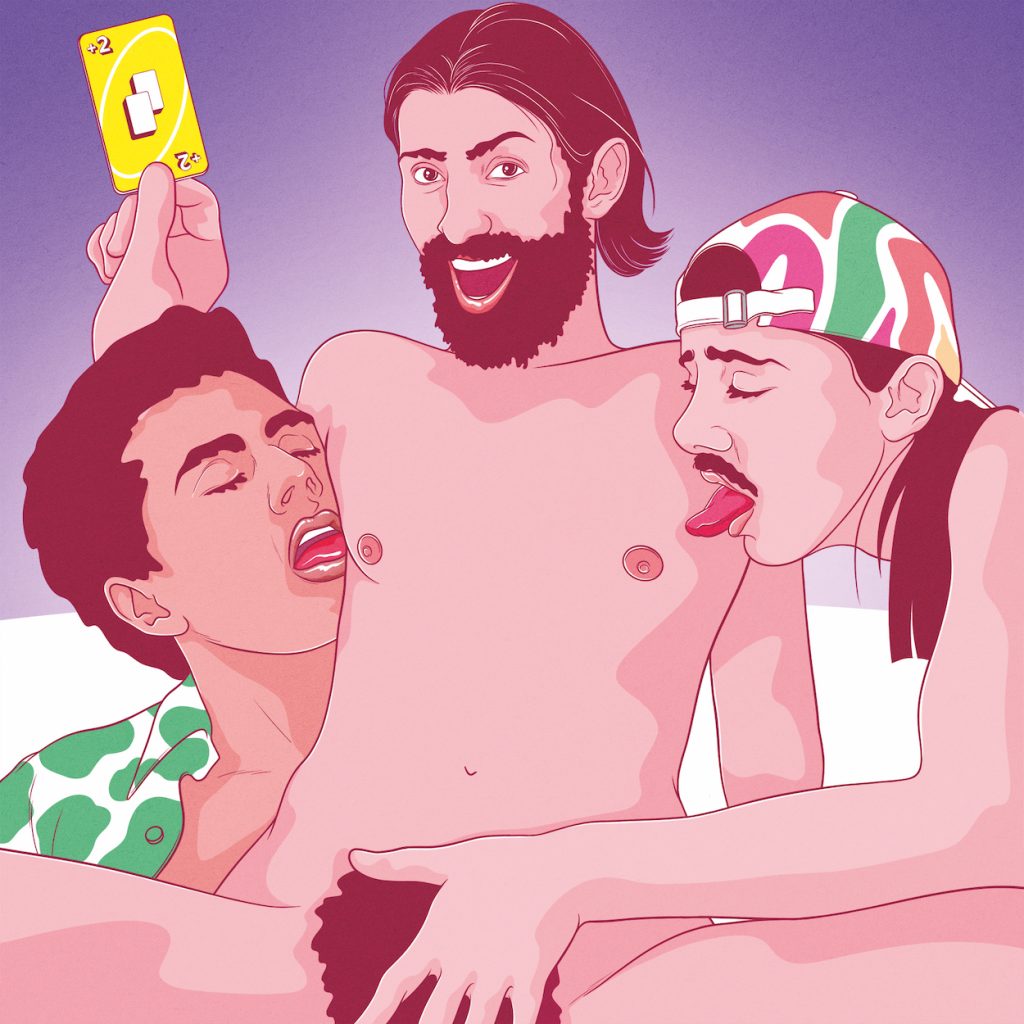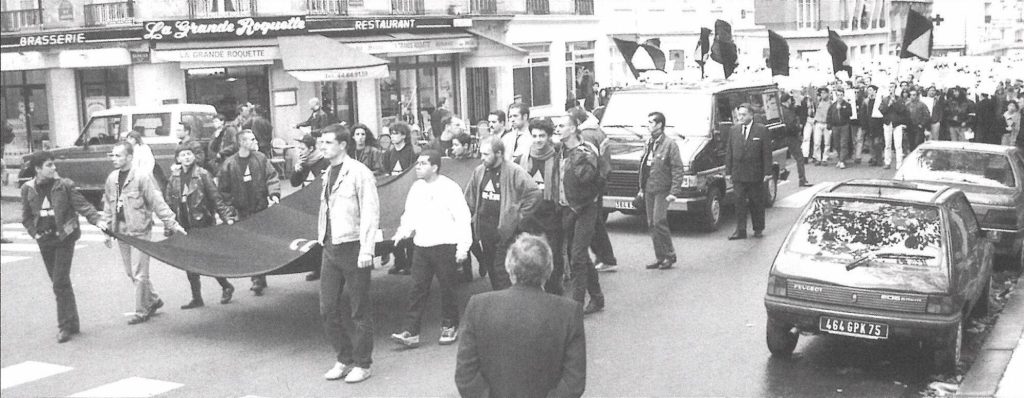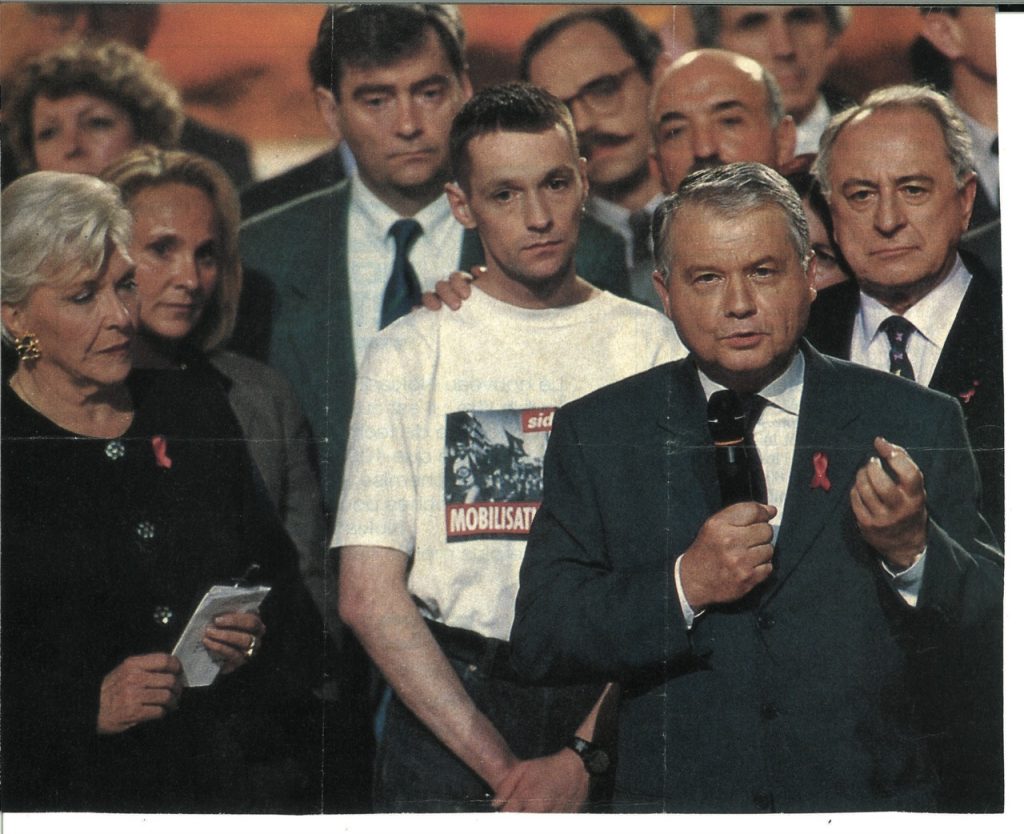Depuis mars 2020, le port du masque généralisé nous réapprend à interpréter les visages et leurs émotions. Pour les personnes trans et non-binaires, cet accessoire a des effets surprenants dans l'espace public. Pour le meilleur ou pour le pire, iels nous racontent comment cet objet a brouillé la lecture de leur genre.
Cet article utilise de l'écriture égalitaire, en accord avec les identités de genre des personnes mentionnées.
Il y a trois ans, lorsque j’ai pris conscience de mon identité de genre fluide, j’ai progressivement commencé à me masculiniser, pour me sentir mieux dans ma peau, plus en accord avec moi-même. Assez vite, je me suis mis·e à entendre des « monsieur » dans les commerces. Certes, ils étaient souvent suivis d’excuses paniquées, mais ils me faisaient beaucoup de bien. Lorsque le port du masque nous a été imposé en extérieur aussi bien qu’en intérieur durant l’été 2020, ces rares moments d’euphorie de genre ont totalement disparu, bien que mes choix vestimentaires d’aujourd’hui crient très rarement « femme ».
Le masque, allié ou ennemi ?
Curieuxe, je me suis mis·e à sonder les regards de mes interlocuteurices, pour voir ce qui pouvait bien me trahir lorsque les longueurs de ma coupe mulet étaient camouflées sous une casquette. Mais je n’ai pas constaté d'œillades insistantes vers ma poitrine, souvent aplatie par un binder (sous-vêtement très serré permettant de masquer la poitrine des gens transmasculins, ndlr) de surcroît, ni sur mes boucles d’oreilles. À tous les coups, c’est parce que je ne me contente pas des fringues chiantes du vestiaire masculin classique et que je porte de la couleur ! J’aimerais me dire que ma pilosité faciale qui se développe avec le début de ma transition hormonale viendra bientôt changer ça, mais avec le port du masque, ce ne sera pas encore pour demain. La frustration, et le mystère, demeurent.
A LIRE AUSSI : On a parlé non-binarité, terfs et poésie avec Alok Vaid-Menon
Pour mon amoureuxe, non-binaire, l’effet a été inverse, pour son plus grand bonheur (et le mien, par ricochet). Depuis que les masques sont devenus l’accessoire à ne pas oublier d’enfiler avant de mettre le nez dehors, les « mademoiselle » et les « madame » pleuvent, lorsqu’iel est habillé·e « de manière féminine ». L’été dernier, iel a même eu le droit à de la drague beauf de mecs cis hétéros — ça, on s’en serait bien passé·e·s. Cette étrange différence d’effet du masque sur la perception de nos genres par les quidams croisant nos chemins continue de me travailler. Après avoir entendu quelques anecdotes similaires chez mes adelphes non-binaires et trans, j’ai voulu savoir où et comment ces vécus pouvaient se recouper, ou non, quant à nos passings (pour une personne trans, « passer » signifie être reconnu·e dans son genre par autrui, ndlr)...
"C’est comme si chaque "madame" m'enlevait des petits morceaux de moi"
« J'ai plutôt un bon passing : on m'appelle monsieur la majeure partie du temps. Mais depuis qu'on doit porter des masques on m'appelle presque systématiquement madame », raconte Andrès. « Avant le Covid-19 ça m'arrivait si j'étais de dos, car je suis petit et que j’avais les cheveux longs, mais les gens se corrigeaient dès que j'étais de face ».
Pour cette personne transmasculine de 28 ans, le pire a été de se faire aborder par un mec cisgenre et hétéro — avec toute la lourdeur qui le caractérisait — dans le métro : « J'ai baissé mon masque et il s'est senti con. Ouhlala, il a dragué un mec, tsé ! ». Ce changement provoqué par le port du masque a réveillé chez lui des insécurités qui s’étaient dissipées avec la pousse de sa barbe, et la masculinisation de son expression de genre.
Redevenu très conscient de sa voix, et de la manière dont il doit « performer la masculinité » un masque sur les oreilles, Andrès confie être nouveau sur le qui-vive en extérieur... ce qui lui provoque la désagréable impression d’un retour en arrière. « J'avais trouvé une paix et une confiance en moi qui ont été énormément fragilisées », raconte-t-il. « Cet été j'ai craqué et j'ai coupé mes cheveux. Ça allait un peu mieux. Mais quand ils ont repoussé au début de l'automne, ça a recommencé. J’en ai eu marre car j'étais fragile et je me suis fait une coupe ultra masculine. ».
De "pédé" à "sale gouine"
En 2021, l’interprétation du genre tiendrait encore à un cheveu ? « C'est très perturbant, j'ai du mal à comprendre comment les cis arrivent à me prendre pour une meuf. Si je n'étais pas aussi anxieux, ça me ferait rire de brouiller les pistes et de rendre les cis confus ! ». Pour Sahara Azzeg, étudiant non-binaire handicapé de 21 ans, les perturbations apportées par le masque se font entendre aux noms d’oiseaux qui lui sont lancés dans les rues d’Angers. « Mon expression de genre est plutôt masculine et je jauge mon passing aux insultes et agressions que je reçois dans la ville, car c'est les interactions avec des inconnu·e·s que j'ai le plus », explique-t-il.
« Avant le port du masque, c'était beaucoup "travelo" "pédé" "deviant" "tapette". Mon fauteuil me féminise aux yeux des autres en raisons des biais misogynes et validistes associés au handicap, donc j’avais quand même des "sale gouine" de temps en temps », raconte Sahara. « Avec le masque ce sont des insultes plus féminines comme "gouine" ou "brouteuse de gazon" qui ont refait leur apparition. On est aussi passé des agressions physiques auxquelles j’avais le droit avec mon passing masculin ou ambigu, à plus d’agressions sexuelles. Bien que je vive toujours ce type d’agressions consistant à me faire toucher, attraper ou déplacer avec mon handicap visible, je sens que le masque m'a fait vraiment perdre du passing et tous les efforts que je peux faire n'y changent rien ».
"JE SUIS UN MEC"
Même son de cloche chez Leo, qui s’identifie à la fois comme « mec trans et agenre » (une des nombreuses identités regroupées sous le terme parapluie de la non-binarité, ndlr). « J’ai de moins en moins confiance en moi dans l'espace public, c’est comme si chaque "madame" m'enlevait des petits morceaux de moi », explique l’étudiant âgé de 24 ans. « Avec le masque, je n’ai plus rien qui "corrige" mes traits doux donc par défaut, on me genre au féminin. Pourtant en dessous, je suis un gros barbu ! »
Le fait de se faire mégenrer (être mal genré·e, ndlr) oblige ce militant pour les droits des handicapé·e·s à prêter une attention particulière à sa voix, pour éviter les regards de travers au moment de corriger les gens en face de lui. « Je suis à deux doigts d'écrire "JE SUIS UN MEC" sur mes masques, mes t-shirts, partout. J'ai l'impression de ne plus être moi. »
Pour autant Leo a tout de même trouvé un avantage à la situation vis-à-vis de son genre. « Foutu pour foutu, autant porter des robes sans risquer les agressions dans la rue ! Ça m’a permis de réexplorer le côté féminin de mon genre », explique-t-il. « J’ai arrêté de céder à la pression du passing et je me fais plaisir vestimentairement, chose que je ne faisais plus depuis le début de ma transition pour avoir l’air le plus masculin possible. Ça, c’est la partie cool ».
"Le masque m’a permis d’explorer mon identité de genre"
L’obligation de couvrir son visage pour se protéger, collectivement, a certes généré beaucoup de dysphorie (détresse d'une personne trans face à une sensation de décalage entre son identité de genre propre et celle qui lui a été assignée à la naissance, ndlr) pour de nombreuses personnes trans et non-binaires. Mais pour d’autres, cet outil de protection sanitaire a aussi créé, à l’inverse, de précieux moments d’euphorie.
Coline, femme trans âgée de 34 ans, a vécu sa première année de transition hormonale durant l’épidémie de Covid-19. Au chômage depuis peu, elle n’a pas eu les moyens de commencer immédiatement à se faire épiler le visage au laser. C’est pourtant le meilleur moyen de se débarrasser de l’ombre de sa barbe, raconte-t-elle, et pour éviter d’avoir à se raser tous les matins.
« Mais par chance le port du masque est devenu normal », se réjouit Coline. « Je dis bien chance car ça m’a permis de me faire genrer correctement presque à chaque fois, chose que je n’aurais jamais eue sans en cette période. Se faire genrer comme ça, un peu partout, aussi rapidement, avec le peu de cis-passing que j’ai, c’est, je pense, du jamais vu ! ». En conséquence, elle ne va plus nulle part sans un masque, même dans les endroits où ce n’est pas obligatoire. « Cela me permet de cacher ma barbe mais aussi des traits considérés comme masculins.»
Dans le cas d’Automne, 18 ans, dont l’identité fluctue sans se retrouver dans un genre en particulier, le masque a également été une expérience positive. « Mi-2020, quand j'avais encore les cheveux assez courts, avec le masque, les gens n'arrivaient pas à déterminer mon genre en me voyant, c'était super satisfaisant, parce que j'avais l'impression d'être absolument à ma place », explique la jeune personne avec enthousiasme. « Comme les gens hésitaient, on ne m'appelait pas madame ou monsieur. C'était une super période. Après mes cheveux ont repoussé et du coup, les gens m'appellent de nouveau madame, mais avec tout ça, j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas si dérangeant, tant qu'on ne me sur-féminisait pas ».
Épiphanie de genre
Pour Céleste, juriste de 28 ans et militante engagée pour les droits humains installée à Bagnolet, l’obligation de porter le masque en extérieur a permis une révélation inattendue. « J’ai toujours été une expérience du genre assez proche de la féminité, mais ce n’est que depuis le confinement que je réalise que ça va plus loin que ça et que je suis une femme trans ! », raconte-t-elle, une joie lumineuse rayonnant dans la voix, que même le harcèlement de rue sexiste rencontré en cours de route ne saurait ternir. « Même s’il y a beaucoup d’étapes, et que je suis au tout début d’un long cheminement, le masque m’a permis d’explorer mon identité de genre, de la voir. »
En temps normal, « par peur de générer de l’hostilité », Céleste ne se serait pas permis d’expérimenter autant qu’elle a pu le faire avec son vernis, ou certains vêtements et de s’affirmer, à l’abri du masque. « Au yeux des gens, d’un coup, je passais comme femme plus facilement. On m’a dit plus facilement madame, on m’a genrée au féminin dans la rue, au travail, dans les magasins », s’émerveille-t-elle. « Après, quand je parle, quand on entend ma voix, plus grave, ça peut créer des échanges plus étranges... »
Moments d'euphorie
À la lecture de ces témoignages, l’impression que le masque serait globalement bénéfique au passing des personnes transféminines et néfaste à celui des personnes transmasculines semblerait se dégager. Mais ce n’est pas si simple. « Dans la même sortie on va me désigner comme “la jeune fille” ou “le jeune homme” de manière super aléatoire », raconte Leo.
La loterie génétique qui dessine le haut de nos visages, et nos préférences stylistiques, forment une équation bien opaque, qui n’aboutit pas au même résultat chez toustes, ni à chaque fois. Pour le tatoueur trans Nicoz Balboa, installé à La Rochelle, le port du masque a provoqué de réguliers « monsieur » dans l’espace public, alors qu’il était en tout début de transition. D’agréables moments d’euphorie volés à l’inconstant arbitraire des normes de genre que l’artiste a documentés dans son journal Sleeping in a binder, sur Patreon et Instagram.
Crédit : Nicoz Balboa
Après le masque, un monde moins genré ?
Pour de nombreuses personnes trans et non-binaires, la fin des masques ne marquera pas que la sortie de l’épidémie : ce sera aussi le soulagement de pouvoir à nouveau vivre leur genre de manière plus apaisée. Mais en ce qui concerne Coline, le jour où l’on ne devra plus toustes en porter représente une crainte. « Le fait que l'on me genre au féminin avec un masque me fait plaisir mais me dit aussi qu'on me genre seulement à cause de certaines choses dans mon apparence », regrette-t-elle. « Même après l’épilation laser je ne sais pas encore si ça suffira pour qu’on me genre convenablement sans une opération de féminisation du visage ».
« Il faudrait des années de masques pour changer les habitudes de genrer les corps sur des critères binaires et les manières d'interagir ! » : Céleste ne se fait pas d’illusions sur le potentiel du masque à dégenrer nos regards. « Personnellement je me sentirai facilement plus en danger sans le masque, car les personnes en face de moi auront accès à des caractères usuellement attachés au genre masculins et vont trouver cela discordant avec ma manière d'être ou de me vêtir », explique la jeune femme. « Je pense que c'est plus exposant aux remarques ou violences… »
Imposé ainsi à tous les visages, le masque aurait pu être un instrument du hasard idéal pour dégenrer le monde. Mais, la façon dont les personnes cisgenres arrivent à projeter des images masculines ou féminines sur ces toiles vierges est décidément édifiante d’inventivité. Bijoux, vernis à ongles, longueur des cheveux ou des cils… tous les détails sont bons pour se raccrocher à une rassurante vision rose et bleue de la société. Sahara Azzeg confirme par son expérience qu’en effet, la forme des yeux est, par exemple, quelque chose d’extrêmement genré pour une majorité des gens : « Je donne des cours de maquillage à des copaines trans et c'est un des premiers trucs avec lequel jouer pour faire varier le passing. La profondeur des yeux, les sourcils, si les paupières sont tombantes... ». On n’a pas le genre sorti des ronces.
"La lecture binaire et naturalisante du genre est infondée".
Fabrice Bourlez, psychanalyste parisien et auteur de Queer Psychanalyse, Clinique mineure et déconstruction du genre, n’est pas certain qu’un visage, exprimant toujours au moins une émotion ou un état, puisse être réellement neutre. « Bien que les conséquences ne soient pas les mêmes que pour des personnes trans ou non-binaires, il arrive également que certaines personnes cisgenres se fassent mégenrer à cause du masque », avance-t-il.
Bergamote, « pédé cis » et praticien bien-être parisien, peut en attester : « Les fois où je marche en talons dans la rue avec mon sweat à capuche et mes cheveux longs lâchés, les gens que je croise et que j’identifie comme des hommes me regardent bizarrement. Comme ils regardent les femmes habituellement, j’imagine », analyse-t-il. « Les personnes que j’identifie comme des femmes, elles, semblent marcher beaucoup plus à côté de moi, sans me contourner. Tout ça parce que le masque cache ma grosse barbe. Avant c’était juste “mais, c’est quoi, ce mec en talons ?” »
« En plus de nous protéger contre le virus, le masque peut aider à démontrer que la lecture binaire et naturalisante du genre est infondée » : Fabrice Bourlez, lui, voit dans le fait d’être mégenré·e à cause du masque une preuve tangible du caractère construit socialement de nos nos corps, par apprentissage, tout au long de la vie.
« On assiste en quelque sorte à une démonstration de la non-naturalité de nos corps, de l’interférence constante de notre chair avec des constructions langagières et sociales », décrypte le psychanalyste spécialiste des questions LGBTQI, avec un optimisme que l’on espère contagieux. « Autrement dit, si un simple masque en papier parvient à troubler le genre, c’est qu’il ne faut pas trop croire au déterminisme anatomique. »