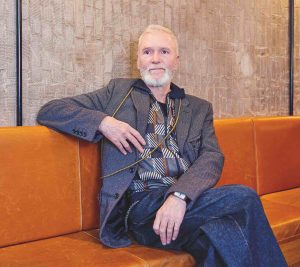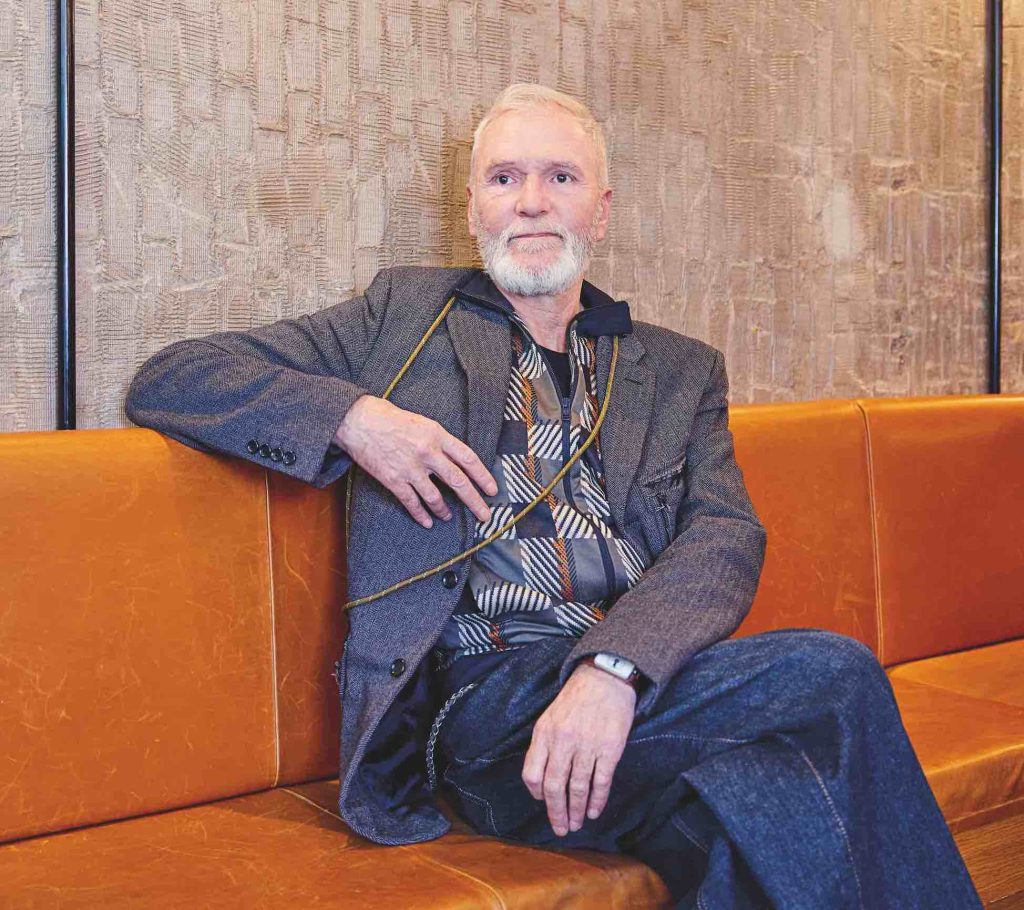Pour fêter ses vingt ans de scène, Vitalic a annoncé la sortie d'un nouvel album aux sonorités technos et post-punk de ses débuts. L’occasion aussi de faire la fête lors d'une tournée événement.
Une grande fête et un nouvel album pour ses vingt ans de scène. Musicien protéiforme, le producteur dijonnais Pascal Arbez-Nicolas, connu sous le nom de Vitalic, n’a eu de cesse d’inventer ses propres sons survitaminés, à l’intersection de l’electroclash, du funk, du disco, etc. Depuis la sortie de Poney, son premier EP sous le nom de Vitalic, en 2001, il est déterminé à rendre les frontières entre les genres plus poreuses et à jouer un rôle certain dans la démocratisation des musiques électroniques.
À lire aussi : Woodkid : "Je ne voulais pas faire de ma sexualité un sujet"
En plus d’un nouvel album en deux partie, DISSIDÆNCE, dont le premier volet Carbonized sortira en automne 2021, le producteur devrait monter sur scène à l’occasion d’un concert événement le 12 mars 2022 à l’Accor Arena (initialement prévu le 11 juin 2021) et d'une tournée mondiale. À bientôt 45 ans, l’artiste n’a rien perdu de son énergie légendaire et multiplie les collaborations avec des icônes de la communauté LGBTQ+, comme Rebeka Warrior, avec laquelle il a fondé le duo Kompromat, et plus récemment Kiddy Smile, qui a collaboré sur le premier single de son futur album. L’occasion aussi d’évoquer avec pudeur son rapport à l’identité queer.
Joyeux anniversaire Vitalic ! Ça te fait quoi ces vingt ans ?
Vitalic : Ça commence à faire long… (Rires.) Mais c’est passé très vite. Avec la situation actuelle, en tant qu’artiste il est difficile de rester positif. Tout est constamment repoussé, et personne n’arrive à prévoir ce qui se passera demain. Malgré tout, je suis toujours aussi impatient de voir ce que nous réserve la suite.
C’est vrai que le premier confinement a sèchement interrompu la tournée de Kompromat…
Nous avons eu de la chance dans notre malheur puisqu’il s’agissait de notre deuxième année de tournée, qui n’a finalement été écourtée que de quelques mois et a été vraiment top. Je pense surtout à des musiciennes comme Pomme ou Izïa Higelin, qui ont tout préparé et n’ont pu faire que quatre concerts… C’est vraiment triste.
On dit vingt ans, mais c’est même un peu plus si l’on compte tes années pré-Vitalic sous l’alias Dima. Quels souvenirs gardes-tu de cette époque ?
J’en garde surtout des souvenirs d’étudiant : un truc sans grande attente, fait avec des bouts de ficelle, pour le fun. Quand j’allais jouer, je partais dans ma voiture d’occasion avec quelques potes, mes trois machines et mes câbles faits maison. C’était assez local, mais j’en garde un très bon souvenir.
"Dans les warehouses ou des clubs comme La Station, je retrouve beaucoup de l’esprit techno des années 1990."
Tu as d’ailleurs réédité l’EP Fuckeristic, paru en 1999 sous l’alias Dima…
L’idée était surtout de marquer le coup, mais je crois qu’en ce moment on revient à ces sonorités. La techno a fait son tour d’horloge, et l’on entend aujourd’hui des choses qui me rappellent cette période. Dans les warehouses ou des clubs comme La Station, je retrouve beaucoup de l’esprit techno des années 1990. Cette réédition est un peu ma manière de marier les époques.
Ça te réjouit ce retour de la techno ?
J’aimerais surtout le retour des clubs !
En 2001, tu abandonnes le nom de Dima en lançant le projet Vitalic. Pourquoi ce nouvel alias ?
J’étais en train d’évoluer vers quelque chose de tout à fait différent. J’avais déjà complètement arrêté de faire de la techno à la fin des années 1990. D’ailleurs, je me demande si j’en ai jamais vraiment fait. En tournée, je me retrouvais sur scène à côté d’artistes comme Manu le Malin, une scène purement techno ou même hardcore, alors que j’étais déjà passé à autre chose. Quand je jouais, je sentais bien qu’il y avait un malaise. Il fallait adopter une nouvelle identité pour affirmer que mon projet n’était plus uniquement techno et recommencer sur des bases plus saines.
Être plus libre, finalement…
Et j’ai profité de cette liberté pour explorer de nouvelles couleurs sur chaque album.
Chacun d’entre eux développe un univers bien spécifique. Où puises-tu ton inspiration ?
Je ne réfléchis pas vraiment ma musique, elle sort comme elle me vient. Je me laisse porter. Il y a toujours une période un peu brouillonne, puis les choses s’assemblent petit à petit en travaillant. Je n’ai pas constamment la même énergie ni les mêmes envies, alors j’explore de nouveaux territoires à chaque fois. Heureusement, d’ailleurs. C’est peut-être ce qu’il y a de plus dur finalement : savoir se laisser aller, et voir ce qui sort lorsqu’on ouvre vraiment les vannes.
Qu’est-ce qui t’aide à les ouvrir ?
Mon environnement est une grande source d’inspiration. Les événements, tout ce qui se passe autour de moi, ce que je vois au cinéma, les musiciens que je rencontre, et puis ceux que je découvre… J’absorbe tout ça comme une éponge.
D’ailleurs, cette capacité à naviguer entre les genres rend ta musique difficile à classer…
Chacun a sa propre définition d’un genre ou d’une étiquette. Pour moi, par exemple, la French Touch, ce sont des boucles de disco filtrées et ultra-compressées, avec une ambiance clubbing assez solaire. À l’époque, il arrivait tout de même que l’on m’associe à l’electroclash, qui était un peu la cousine méchante, un peu “keupon”, de la French Touch.
"J’ai envie de délires entre le post-punk 70’s et la new wave, sur un bon beat techno."
C’est peut-être ce qui lie tous tes projets, ce côté un peu punk…
J’ai eu des moments très posés, comme sur Voyager, par exemple. Je regardais le monde avec un peu de détachement, avec la lumière de l’expérience. Mais il est vrai que cette énergie punk ne m’a jamais vraiment quitté. Elle me revient d’ailleurs aujourd’hui. Pour mon prochain disque, j’ai envie de délires entre le post-punk 70’s et la new wave, sur un bon beat techno. Je crois que je suis définitivement redevenu adolescent. C’est peut-être l’époque qui veut ça…
Des envies de révolte, peut-être ?
Le premier single de mon nouvel album, que je partage avec Kiddy Smile, aborde précisément cette question.
C’est le deuxième artiste ouvertement LGBTQI+ avec qui tu collabores…
Il s’agit avant tout de rencontres artistiques. Avec Julia [Lanoë, le vrai nom de Rebeka Warrior], nous nous sommes retrouvés à un moment où nous avions des choses à raconter d’une même voix. Kiddy Smile m’a impressionné en live, et j’ai eu envie de lui proposer un morceau qui l’amènerait sur d’autres terrains – juste pour voir. Ce sont des artistes avec beaucoup de puissance, qui ont des choses à dire.
Revendiques-tu toi-même une certaine identité queer ?
Un arc-en-ciel traverse de part en part la pochette de mon album Voyager, ainsi que toutes les affiches et les flyers de la tournée. La musique, les vidéos, les artworks… C’est ma façon à moi de dire les choses.
"Lorsque j'écris, je me lève vers 6h et j’arrête de travailler entre 1 et 2h du matin."
Tes collaborations avec d’autres artistes sont rares ; tu es un solitaire ?
J’aime l’isolement que la musique me procure. Quand je n’en fais pas, je mène une vie hédoniste, je glande pas mal. En revanche, lorsque je suis dans un travail d’écriture – comme c’est le cas en ce moment –, je me lève sur les coups de 6h et j’arrête de travailler entre 1 et 2h du matin. Je ne sors que pour promener mon chien. Je n’ai pas besoin de voir du monde ni de m’amuser. Le fait d’être seul dans ma pièce, de chercher mes techniques, mes mélodies, mes textures, mes arrangements, etc., c’est quelque chose de très intime finalement. J’envie parfois – parce que je l’ai vécu avec Kompromat – les duos. Il y a quelque chose de plus simple, tu peux te reposer sur quelqu’un d’autre.
En parlant de Kompromat, tu avais déjà collaboré avec Rebeka Warrior sur ton album Rave Age…
À l’époque, j’avais été saisi par son écriture. Je n’étais pas un grand fan de Sexy Sushi, mais ses paroles avaient beaucoup de sens, un message différent qui m’a touché. Des années plus tard, on s’est retrouvés pour dîner et on s’est rendu compte qu’on avait tous les deux envie de nouveauté, qu’on aimait un peu les mêmes trucs – genre le post-punk – et surtout qu’on avait plein de choses à dire en commun. À la fin du repas, elle m’a proposé de lui envoyer une instru pour y poser un chant. Ça a tout de suite matché, et, quelques semaines plus tard, on tenait “Niemand”, le premier titre de Kompromat.
Votre duo marie techno, synth-pop et post-punk. Tu aimes brouiller les frontières entre les genres…
Une partie de la créativité vient en cherchant en dehors de ses zones de confort, en tentant des trucs un peu fous. Et c’est toujours mieux si on s’amuse.
Et vous amuser, vous aimez bien ça, Julia et toi…
On ne monte pas un groupe punk uniquement parce qu’on est en colère. À un moment, il faut savoir lâcher la pression. En tournée, on baladait notre système-son, notre machine à fumée et notre stroboscope partout pour transformer nos loges en mini rave-parties. En festival, les autres groupes venaient faire la fête chez nous. On est très potes avec Odezenne, par exemple, avec qui l’on partage ce même goût pour la fête. On écoute assez peu de techno finalement, et pas mal de conneries entrecoupées d’IDM [intelligent dance music]. Ça peut très vite passer d’une musique sombre et ultra-répétitive à du Lio ou du Bonnie Tyler.
On dirait une soirée queer des années 1990, non ?
Il y a un peu de ça. En tout cas, c’est intense.
"Les soirées sont des endroits de liberté dans lesquels on peut se livrer plus facilement qu’ailleurs."
Quel rôle ont joué la fête et les musiques électroniques dans la construction de ton identité ?
C’est une question complexe à laquelle je n’avais jamais réfléchi… La musique est essentielle. La composition et l’écriture de textes sont une façon d’aller chercher des choses en soi et de les partager, avec ou sans filtre. Ensuite, les soirées sont des endroits de liberté dans lesquels on peut se livrer plus facilement qu’ailleurs – avec moins de jugement, en sécurité. Au-delà du fun, ce sont des endroits propices aux rencontres artistiques ; parfois même avec une dimension politique, comme à Possession ou au Rosa Bonheur.
Vingt ans de fêtes et de tournées, et tu n’es toujours pas fatigué…
Il faut avoir du sang dans les veines pour faire ce métier. On n’a pas tous la même résistance à la fatigue. Pour ma part, ce rythme me convient. Je crois qu’il est important d’adopter un mode de vie sain. En semaine, je fais du sport, j’essaie de prendre soin de moi. L’excitation de revenir sur scène avec un nouvel album et un nouveau projet scénique, c’est ça qui me motive à y retourner à chaque fois.
On repart pour vingt ans de plus ?
Je ne sais pas… C’est d’abord au public de décider. Ensuite, si je n’avais plus la flamme, je lâcherais de moi-même. Peut-être que je me réinventerai en organisateur de croisières nostalgiques avec tous les grands DJ de l’electroclash.
À lire aussi : Mylène Farmer : "Le secret est mon sanctuaire"
Crédit photo : Jérémie Blancfene